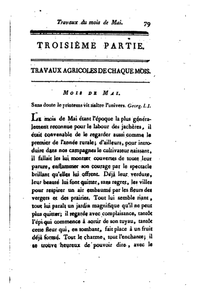C de Lihus 1804 Principes d'agriculture et d'économie - Ch1 P3
| Avertissement sur la numérotation | ||
|---|---|---|
| La numérotation des pages dans le livre original est indiquée entre crochets. Ainsi, l'indication [79] dans le texte (ou en haut d'une page) marque le passage de la 78e à la 79e page. | ||
| Principes d'agriculture et d'économie | ||
|---|---|---|
| Table des matières | ||
| Préface | p. v | |
| PARTIE I | ||
| Chapitre 1 | p. 1 | |
| Chapitre 2 | p. 10 | |
| PARTIE II | ||
| Amontement | p. 51 | |
| PARTIE III | ||
| Mois de mai | p. 79 | |
| Mois de juin | p. 118 | |
| Mois de juillet | p. 140 | |
| Mois d'aoust | p. 152 | |
| Mois de septembre | p. 196 | |
| Mois d'octobre | p. 223 | |
| Mois de novembre | p. 252 | |
| Mois de décembre et janvier | p. 272 | |
| Mois de février | p. 280 | |
| Mois de mars | p. 294 | |
| Mois d'avril | p. 312 | |
| Conclusion | p. 328 | |
| Retour à la présentation de l'ouvrage | ||
[79]
MOIS DE MAI.
| Sans doute le printems vit naître l'univers. | ||
| Georg. l. I.[1] |
Le mois de Mai étant l'époque la plus généralement reconnue pour le labour des jachères, il était convenable de le regarder aussi comme le premier de l'année rurale ; d'ailleurs, pour introduire dans nos campagnes le cultivateur naissant, il fallait les lui montrer couvertes de toute leur parure, enflammer son courage par le spectacle brillant qu'elles lui offrent. Déjà leur verdure, leur beauté lui font quitter, sans regret, les villes pour respirer un air embaumé par les fleurs des vergers et des prairies. Tout lui semble riant, tout lui paraît un jardin magnifique qu'il ne peut plus quitter ; il regarde avec complaisance, tantôt l'épi qui commence à sortir de son tuyau, tantôt cette fleur qui, en tombant, fait place à un fruit déjà formé. Tout le charme, tout l'enchante ; il se trouve heureux de pouvoir dire, avec le [80] chantre de Mantoue[2] : Haec mea sunt, veteres, migrate, coloni ; c'est ici ma propriété, sortez, anciens colons, qui regardiez ma métairie comme votre héritage. Aussi notre cultivateur, impatient de jouir, ne perd pas un moment ; ses fourrages sont achetés, ses charrues sont prêtes, et ses chevaux n'attendent que le moment du signal. Le premier Mai arrive, et aussi-tôt il ordonne d'entrer dans les jachères.
Culture des jachères.
| Ce passage fait l'objet d'une citation dans les articles Repos et fatigue des terres et Guéret des Mots de l'agronomie.
Les Mots de l'agronomie
Les Mots de l'agronomie sont un projet de dictionnaire de l'agronomie, porté par l'Inra (départemet SAD). Il est hébergé au sein du réseau Wicri, sur le wiki les Mots de l'agronomie.
|
On appelle jachères, les terres qui ne sont chargées d'aucuns grains, du mot latin jacere, se reposer. La coutume générale est de laisser reposer la terre tous les trois ans, c'est-à-dire, de la cultiver sans y rien semer. La terre se repose donc, mais le cultivateur ne se repose pas ; s'il ne confie rien à la terre, il la dispose à rapporter du grain l'année suivante. Comme la récolte dépend de la bonne ou mauvaise préparation, il emploiera bien utilement l'année de jachère, s'il met en œuvre tous les moyens de fertiliser son sol. Il sera payé avec usure de la culture de ses guérets, pourvu que, 1°, il leur donne les labours nécessaires pour les rendre plus meubles et plus susceptibles des impressions végétatives de l'atmosphère ; 2°, qu'il les purifie de toutes les mauvaises herbes qui en épuisent inutilement [81] le suc ; 3°, qu'il y porte les engrais convenables ; trois moyens principaux pour bien cultiver les jachères : je vais les examiner l'un après l'autre.
Ier. Moyen.
- Labours. — Leur quantité.
Une terre est ordinairement bien cultivée avec quatre labours. Cette quantité est suffisante pour l'ameublir et la faire participer aux sels répandus dans l'air. Cette opinion est contraire à celle du Cours d'Agriculture, qui veut trois labours préparatoires, dont l'un au sortir de la moisson, le second avant l'hiver, le troisième au commencement du printems ; plus, trois labours de division, qui doivent commencer deux mois avant les semences[N 1][C 1]. Quelque respect que j'aie pour l'auteur, je ne puis être de son avis ; car, 1°, il est constant que la fréquence des labours épuise la terre, si on ne répare cet épuisement par des engrais multipliés ; 2°, cette division de labours supposerait un tems toujours favorable, ce qui n'arrive presque jamais, puisqu'il y a toujours deux ou trois mois nuls pour les labours ; 3°, le cultivateur serait alors obligé d'avoir presque [82] double attelage pour chaque charrue, ce qui coûterait beaucoup, sans qu'on en fût du tout dédommagé par le produit. Peut-on raisonnablement dire à un cultivateur qui n'a besoin que de trois chevaux par charrue : ayez-en deux de plus, afin de mieux diviser la terre ? L'auteur a beau dire qu'il a l'expérience pour lui, je ne puis le croire ni ne puis imaginer que jamais on ait fait cet essai, excepté en petit, par exemple, sur une douzaine d'arpens. On me niera peut-être que les labours multipliés épuisent la terre ; cependant c'est un principe reconnu de tous ceux qui cultivent par eux-mêmes. Comme le propre des labours est d'exposer, tour-à-tour, toutes les parties de la terre aux influences atmosphériques, il est constant qu'une terre ainsi divisée rapporte d'abord davantage, mais qu'elle ne tarde pas à s'épuiser, par la raison qu'elle donne tout son suc, et que toutes les parties contribuant également à la fécondité de la plante qu'on lui confie, se trouvent aussi épuisées en même tems. Ce n'est pas que je pense comme quelques-uns, que la terre s'use, et qu'un pays qui produisait beaucoup, finisse par devenir peu fructueux ; comme l’Italie, qui, après un produit considérable du tems des Romains, est présentement d'un médiocre rapport. Je serais plutôt porté à penser, avec Columelle, que la terre ne vieillit pas, comme une vieille [83] femme[3], mais qu'elle ne produit plus autant lorsqu'elle n'est plus engraissée par les feuillages et les herbes que la charrue et la herse arrachent. Je crois donc, d'après l'avis de cet ancien, qu'il faut cultiver la terre, mais non la tourmenter, et que beaucoup de culture sans amendement ne peut réussir long-tems. Aussi j'admettrai volontiers beaucoup de labours dans une petite quantité de terres, comme, par exemple, dans celles qu'on n'aurait pu fumer ou parquer ; la fréquence des labours les dédommagerait alors du défaut d'engrais, comme j'en ai fait moi-même l'expérience, en labourant un coin de terre jusques à huit fois ; mais après des labours si fréquens, il ne faut pas oublier d'amener de bons engrais, pour rendre à la terre tous les sucs qu'on lui a enlevés.
- Saison des labours.
Mieux vaut saison que labouraison, disait Olivier de Serres[4]. L'essentiel est donc de donner les labours dans les tems convenables, et de les rapprocher davantage, plus on est près du moment des semences, afin que la terre soit plus fraîche et plus meuble ; et voilà pourquoi je suis d’avis de ne labourer, avant le premier Mai, que les terres sur lesquelles on porte du fumier, et qu'il faut indispensablement labourer pour ne pas en perdre [84] le suc. Pour les autres, je ne conseille pas de les labourer plutôt ; les labours et les hersages se suivant de plus près, ameubliront davantage la terre et détruiront plus aisément l'herbe.
- Ordre des labours.
On doit labourer les premières les terres les plus dures, de peur que la grande chaleur ne les durcisse au point que la charrue n'y puisse entrer. Il ne faut pas s'effrayer, quand on ne pourrait pas donner un labour assez profond à cause de la sécheresse. Le premier labour est toujours bon quand il est fait par tems sec, et que la terre est bien retournée, sauf à donner au labour suivant la profondeur que mérite la qualité de la terre. Un autre motif doit déterminer l'ordre des labours, c'est le tems ; s'il est sec, qu'on laboure les terres argileuses et humides qui ne peuvent se labourer dans un autre tems ; s'il est humide, qu'on s'occupe des terres sablonneuses ou légères. Les terres grasses et naturellement fertiles doivent aussi être cultivées les premières, et on doit, au contraire, laisser reposer davantage celles qui sont maigres et de mauvaise qualité, suivant ce principe si clairement énoncé :
| Qu'au fonds qui est sans humeur | ||
| Ne touche le laboureur | ||
| Olivier de Serres[5] |
[85]
- Profondeur des labours.
L'abondance des récoltes ne dépend pas toujours de la profondeur des labours ; je connais une commune où les terres produisaient très-peu il y a quelques années, et rapportent on ne peut mieux depuis qu'elles ont été marnées, quoiqu'on n'y fasse, pour ainsi dire, qu'effleurer la terre. Qu'on suive donc, en général, l'habitude du pays, et qu'on ne la contredise qu'après avoir éprouvé peu-à-peu qu'elle est mauvaise ; qu'on étudie pour cela la qualité de la terre qu'on cultive. Comme, dans le même arpent, il se trouve des endroits où il faut enfoncer plus ou moins la charrue, qu'on s'informe de ces changemens de terre à son charretier, pour connaître son terrein, et en même tems réveiller son attention. Il deviendra observateur et soigneux, si son maître lui fait plusieurs questions auxquelles il sera charmé de répondre, sur-tout s'il s'apperçoit qu'il n'a pu y satisfaire faute de n'y avoir pas réfléchi, et d'avoir toujours fait de la même manière, sans savoir le pourquoi, et sans s'embarrasser si on pourrait faire autrement.
Il faut suivre la même méthode pour donner plus ou moins de largeur aux raies ; lorsqu'on les fait petites, la terre se divise mieux, mais aussi on fait beaucoup moins d'ouvrage, et la terre est [86] beaucoup plus sujette à se battre ; lorsqu'on fait des raies plus grandes, on avance bien davantage, mais l'herbe ne se détruit pas si bien, et la terre reste beaucoup moins meuble. Les chevaux ont aussi beaucoup plus de fatigue, et sont obligés d'aller plus doucement. Il faut donc consulter la qualité de la terre, et savoir prendre un juste milieu. Il y a des charretiers qui font des raies très-petites, comme pour ainsi dire dans un jardin potager, et d'autres qui en font d'énormes, et par conséquent retournent fort mal la terre : les deux excès sont également à éviter. Quand la terre n'est pas trop sèche, il faut prendre une raie médiocre et qui ne l'empêche pas de se bien retourner ; dans les endroits où la terre est mouvante, prendre plus de raie que dans les terres à cailloux, qui sont roides de labour, et où la terre resterait sans être entamée ou divisée, si on prenait beaucoup de raie, surtout lorsqu'il fait sec.
- Manière de bien labourer.
Il existe une manière de bien labourer, propre à tous les pays, à toutes les terres, à toutes les charrues ; c'est, 1°, d'avoir, autant que faire se peut, deux chevaux de force égale, et qui aient le même pas et la même vivacité. Pourquoi ? parce que, sans cela, il faut retenir l'un et exciter l'autre ; ce qui ne va jamais bien, car il est rare [87] que la charrue ne se dérange pas lorsqu'il faut avoir recours au fouet ; 2°, avoir des chevaux qui tirent bien droit, sans se jetter l'un sur l'autre, comme il arrive quelquefois ; ce qui fait que non-seulement les raies ne sont pas droites, mais que la terre est mal labourée et hachée ; 3°, que le charretier maintienne toujours sa charrue pour prendre la même raie, soit en profondeur, soit en largeur ; qu'il appuie néanmoins dans les endroits plus durs, qu'il soulage dans lés endroits mouvans, mais que jamais il ne pèse sur la charrue, comme j'ai vu faire à quelques charretiers, qui écrasaient leurs chevaux et les fatiguaient beaucoup, sans faire pour cela de meilleur ouvrage ; 4°, que le charretier soit doux pour ses chevaux ; qu'il ne les maltraite pas, mais qu'il les accoutume à aller un pas égal et proportionné à la force du terrein qu'il laboure. Un bon charretier a presque toujours de bons chevaux, parce qu'il ne les fatigue pas, et cependant il sait en tirer parti. Le cheval est l'animal le plus aisé à dresser et à prendre de bonnes habitudes : des chevaux bien menés labourent tous seuls, sans jamais se détourner. J'en ai vu si accoutumés à passer des arbres, qu'ils arrêtaient à la moindre racine qu'ils rencontraient, et d'autres qui étaient tellement faits à tourner au bout de la raie, qu'il n'était pas nécessaire qu'on les en avertît ; ces derniers, conduits par un charretier [88] adroit et prompt, faisaient un ouvrage surprenant, parce qu'ils ne s'arrêtaient jamais et n'avaient pas besoin du fouet ; ce qui est, je le répète, un article important pour les chevaux de charrue, qui doivent, pour ainsi dire, aller à la parole.
IIe. Moyen.
- Destruction des mauvaises herbes.
Rarement l'herbe pousse avant le premier Mai ; la terre étant, pour ainsi dire, jusque là dans une espèce de stagnation. Le peu d'herbe qu'elle pousse jusqu'à cette époque est mangé par les bestiaux, et ne peut lui nuire lorsqu'on la renfouit en tems convenable. Le moment où l'herbe fait beaucoup de ravage est en Mai, Juin, Juillet et Août, à cause de la grande végétation de la terre. C'est donc le moment intéressant pour la destruction entière de l'herbe, moment qu'on ne doit pas laisser échapper si on veut récolter :
| Le trop tarder en fait de labourage | ||
| Est la ruine entière du ménage | ||
| Olivier de Serres[6] |
| Ce passage fait l'objet d'une citation dans l'article Jachère des Mots de l'agronomie.
Les Mots de l'agronomie
Les Mots de l'agronomie sont un projet de dictionnaire de l'agronomie, porté par l'Inra (départemet SAD). Il est hébergé au sein du réseau Wicri, sur le wiki les Mots de l'agronomie.
|
Pour bien détruire l'herbe, il faut labourer les terres les plus enherbées par un tems chaud ou sec, afin que l'ardeur du soleil ou le vent fasse périr l'herbe promptement. Il n'y a que les [89] chardons qui veulent être labourés par la pluie ; l'humidité les détruit immanquablement. Quand l’herbe est bien desséchée, il faut herser la terre pour bien séparer l'herbe des sillons, et la retourner du côté où elle est encore verte ; hersage qui doit se réitérer jusqu'à ce que l'herbe soit entièrement détruite. Si la terre devient tellement sèche que la herse de bois ne puisse y entrer, ou que vous n'ayez pas le tems de la relabourer, vous emploierez avec succès la herse de fer : si on la fait passer plusieurs fois, elle arrachera l'herbe, ameublira la terre et équivaudra presque à un labour.
IIIe. Moyen.
- Engrais.
La terre produirait toujours abondamment, si on pouvait lui donner les engrais nécessaires. Un des grands soins du cultivateur est donc de les multiplier le plus possible ; le plus ordinaire et le plus facile est le fumier produit par les chevaux, vaches, moutons, porcs ; on ne peut malheureusement en augmenter la quantité que peu à peu : car, si les engrais produisent de bonnes récoltes, ce sont les bonnes récoltes, à leur tour, qui produisent les pailles nécessaires pour multiplier les engrais ; et c'est ce qui rend les premières [90] années difficiles, les récoltes manquant faute d'engrais, et les engrais étant rares à cause de la médiocrité des récoltes. Aussi est-il souvent indispensable, dans un terrein négligé de longue main, d'acheter, la première année, des pailles pour faire du fumier, et se procurer par-là des récoltes plus abondantes. Mais les pailles ne forment engrais, que lorsqu'elles ont été consommées par des bestiaux ; il faut donc que le cultivateur achète une quantité de bestiaux qui soit proportionnée à la quantité de pailles qu'il a à consommer, et qu'il augmente cette quantité peu à peu, lorsque ses luzernes et sainfoins lui fourniront du fourrage, et une bonne culture beaucoup de pailles en tout genre.
Ainsi, trois choses nécessaires pour faire du fumier : des pailles en abondance, beaucoup de bestiaux, des nourritures suffisantes. Voilà, je pense, la meilleure manière de faire des engrais, la plus simple, la plus facile, celle dont les résultats sont les plus certains et les plus lucratifs, toutefois avec les précautions nécessaires. Il faut d'abord avoir soin que le fumier soit suffisamment pourri, à moins qu'on ne le mette dans des terres à cailloux, où le fumier blanc réussit beaucoup mieux, parce qu'il tient ces terres légères. Il faut cependant ne pas laisser trop pourrir le fumier, parce qu'alors il perdrait beaucoup en [91] quantité. On en met ordinairement dix voitures à quatre chevaux par arpent ; il vaut mieux en mettre moins et fumer plus de terre, parce que quatre arpens d'une récolte médiocre valent toujours mieux que deux arpens où l'on récolte beaucoup, et deux autres qui produisent peu parce que la terre manque d'amendement. D'ailleurs, la trop grande quantité de fumier fait quelquefois verser le blé, et produit d'autres fois une si grande quantité d'herbe, qu'elle étouffe même le blé. Fumer peu et souvent, c'est le sentiment de Columelle et de Palladius. Licet majorem fructum percipere si frequenti et modica stercoratione terra refoveatur (dit le premier). Nec prodest nimiùm stercorare uno tempore, sed frequenter et modicè. (Pall.) Je ne parle pas de cette opinion de Columelle, qu'on fait mourir l'herbe en fumant au déclin de la lune. J'avoue que je ne crois pas à ces préjugés ; et j'aime mieux dire avec Olivier[7] :
| L'homme étant trop lunier, | ||
| De fruits ne remplit son panier |
- De la marne.
Il est un engrais bien utile pour certaines terres ; c'est la marne, qui est une pierre blanche qu'on trouve au fond de la terre, à une distance plus ou moins profonde : elle est nécessaire aux terres qui sont froides et gardent l'eau, à celles qui sont [92] fortes de labour et ne peuvent se diviser. Il en faut mettre cependant modérément, parce qu'elle rendrait la terre trop légère et la dénaturerait. Après avoir marné, il faut tout de suite bien fumer, et renfouir la marne et le fumier tout ensemble. Le fumier doit être plus abondant qu'à l'ordinaire, bien pourri, et au moins à la quantité de douze voitures par arpent[N 2][C 2]
- Différens engrais
Un excellent engrais à mettre sur les terres, est le fumier de poules, pigeons et dindons, connu sous le nom général de poulinée. On la sème, par un tems un peu humide, à la fin d'Avril, sur les orges et avoines, et presque jamais sur le blé, parce que cette sorte d'engrais fait pousser des grains d'orge et d'avoine que les volailles rendent quelquefois tout entiers. Il y a encore plusieurs autres espèces d'engrais, comme les boues de rue, de marre ou d'étang, les démolitions de maisons, etc. Je ne parle pas du mélange des terres, cela exige des dépenses trop excessives
[93]
- Endroits où il faut conduire les engrais.
Il faut d'abord conduire les engrais dans les terres les plus maigres et les plus humides. Ager aquosus plus stercoris, siccus verò minus requirit[8]. Si l'on a des terres douces et des terres à cailloux, il faut fumer d'abord celles qui n'ont pas de cailloux (que j'appelle douces), parce que le fumier est bien plus long-tems à s'y consommer que dans les cailloux, où il se pourrit en peu de tems. Le mieux est de mener les fumiers sur les jachères avant de les labourer : 1°, pour que le fumier ait plus de tems pour se consommer ; 2°, pour tenir la terre plus légère et plus meuble. Cependant, comme on ne peut pas mener tous les fumiers au premier labour, il faut absolument en mener au deuxième et même au troisième, plutôt que de le laisser un an dans la cour, comme on fait dans certains pays ; et cela contre l'avis de Columelle, qui pense que le fumier doit être employé dans l'année, et que celui qui est trop vieux n'a pas de qualité. Il est cependant des endroits où l'on est obligé de ne le charrier qu'une fois l'année ; ce sont ceux où la terre est assez forte et assez chaude, les engrais assez bons et assez abondans pour ne pas faire de jachères : alors il faut absolument les charrier tout de suite en une seule fois, sur les terres qu'on veut semer [94] en blé. Quelques cultivateurs ont la coutume de fumer en Mars, pour préserver d'herbe leurs blés ; mais je ne conseille pas de faire souvent usage de cette méthode ; car, d'abord, dans les années sèches, le fumier, sur-tout lorsqu'il est mis après l'hiver, brûle les graines qu'on y sème, comme je l'ai vu arriver deux années de suite. De plus, il est constant que l'avoine, et sur-tout l'orge, consomment une partie du fumier, et que ce qui peut lui rester de sel et de suc s'évapore pendant l'année des jachères.
Lorsqu'on aura mené le fumier sur les terres, il faut le faire épandre bien également, mais jamais pendant la gelée, de peur qu'il ne se perde dans les dégels. Quand il peut tomber dessus le fumier épandu une pluie modérée, il entre plus aisément dans la terre et se renfouit mieux. L'hiver on peut le laisser épandu tant qu'on veut ; il n'en est pas de même du printems et de l'été ; il est bon alors de ne pas le charrier, et sur-tout de ne pas l'épandre long-tems d'avance, de peur que le soleil ne le mange et n'en ôte les sels ; suivant cet avis de Palladius, ne stercora exsicata nihil prosint. Quand on renfouit le fumier, il faut avoir soin que le charretier le renferme bien dans la raie, et qu'il pousse, avec son pied ou un bâton, celui qui pourrait rester sur terre, et qui alors ne se consommerait pas.
[95]
Semences de Mai.
Comme tous les mars doivent être semés avant le commencement de Mai, on ne doit s'occuper que des menues graines, comme trèfle, luzerne, sainfoin, etc. Commençons par le trèfle :
Semences de trèfle.
Les premiers jours de Mai, on doit semer les trèfles dans les blés et dans les avoines, à la quantité de vingt livres à l'arpent ; on le sème dans les avoines, avant de les ploutrer, et quand la terre a encore un peu d'humidité, afin que les mottes venant à se briser, recouvrent la graine de trèfle et la fassent fructifier. Il ne faut pas non plus que la terre soit trop humide, ni semée par un tems de pluie, parce qu'alors la graine pourrit en terre et ne lève pas. C'est donc à la sagesse du cultivateur à choisir le tems convenable, et à prendre le juste milieu entre une grande sécheresse et une grande humidité. On sème presque toujours, avec succès, du trèfle dans l'orge, suivant la méthode que nous indiquerons en Avril. Celui qu'on sème dans l'avoine, a quelquefois l'inconvénient de rencontrer une terre trop dure ou trop sèche. Celui qu'on sème dans le blé réussit assez bien, et a l'avantage de rester deux années ; mais aussi le blé vient souvent moins fort, et il y a du [96] désavantage à occuper, par du trèfle, des terres qui pourraient rapporter de l'avoine, des pois et autres grains ; d'autant plus que souvent, la seconde année, le vieux trèfle périt et s'enherbe. Le trèfle aime une terre grasse et humide ; il faut donc lui choisir un terrein convenable. J'ai éprouvé qu'il se plaisait beaucoup à l'abri du vent et de la gelée.
Semences de sainfoin.
Le sainfoin doit être semé au commencement de Mai, au plus tard, dans une terre bien préparée, bien hersée, et où on ait détruit l'herbe, autant que faire se peut. La quantité de semence est d'un setier par arpent. Quelques cultivateurs fument avant que de semer le sainfoin ; je n'adopte pas du tout cette méthode : le sainfoin vient, il est vrai, plus fort, mais aussi il est plus sujet à se jetter en herbe. Qu'on ne le sème pas cependant dans une terre fatiguée de rapporter, mais dans une terre fumée avant le blé, labourée avant l'hiver, et deux fois depuis, pour détruire entièrement l'herbe. Pour entretenir la fraîcheur de la terre, il est bon d'y semer quelque chose avant le sainfoin, comme de l'avoine ou de l'orge, mais seulement un quart de semence. Je conseillerais plutôt l'avoine, parce qu'elle fatigue moins la terre : cette semence doit [97] être jettée sur un labour qui soit nouvellement fait, c'est-à-dire, de vingt-quatre heures au plus, et qu'on ait réduit en poussière avec la herse et le rouleau ; on herse et on ploutre par-dessus le grain, après quoi on sème le sainfoin, qu’on herse et qu’on ploutre aussi, de manière que la terre se trouve brisée en petites molécules et bien tassée, pour conserver son humidité le plus long-tems possible.
Semences de luzerne.
Il y a deux manières de semer la luzerne ; la première, de la semer dans les premiers jours de Mai, avec quelques graines, comme avoine, orge, camomille, quarantain[9] ; la seconde, de la semer toute seule au commencement de Juin. Dans la première manière, on suit absolument les procédés indiqués pour le sainfoin ; dans la seconde, on se contente de bien préparer et ameublir la terre, après quoi on sème la luzerne, qu’on herse et qu’on ploutre jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de mottes. Chacune de ces méthodes, que j’ai successivement employées, a ses avantages et ses inconvéniens qu’il faut exposer : la première est beaucoup plus certaine, et, pour ainsi dire, infaillible ; la luzerne ne manquant presque jamais lorsqu’elle est protégée par un grain quelconque, qui, tout à la fois, empêche l’herbe de l’étouffer [98] et la préserve des grandes sécheresses : la seconde exige plus de préparation pour détruire entièrement l’herbe, et procurer à la terre une humidité et une fraîcheur qui puissent la garantir contre les chaleurs de l’été. Si on est assez heureux pour obtenir ces deux avantages, et que la saison ne devienne pas trop sèche ou trop pluvieuse, le semis de luzerne fait des progrès rapides et surprenans ; mais si l’herbe vient à dominer, ou que d’excessives chaleurs empêchent la végétation et brûlent le sol, alors la graine languit, et souvent même périt. Selon la première méthode, la luzerne ne se récolte que l’année d’après, le grain qu’on y mêle l’empêchant de s’élever ; dans la seconde, on a la satisfaction, lorsqu’elle réussit, de faire une petite coupe la première année. Lorsqu’on mêle la luzerne à un autre grain, surtout à la camomille et au quarantain, qui dégraissent beaucoup la terre, elle n’est jamais si touffue d’abord, parce qu’elle ne peut s’étendre beaucoup, à cause du grain qu’on y a mêlé, et avec lequel elle est obligée de partager les sucs du sol. Les années suivantes elle s’étend davantage et forme du pied ; aussi arrive-t-il souvent que l’herbe s’empare des places vides, et qu’avec toutes les précautions possibles, elle domine la luzerne, au moins en partie. Dans la seconde, au contraire, où l’on sème la luzerne toute seule, elle pousse [99] tout de suite avec abondance, lorsque le tems est favorable, et ne laisse aucune place à l’herbe qu’elle étouffe et détruit. Selon le premier procédé, la luzerne s’élève fort haut dès la seconde année, et prend beaucoup de pied, ayant de la place pour s’étendre ; mais aussi elle forme de grosses tiges et elle dure moins, parce qu’elle contient réellement moins de pieds, et exige, dès la seconde coupe, la herse de fer[N 3][C 3]. Selon le second procédé, la coupe de la seconde année n’est pas très-haute ni très-abondante, parce que la luzerne étant touffue ne peut s’élever fort haut ; mais aussi elle forme un fourrage extrêmement délicat, parce qu’il ne se trouve que des fanes et un tuyau très-mince et très-tendre : elle résiste aussi beaucoup plus de tems, et n’appelle la herse de fer qu’au bout de quelques années.
D’après l’exposé des deux procédés différens pour semer la luzerne, on sera, j’espère, en état de juger celui qui sera le plus propre à la terre qu’on aura à semer. La première méthode convient plus à des sols secs ou caillouteux, dans lesquels le semis serait consumé par la chaleur, qui agit toujours plus puissamment sur cette espèce de terre ; la seconde s’emploiera avantageusement [100] dans des terres qui ont du fond, et qui par conséquent conservent plus aisément leur humidité. Qu’on ait soin, dans la première méthode, de semer le grain qui doit accompagner la luzerne, assez tôt pour qu’il mûrisse et qu’on en retire un profit qui dédommage des frais de semences ; dans la seconde, qu’on fasse arracher ou sarcler l’herbe, si elle vient à se présenter avec une abondance qui ferait craindre pour la luzerne. Le meilleur moyen de se garantir de l’herbe serait de semer la luzerne sur une jachère complète et destinée à recevoir du blé ; mais c’est une récolte de moins, et là-dessus je n’ose donner de conseil.
Un avis important pour ceux qui sèment la luzerne, quelque parti qu’ils choisissent, c’est de ne jamais se décourager, quand ils ne verront paraître que très-peu de plantes de luzerne ; cette graine se conserve long-tems en terre, et germe au bout d’un tems considérable, si elle n’a pu lever à cause de la sécheresse, ou parce que la terre avait été trop battue par des orages considérables ; de plus, la luzerne tale beaucoup et s’étend d’une manière étonnante, lorsqu’elle est cultivée avec soin et nettoyée d’herbes. J’ai vu une pièce de luzerne frappée de la grêle, et dont on désespérait, reprendre l’année d’ensuite et devenir encore assez bonne.
[101]
Choix de graines.
Je ne puis quitter cet article sans recommander qu’on choisisse, avec grand soin, les graines de sainfoin, luzerne et trèfle. Les plus chères sont toujours les meilleurs marchés, parce que les inférieures, qu’on a à bas prix, manquent souvent et rendent inutiles les frais de culture. Qu’on choisisse donc une graine bien nette d’herbe, bien ronde, qui n’ait pas reçu d’eau, et qui soit surtout bien mûre ; car on ne peut jamais rien attendre d’une semence qui n’est pas à son degré de maturité.
Quarantain.
Je conseille de pourvoir à la provision d’huile en destinant au quarantain (autrement navette d’été) un petit coin de terre d’environ un arpent, et à proximité de la maison. Il serait bon que ce fût un endroit séparé et toujours le même, qu’on aurait soin tous les ans de bien fumer et cultiver pour cet usage ; et cela pour deux raisons : afin de ne pas envoyer, dans les terres voisines, cette graine qui vole fort loin, et dont il faut très-peu pour former plusieurs tiges ; afin aussi de ne pas infester plusieurs endroits d’une graine qui épuise la terre, et repousse quelquefois abondamment dans les grains qui lui succèdent. Le quarantain [102] ne doit pas être semé avant le 10 Mai, de manière qu’il fleurisse vers le 20 Juin ; ce qui forme quarante jours jusqu’à sa floraison, et lui a fait donner le nom de quarantain. La terre doit être labourée de bonne heure et rendue bien meuble par le moyen des hersages ; lorsqu’elle sera bien préparée, on pourra, pour la féconder, y jetter des poulinées, comme je l’ai toujours pratiqué avec succès ; ces poulinées sont ensuite recouvertes par un léger labour, suivi d’un hersage et d’un ploutrage, qu’on réitère jusqu’à ce que la terre soit la plus menue possible : on sème ensuite le quarantain, à la quantité d’une pinte pour un arpent ; plus cette graine est semée clair, plus elle devient belle, haute et cossue.
Bestiaux.
Vaches.
Vers la mi-Mai la luzerne est assez forte ordinairement pour en donner aux vaches ; il faut donc, à cette époque, les mettre tout-à-fait au vert, leur faire faucher de la luzerne, et les mettre matin et soir dans un pré pour y pâturer. Rien ne fait tant de bien aux vaches que le pâturage, rien ne contribue tant à leur bonne santé. Il faut avoir soin de ne pas faucher la luzerne à la rosée ou quand il a plu, de peur de leur donner [103] des coliques ; par conséquent, quand il fait beau, on ferait bien d’en faucher pour deux ou trois jours, en ayant attention seulement de délier la luzerne et de l’étendre dans des endroits frais, de peur qu’elle ne s’échauffe.
Soins des veaux.
Dans quelques pays, on laisse le veau avec la mère, mais c’est un usage qui me paraît avoir beaucoup d’inconvéniens ; d’abord l’animal, accoutumé à téter sa mère, ne peut plus le quitter lorsqu’on veut le sévrer, au bout de six semaines, pour profiter du lait, et ne peut plus s’accoutumer à boire un lait étranger mêlé avec de l’eau tiède. D’un autre côté, si on veut l’engraisser, le lait de sa mère ne lui suffit pas, et cependant on ne peut aisément lui en donner d’autre. La meilleure méthode est donc d’éloigner le veau de sa mère aussi-tôt sa naissance, et de le nourrir suivant l’usage auquel on le destine. Dans les pays où l’on ne se sert pas de boeufs, on n’élève que les génisses dont la structure et la force font espérer qu’elles seront un jour bonnes laitières ; alors on ne leur donne que pendant trois semaines le lait de leur mère, tout chaud, et on le coupe ensuite avec de l’eau tiède, en augmentant peu-à-peu la quantité de l’eau, jusqu’à ce que la bête soit en état de manger du fourrage, ce qui arrive [104] entre deux ou trois mois. Ceux qu’on destine au boucher sont nourris avec plus ou moins de soin suivant la localité. Dans les pays renommés pour le beurre ou le fromage, on ne nourrit le veau que huit jours, pour profiter plus promptement d'un lait dont on tire tant de profit. Dans ceux où l’on fait des veaux pour la capitale, on les nourrit deux ou trois mois, en leur donnant du lait chaud en aussi grande quantité qu'exige leur appétit, et en y mêlant même des jaunes d'œuf, pour leur donner une substance plus forte et plus délicate. Dans les pays, au contraire, trop éloignés de la capitale ou des grandes villes, pour faire des veaux gras, on ne nourrit jamais un veau plus de six semaines, en lui donnant, les trois premières semaines, le lait de sa mère, et les trois dernières, celui de deux vaches.
Maladies des veaux.
Les veaux sont sujets à deux maladies opposées, le flux de ventre et la constipation. Pour le premier mal, prenez une pinte de lait récemment tirée; faites-y bouillir une poignée de mauve ; passez le tout à travers un linge; mêlez-y deux gros de réglisse, deux gros de graine d'anis, une once de thériaque, une once de beurre frais; mêlez le tout ensemble, et donnez cette potion en deux fois, matin et soir. Pour la [105] constipation, prenez de la rue, de la petite centaurée, de l'éclaire, chacun une poignée, faites-les bouillir dans cinq pintes d'eau, pendant un quart-d'heure, avec trois litrons d'orge; pressez les herbes, et ajoutez-y quatre onces de fleurs de soufre et de garance, deux onces de graines d'anis, deux onces de réglisse ; mêlez le tout ensemble; faites-en cinq parties pour cinq veaux, qui cesseront alors d'être resserrés[N 4][C 4]. On prétend aussi que deux ou trois doses d'éther vitriolique, mêlés dans du vin, arrêtent le dévoiement des veaux. Je renvoie, pour ce détail, à la Feuille du Cultivateur du 26 Mai 1792.
Moutons.
Les moutons doivent alors recevoir une nourriture meilleure et plus abondante, afin de pousser plus de suint, et d'avoir des toisons plus lourdes. Ordinairement on les tond vers la mi-Mai, afin que leur laine soit un peu poussée quand on les mettra au parc. Il faut choisir un tems chaud pour les tondre ; car on sent quelle différence ce doit être pour eux d'être sans habit. Aussi faut-il prendre garde à les faire sortir lorsqu'il fait froid, de peur qu'ils ne périssent, ou qu'ils ne gagnent des maladies. Certaines personnes reculent la tonte [106] de leurs bêtes, afin que les toisons soient plus lourdes. Ils gagnent sur le poids de leur laine, mais ils perdent sur la qualité de leurs moutons, qui dépérissent quand ils ont dans les chaleurs une laine accablante, et souffrent beaucoup au parc, quand ils y vont étant nouvellement tondus. Il y a aussi des gens qu'un vil intérêt mène encore plus loin : ils tiennent, les quinze derniers jours, leurs moutons dans une étable très-chaude dont ils ne les font sortir que quelques instans. Cela est on ne peut pas plus malsain pour les moutons, et peut leur occasionner plusieurs accidens.
Maladies des moutons.
L’art du cultivateur consiste plus à prévenir les maladies qu'à les guérir. Les accidens des animaux viennent presque toujours de la faute du propriétaire ; j'en excepte pourtant les épidémies qu'on ne peut ni prévenir ni éviter ; mais hors ce cas, qui heureusement est rare, il est très-facile d'éviter aux bêtes à laine un grand nombre d’incommmodités. Leurs causes les plus ordinaires sont, 1°, l'ignorance des bergers, qui les mènent dans des pâturages malsains ou trop humides, fatiguent le troupeau par de longues courses, ou le harcèlent continuellement avec leurs chiens ; 2°, la cupidité de ces mêmes bergers, qui s'obstinent à parquer dans des tems pluvieux ou humides, ou [107] à laisser leur troupeau exposé à l’ardeur du soleil pendant la plus grande chaleur du jour ; 3°, le peu d'attention du propriétaire à n'acheter que des bêtes bien saines, afin qu'elles n'infectent pas le troupeau ; 4°, l'insouciance de ceux qui renferment leurs bêtes dans des endroits peu spacieux et peu aérés, et ne tiennent pas la main à ce qu'on en enlève souvent le fumier. Qu'on évite toutes ces causes de maladies, et rarement on sera obligé de recourir aux remèdes. Je vais en indiquer pour les maladies les plus communes, telles que la gale, le claveau, le tournoiement. On ne me saura pas mauvais gré, j’espère, d'avoir encore pris ces remèdes dans le Guide du Fermier : le mérite de l’auteur (Arthur Young) m'a porté à lui donner la préférence.
La gale, qui est le produit d'un mauvais pâturage, d'une trop grande humidité ou d'une chaleur excessive, se découvre lorsque le mouton frotte la partie incommodée contre tout ce qu'il rencontre. On le tond dans l'endroit infecté, on le lave ensuite avec un peu d'alun ; et lorsqu'on l'a épongé, on le frotte avec de l’onguent fait avec une demi-livre de lard non salé et une demi-livre de beurre frais. Comme cette maladie se communique, il faut séparer l'animal qui en est atteint, et jetter un peu de sel sur son fourrage. Virgile conseille un onguent fait avec du vif-argent, de [108] la résine , du bithume noir et du marc d'olive. Si le mal résiste, il veut que
| L'acier sagement rigoureux | ||
| S’ouvre au fond de l’ulcère un chemin douloureux. | ||
| Trad. des Georg. liv. III.[10] |
- Le Claveau.
Cette maladie se signale par de petits boutons de couleur rouge ou pourprée qui percent la peau. Séparez sur-le-champ du troupeau les moutons qui en sont infectés, lavez les pustules avec une décoction de trois onces de feuilles de romarin bouilli dans une chopine de fort vinaigre 5[N 5][C 5].
- Le tournis ou tournoiement.
Cet accident n'arrive guère que dans les grandes chaleurs et aux agneaux qui, étant plus délicats, en sont plus susceptibles. Les bêtes qui en sont frappées, ne font que tourner et sauter sans songer à manger. Cette maladie, qui est presque toujours un épanchement dans le cerveau, se guérirait si on savait appliquer le trépan à l’endroit convenable ; mais c'est trop demander aux habitans des campagnes, et le remède le plus sûr est [109] de saigner promptement l’animal à la veine sous l’œil, ou à la veine qui est sur le nez : cela ne dispense pas, pour tirer plus de sang, de lui couper les deux oreilles par le milieu. Il faut après cela le ramener à la maison et lui faire manger des bettes sauvages[N 6][C 6].
Vente et acquisition de moutons.
Le mois de Mai est une époque assez favorable pour renouveller ses moutons. Il est bon alors de vendre les vieux ; et comme ils se vendent toujours plus cher que les autres, d'en acheter une plus grande quantité de jeunes, qu'on met au parc, et dont on vend, avant l'hiver, ceux dont on n'a pas besoin, plus cher qu'ils n'ont coûté, et sans qu'ils aient rien dépensé. Quant aux vieux, il ne faut pas attendre, pour s'en défaire, qu'ils aient tout poussé, car on les vend alors moins avantageusement, parce que l'acquéreur craint de ne pouvoir gagner dessus. Le moment auquel les moutons engraissent plus aisément, est entre six et huit dents : c’est donc là le tems de s'en défaire, pour acheter des antenois. Qu’on choisisse, [110] le plus qu'on pourra, de belles espèces : il vaut mieux payer un mouton trente sous de plus, que d'acheter une bête petite qui suffit pour défigurer un beau troupeau.
Ploutrer les avoines.
Dans les premiers jours de Mai, il faut ploutrer les avoines, c’est-à-dire, renverser la herse et applanir avec le dos les mottes, afin que l’avoine profite mieux. Il suffit pour cela que la terre ne soit ni trop humide, ni trop sèche ; pas trop humide, pour que l’avoine ne soit pas arrachée par la herse ; pas trop sèche, pour que les mottes puissent se briser et chausser, comme l’on dit, l’avoine. Si les mottes ne se brisaient pas, il faudrait mettre un traînoir sur la herse pour mieux les écraser.
Soins de la ménagère.
Volailles.
On trouvera aux mois de Mars et Avril, la manière d’élever et de faire couver les volailles, comme dindons, oies, canards, poulets ; si les couvées n'ont pas été abondantes dans ces deux mois, qu’on les continue encore en Mai, qyi est le dernier mois où je conseille de faire couver, parce que les petits qui viennent si tard restent [111] toujours faibles, n'étant pas assez avancés lorsque îes froids et les pluies d'automne arrivent.
Éducation des dindons.
Quand les dindons sont éclos, on les nourrit avec des orties et des jaunes d'œuf les quinze premiers jours ; au bout de ce tems, on diminue peu à peu les œufs, jusques à six semaines, époque à laquelle on leur retranche entièrement cette nourriture. Il est d'expérience qu'une trop grande quantité les échauffe et les fait devenir tortus et bancals. Il faut avoir soin de ne pas laisser les petits dindons à la grande chaleur ni au grand froid ; ces deux contraires leur sont également nuisibles. On regarde le piaulement des dindonnaux, comme une marque qu'ils viennent bien ; dans le fait, ceux qui sont faibles crient infiniment moins que les autres. Qu'on leur pardonne donc leur piaulement insupportable, puisque chez eux c'est un signe de santé.
Laiterie.
L'occupation la plus intéressante de la maîtresse de la maison, c'est la laiterie ; les vaches donnant beaucoup dès quelles sont au vert, elle a le plus grand intérêt à surveiller tout ce qui regarde le lait, le beurre et le fromage. La [112] propreté, l’arrangement et l'exactitude sont sur-tout nécessaires pour réussir dans cette partie ; ici les plus petits détails ne sont pas à négliger : il y en a qui croient que leurs soins ne doivent commencer que lorsque le lait est dans la laiterie ; il est cependant essentiel de veiller de quelle manière on le trait et on le transporte.
La première précaution c'est de tenir très-propres les seaux de bois qui servent à la traite, de les laver à l’eau bouillante dès qu'ils ont servi, et de les serrer de manière qu'ils ne puissent servir à d'autres usages, sous quelque prétexte que ce soit. Le premier ouvrage des servantes, après leur lever, doit être de nettoyer leurs mains pour traire les vaches, de porter ensuite de l’eau tiède dans la vacherie pour bien laver le pis et les trayons, autrement le lait est plein d'ordures et de saletés : cette première occupation faite, elles prendront un petit escabeau pour s'asseoir, et trairont chaque vache jusque ce qu'elles en aient exprimé tout le lait. A mesure que leur seau sera plein aux deux tiers, elles verseront le lait dans une grande cuvette garnie d'un couvercle qui la défende de toute ordure, ainsi que de l’approche des chats ; il faut sur-tout ne pas mêler dans cette cuvette, destinée à porter toute la donne, le lait de mauvaise qualité.
Le lait d’une vache malade ou nouvellement [113] vélée, n'est pas si bon et doit être mis à part, pour ne pas gâter l'autre, et on peut en faire des fromages pour être mangés tout de suite. Le bon lait doit avoir le saveur douce, la consistance pas trop épaisse, ni trop claire, et telle qu'une goutte de lait, mise sur l’ongle, n'en coule point[N 7][C 7].
Gouvernement du lait.
Le lait rendu à la laiterie, on puise avec un plateau de bois dans la cuvette, et on le verse dans chaque terrine, en le passant au travers d'un tamis fait exprès, dit couloir. La plus grande propreté est essentielle pour toutes ces terrines, qu'on arrange sur un terrinier ou chantier à plusieurs étages, chacune en leur ordre, en commençant par le bas ; ce qui vaut infiniment mieux que de laisser les terrines sur le sol de la laiterie. Tous les matins on visite les terrines pour écrêmer le lait ; afin de connaître bien le moment où la crême est à son point, il faut y passer légèrement le bout du doigt sur la superficie ; s'il ne tient rien au doigt, la crême a acquis sa consistance. On prend alors toutes les terrines parvenues à cet état, on les incline doucement au-dessus du vaisseau dans [114] lequel on veut recevoir le petit-lait, en empêchant, au moyen des deux pouces qu'on tient sur le bord de la terrine, que la crème ne s'en échappe avec le petit-lait ; la crème ainsi enlevée de dessus le lait, on la met dans un vaisseau de terre vernissé jusqu'au jour où on doit battre le beurre.
Beurre.
Douze pintes de lait font à-peu-près deux livres de beurre ; l'on saura, d'après cela, la quantité de beurre qu'on peut faire par semaine. Pour avoir du beurre agréable à manger, il faut prendre de la crème douce et nouvelle ; mais il n'est pas de garde lorsqu'on laisse aigrir la crème, au lieu qu'il se garde long-tems avec les précautions nécessaires en le battant. Le beurre n'étant autre chose que le résultat de la séparation des parties huileuses et aqueuses de la crême, doit être battu d'une manière uniforme et modérée ; uniforme, parce que si on cessait de battre, les parties huileuses et aqueuses se réuniraient ; modérée, parce que le beurre qui provient d'une crème battue trop promptement fermente et prend un mauvais goût. En été, il faut absolument battre le beurre de grand matin et à la fraîcheur, parce que la chaleur empêche le beurre de se séparer de la crême. Si une demi-heure après qu'on a commencé à battre, le beurre ne venait pas, on n'a [115] qu'à mettre dans la baratte du lait tout chaud venant du pis de la vache, ou bien on fait bouillir de l'eau nette, qu'on met avec la crème, observant que l'eau ne soit pas trop chaude. Si c'est par trop de chaleur que le beurre ne vient pas, il faut rafraîchir le battoir dans l'eau froide.
Quand le beurre est tout venu, ce qu'on reconnaît quand il est bien en grain, et que le lait-de-beurre, devenu clair, ne s'attache plus du tout au couvercle de la baratte, on le ramasse tout ensemble dans une cuvette, pour en extraire le lait-de-beurre et l'eau, le laver dans de l'eau fraîche éclaircie plusieurs fois, et le pétrir jusqu'à ce que l'eau qui en sort soit aussi claire et aussi limpide que quand on l'a prise ; plus le beurre sera foulé et retouché, plus il acquerra de qualité, sur-tout pour la garde.
Manière de conserver le beurre pour l'hiver.
Ce n'est pas assez que de savoir faire de bon beurre, il faut encore savoir le conserver pour l'hiver. Le meilleur pour cet usage est celui qui se fait pendant que les vaches se nourrissent de la seconde herbe. Quand le beurre, en été, se trouve trop mou, on le raffermit en le descendant pendant vingt-quatre heures dans un puits, à peu de distance de l'eau ; il prend alors la consistance dont il a besoin : cela n'empêche pas de le saler [116] à la quantité d'une livre de sel pour douze livres de beurre. La meilleure façon de le saler est de le pétrir avec le sel : on se contente quelquefois de le couvrir d'une forte saumure, à deux pouces de hauteur ; mais la saumure ne pouvant pénétrer par-tout, le beurre coure risque de se gâter. Quand le beurre est ainsi salé, on le met dans de grands pots de grès, qu'on a soin de placer dans des endroits frais, pour qu'il se conserve.
Fromage.
Pour faire du fromage, il faut se pourvoir d'abord d'une bonne présure, qui n'est autre chose que la panse du veau, autrement dite poche ou mulette, qu'on remplit de lait caillé. Pour que la présure soit bonne, il faut que le veau ait cinq ou six semaines, et qu'on le fasse bien boire trois ou quatre heures avant de le tuer, afin que le lait caille dans son estomac. Aussi-tôt qu'on a cette mulette, on en ôte le lait caillé, on le lave ainsi que la mulette qu'on essuie ; on sale le caillé, et cette même mulette, en dedans et en dehors ; on y remet alors le lait caillé et en laisse le tout dans le sel pendant trois ou quatre jours, après quoi on la suspend pour la faire sécher. Je ne parlerai pas de toutes les diverses espèces de fromages qui se multiplient à l'infini : chaque pays a ses usages que le sol et la localité [117] déterminent. Quant au fromage commun, la manipulation n'est pas difficile ; lorsqu'on n'en fait que pour la maison, on prend seulement du lait écrémé qu'on mêle dans un peu de présure, et qu'on met ensuite dans un caseret, lorsqu'il est caillé, pour le laisser égoutter : les mêmes fromages se salent pour l'hiver, et se mettent sur une claie où ils se conservent jusqu'au moment qu'on en a besoin
Poiriers et pommiers en fleurs.
Les poiriers fleurissent beaucoup avant les pommiers, mais aussi craignent-ils davantage la gelée, et y sont-ils plus sujets, parce qu'ils sont plus avancés : les pommiers fleurissent plus tard et craignent moins la gelée et le froid ; ce qu'ils redoutent le plus, ce sont les brouillards qui resserrent la fleur, l'empêchent de s'épanouir, et y forment un ver qui en mange l'étamine. On sera sûr d'avoir beaucoup de pommes, lorsque les fleurs s'épanouiront bien et que les arbres neigeront, c'est-à-dire qu'ils seront bien blancs et que le dessous de l'arbre sera couvert des fleurs qui tomberont ; si, au contraire, on ne voit pas les arbres blancs comme neige, et les fleurs couvrir la terre, il n'y aura pas de fruits ou au moins très-peu.
Je ne parle pas des vignes, parce que j'aime mieux me taire que de parler de ce que je n'ai point vu ou pratiqué.
Notes
Notes originales et commentaires
Dans la suite de cette rubrique, sont associées (ligne par ligne) deux éléments complémentaires : les notes originales, telles qu'elles figurent dans l'ouvrage de Chrestien de Lihus (y compris lorsque la recherche montre des inexactitudes), et qui sont intangibles, et les notes additionnelles, issues des recherches effectuées pour compléter les informations lors de la mise en ligne ici, et qui peuvent être amendées par tout contributeur, à l'unique condition d'être précis dans les sources utilisées.
| Notes originales (issues de l'ouvrage original) | Notes complémentaires (du contributeur "wicrifieur") |
|
|
Notes additionnelles
- ↑ La citation est extraite des Géorgiques, de Virgile, mais non du livre I, comme indiqué, mais du livre II, vers 336 à 338. Texte intégral (traduction J. Delille) sur le site remacle.org.
- ↑ Cette expression désigne Virgile. Voir à ce sujet les Études sur Virgile, tome III, page 132, de Pierre-François Tissot (1828, Paris). Texte intégral sur Gallica.
- ↑ Extrait non identifié.
- ↑ Extrait non retrouvé dans le Théâtre d'agriculture et mesnage des champs.
- ↑ Extrait non identifié.
- ↑ Extrait non identifié.
- ↑ Citation extraite du Théâtre d'agriculture et mesnage des champs, Olivier de Serres, chapitre VII, p. 70. Texte intégral sur Gallica.
- ↑ Citation extraite de De Re Rustica, livre X, titre I, de Palladius. Texte intégral sur Gallica (version bilingue latin - français, traduction de M. Cabaret-Dupaty, p. 328). Traduction :
"Un sol aqueux en demande plus qu'un sol sec". - ↑ Dans la suite du texte, il est indiqué que le terme "quarantain" désigne la navette d’été.
- ↑ Les Géorgiques, livre III, vers 452 à 454. Texte intégral sur remacle.org (traduction de J. Delille).