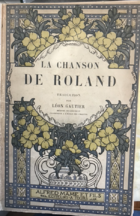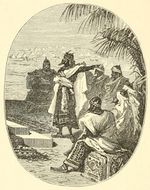La Chanson de Roland/Léon Gautier/Édition populaire/1895/Introduction/Conclusion : Différence entre versions
(→Voir aussi) |
(→Quelques mots sur cette vingt-deuxième édition - Conclusion) |
||
| (Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 37 : | Ligne 37 : | ||
(''Ruodlandes Liet'') et néerlandaise, il y a trois familles ou, pour | (''Ruodlandes Liet'') et néerlandaise, il y a trois familles ou, pour | ||
tenir un langage plus exact, trois groupes de manuscrits qui sont | tenir un langage plus exact, trois groupes de manuscrits qui sont | ||
| − | représentés par le texte d'Oxford, par celui de Venise (fr. IV) et | + | représentés par le texte d'Oxford, par celui de [[A pour manuscrit cité::Chanson de Roland/Manuscrit de Venise 4|Venise (fr. IV)]] et |
par le ''Roman de Roncevaux ''<ref>C'est sous ce dernier nom, comme on l'a dit plus haut, que l'on désigne | par le ''Roman de Roncevaux ''<ref>C'est sous ce dernier nom, comme on l'a dit plus haut, que l'on désigne | ||
aujourd'hui les remaniements du ''Roland''. </ref>. | aujourd'hui les remaniements du ''Roland''. </ref>. | ||
| Ligne 86 : | Ligne 86 : | ||
gravures, exécutées avec la plus rigoureuse précision, reproduisent les principales pièces du costume de guerre aux {{XIe}} et | gravures, exécutées avec la plus rigoureuse précision, reproduisent les principales pièces du costume de guerre aux {{XIe}} et | ||
{{XIIe}} siècles. C'est la première fois que les « images » paraissent en | {{XIIe}} siècles. C'est la première fois que les « images » paraissent en | ||
| − | cet endroit : et peut-être serait -il à désirer que cet exemple fût | + | cet endroit : et peut-être serait-il à désirer que cet exemple fût |
suivi pour les classiques latins et grecs. | suivi pour les classiques latins et grecs. | ||
| Ligne 93 : | Ligne 93 : | ||
Notre œuvre cependant ne nous satisfait qu'à moitié, et nous | Notre œuvre cependant ne nous satisfait qu'à moitié, et nous | ||
| − | la souhaiterions encore plus vulgarisatrice. Nous ne serons | + | la souhaiterions encore plus vulgarisatrice. Nous ne serons heureux que le jour où nous verrons le Roland circuler entre les |
| − | |||
mains de nos ouvriers, de nos paysans, de nos soldats. | mains de nos ouvriers, de nos paysans, de nos soldats. | ||
| Ligne 114 : | Ligne 113 : | ||
Elle ne mourra point, et c'est avec un espoir immense que je | Elle ne mourra point, et c'est avec un espoir immense que je | ||
redis, depuis dix ans bientôt, ce beau vers de la vieille chanson : | redis, depuis dix ans bientôt, ce beau vers de la vieille chanson : | ||
| − | ''Tere de France, mult estes dulz païs.'' | + | ''Tere de France, mult estes dulz païs.'' <ref group="NDLR">[[Chanson de Roland/Manuscrit d'Oxford/Vers 1861|Vers 1861 du manuscrit d'Oxford]]</ref> |
Et je m'empresse d'ajouter : ''Damnes Deus Père, nen laissier hunir France !'' | Et je m'empresse d'ajouter : ''Damnes Deus Père, nen laissier hunir France !'' | ||
Version actuelle datée du 3 septembre 2022 à 15:21
Cette page termine l'Introduction de la traduction de la Chanson de Roland, réalisée par Léon Gautier
Sommaire
Le texte original
Quelques mots sur cette vingt-deuxième édition - Conclusion
Notre rêve, depuis vingt ans, était de donner au public une édition sincèrement populaire de la Chanson de Roland. Quant à rêver une édition à l'usage des classes, notre ambition n'allait pas jusque-là. Mais la réaction en faveur du moyen âge a marché plus vite que les plus téméraires n'eussent osé le désirer, et nous étions bien inspiré d'écrire en 1875 :
- « Il n'est pas aujourd'hui trop hardi d'espérer que le vieux poème national sera bientôt entre les mains des élèves de seconde et de rhétorique. »
Aussi n'avons-nous pas hésité à refondre et, pour parler plus exactement, à recommencer nos éditions antérieures pour rendre celle-ci plus digne de son nouveau public. Il nous sera peut-être permis de dire que ce livre est un livre nouveau.
Dans cette Introduction, nous avons eu pour but de faire, en quelques pages, tout l'historique, et, pour ainsi dire, toute la biographie de la Chanson. Ces quarante pages, ce sont les éléments de la question ; c'est ce que tout Français est obligé de connaître ; c'est ce que des femmes et des enfants seront aisément capables de comprendre.
Ce qui nous a coûté les plus longs, les plus pénibles labeurs, c'est le texte critique, dont nous offrons ici la traduction populaire. Il y a dix ans que nous y travaillons sans relâche.
Nous avons résolument adopté la méthode critique, laquelle consiste, dès que nous possédons trois familles de manuscrits, à faire entrer dans notre texte la leçon qui nous est fournie par deux d'entre elles contre la troisième. Or, à nos yeux et sans parler des familles nordique (Karlamagnus Saga), allemande (Ruodlandes Liet) et néerlandaise, il y a trois familles ou, pour tenir un langage plus exact, trois groupes de manuscrits qui sont représentés par le texte d'Oxford, par celui de Venise (fr. IV) et par le Roman de Roncevaux [1].
C'est avec ces trois familles que nous avons composé notre texte critique.
Nous n'avions pas, dans nos premières éditions, adopté un système aussi rigoureux, aussi précis. Mais nous n'avons pas hésité, pour améliorer notre œuvre, à nous remettre à la tâche. Sur notre table de travail, nous avons placé ces trois éléments nécessaires de notre nouveau labeur : l'édition paléographique du texte de Venise IV, qui a été récemment donnée par M. Kœlbing; l'édition paléographique du manuscrit d'Oxford, qui vient d'être publiée par M. Stengel et qu'il a pris soin d'accompagner d'un fac-similé complet, et enfin le texte des remaniements de Paris, Versailles, Cambridge et Lyon.
Et généralement nous avons adopté la leçon qui nous est fournie par Oxford et Venise contre Roncevaux; par Oxford et Roncevaux contre Venise IV ; par Venise IV et Roncevaux contre Oxford.
Même il nous a fallu nous montrer plus hardi et faire subir parfois à notre texte quelques corrections et additions, d'après une seule famille de manuscrits, lorsque les autres familles nous faisaient défaut et quand d'ailleurs la nécessité de ces rectifications paraissait nettement démontrée. Ce sont là des hypothèses, sans doute, mais qui sont véritablement scientifiques et dont nos lecteurs demeurent les juges. Nous imprimons en italiques tout ce que nous avons ajouté au manuscrit d'Oxford et tout ce que nous y avons corrigé. Nous avons même pris le soin de ne pas assigner de numéros d'ordre aux vers nouveaux que nous introduisons dans notre texte, et il est à peine utile d'ajouter que nous donnons toujours en note la leçon exacte du Roland de la Bodléienne.
Nous avons revu notre traduction. Il y a, dans l'interprétation de toute œuvre poétique, deux qualités qui sont difficilement conciliables : le Rythme et la Couleur. Les traductions en vers conservent aisément le rythme de l'original ; les traductions en prose le sacrifient, mais peuvent au moins prétendre à conserver le coloris de leur modèle. C'est ce que nous aurions voulu faire.
Au bas des pages, nous avons placé un Commentaire qui est réservé à toutes les observations historiques, archéologiques et littéraires. Afin de le rendre accessible à toutes les intelligences, nous en avons banni la philologie, qui trouvera ailleurs la place à laquelle elle a tant de droits. Pour être ici plus facilement popu- laire, nous n'avons pas craint de faire appel à l'image : de petites gravures, exécutées avec la plus rigoureuse précision, reproduisent les principales pièces du costume de guerre aux XIe et XIIe siècles. C'est la première fois que les « images » paraissent en cet endroit : et peut-être serait-il à désirer que cet exemple fût suivi pour les classiques latins et grecs.
Telle est cette édition du Roland, qui est destinée aux gens du monde, aux enfants et aux femmes : l'ennui en a été aussi soigneusement écarté que les épines d'un bouquet.
Notre œuvre cependant ne nous satisfait qu'à moitié, et nous la souhaiterions encore plus vulgarisatrice. Nous ne serons heureux que le jour où nous verrons le Roland circuler entre les mains de nos ouvriers, de nos paysans, de nos soldats.
Rien n'est plus sain que cette lecture de la plus ancienne de nos Chansons de geste, et, comme nous l'avons dit ailleurs, rien n'est plus actuel.
Qu'est-ce après tout que le Roland, si ce n'est le récit d'une grande défaite de la France, que la France a glorieusement vengée?
La défaite ! nous venons d'y assister. Mais nous saurons bien la réparer un jour par quelque grande et belle victoire.
Il n'est vraiment pas possible qu'elle meure, cette France de la Chanson de Roland, celle France malgré tout si chrétienne.
Elle ne mourra point, et c'est avec un espoir immense que je redis, depuis dix ans bientôt, ce beau vers de la vieille chanson : Tere de France, mult estes dulz païs. [NDLR 1]
Et je m'empresse d'ajouter : Damnes Deus Père, nen laissier hunir France !
LÉON GAUTIER
Notes originales
- Notes
- ↑ C'est sous ce dernier nom, comme on l'a dit plus haut, que l'on désigne aujourd'hui les remaniements du Roland.
Facsimilé

|

|

|
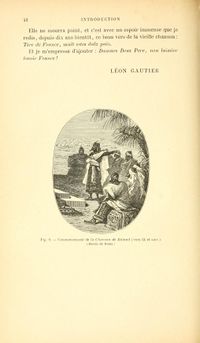
|
Voir aussi
- Notes de la rédaction