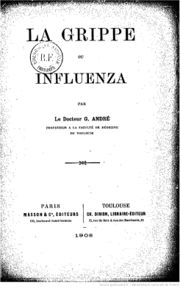La grippe ou influenza (1908) André/Bactériologie
Bactériologie et Anatomie pathologique
|
Cette page introduit un chapitre de l'ouvrage La grippe ou influenza, rédigé en 1908 par Gustave André.
Sommaire
Bactériologie et Anatomie pathologique
Les microbes de la grippe
Nous passerons tout d'abord en revue les diverses recherches bactériologiques tentées par un premier groupe d'expérimentateurs; cette énumération présente actuellement un intérêt véritable, car la notion d'un micro-organisme unique ou prépondérant perd aujourd'hui du terrain, comme on a pu le pressentir au début de ce travail, Cela résulte notamment des recherches délicates entreprises récemment dans le laboratoire du Professeur Cornil, par le Dr F. Bezançon et son interne Israëls de Jongh. Un fait capital a frappé ces deux savants : c'est, dans les circonstances où ils se trouvaient en ce moment, l'extrême rareté des cas où on rencontrait une seule espèce et lo fait presque constant d'associations microbiennes, Le rôle de ces divers microbes serait d'ailleurs secondaire et, pas plus que celui de Pfeiffer, ils ne mériteraient un brevet do spécificité (Soc. médic, des Hop., mars 1908).
Déjà, en 1883, Seifert, de Wurtzbourg, avait re- trouvé, dans le mucus nasal et bronchique de ma- lades atteints de grippe, des microcoques isolés, mais le plus souvent groupés deux à deux, parfois associés en chaînettes et mesurant de 1,5 à 2 a de longueur et 1 ^d'épaisseur. Ces organismes étaient colorés par le violet de méthyle,
En décembre 1889, Adolph Jolies, de Vienne, rencontra dans les crachats de grippés des mi- crocoques encapsulés ressemblant beaucoup au diplocoque pneumonique de Fricdlandcr. Co même micro-organisme encapsulé fut retrouvé dans les urines de ces malades, Des cultures sur plaques, servant à inoculer des tubes de gélatine, permirent d'obtenir des colonies en forme-de clou, comme celle que décrit Frledlandor; mois la partie saillante de la tète du clou élait moins brillante et plus granuleuse, Il existerait encore quelques différences entre les cultures du diplo- coque de Frledlandor et celles de Jolies, L'eau do l'aqueduc dé Vienne recelait cet organisme en assez grande quantité.
En 1890, Klcbs, de Zurich, décrivit les hémato- zoaires de l'influenza. H no s'agissait pas de bacilles, mais d'organismes plus relevés, lo Rhy- zomastigma, de la famille des monades. Autour des globules rouges, on pouvait voir, au micros- cope, de petits corps doués do mouvements rapides, très brillants, et qui, par leurs dimensions,
leur forme et leur mouvement, rappelaient ceux décrits précédemment par lui dans l'anémie per- nicieuse vraie. Ces organismes seraient des fla- gellés, c'est-à-dire des protozoaires munis d'un filament. Il faut bien dire que l'existence de cet hématozoaire fut tout aussitôt révoquée en doute.
Kirchner, de Berlin, aurait rencontré, dans les sécrétions bronchiques de trente malades, une diplobactérie, d'apparence encapsuléo, dont le rôle pathogène serait réel, comme l'inoculation chez le lapin semblait le démontrer.
Il faut citer encore les recherches de Finkler et de Ribbert qui attribuent les troubles de la grippe aux toxines d'un streptocoque possédant complè- tement les attributs du streptocoque de l'érysi- pèlo.
Wetchsolbaum a rencontré dans les crachats de dix-huit malades un diplocoque encapsulé ressem- blant beaucoup à celui de Talamon-Framkel, tant sous le microscope que dans les cultures. Pour- tant, cet organisme serait loin d'avoir la virulence du pneumocoque. On aurait retrouvé ce diploco- que dans l'urine provenant d'une néphrite grip- pale, dans le pus d'une sinusite et dans plusieurs otites,
inoculés au cobayo, ont provoqué une inflam- mation pleurale.
Citons pour mémoire le travail do Fischel qui rencontra deux espèces de diplocoques se dévelop- pant sur la gélatine.
Vaillard et Vincent (Soc. méd, des Hôp., 1890), pratiquant l'examen des viscères, du sang, etc., aussitôt que possible après la mort, des crachats et des épanchements pleuraux pendant la vie, croient avoir démontré, sans exception, la pré- sence d'un strejnocoque toujours identique à lui- même et bien spécifié au point de vue morpholo- gique, Les deux savants se demandent, sous oser l'affirmer, si cot organisme est'bien la cause uni- que de la grippe. Netter, à la mèmcépuque, put déceler la présence, dans certains cas, du pneumo- coque associé au stroplococcus pyogènes, dans d'uulres du bacille de Frledlandor ù l'état de culture pure. Ces microbes, déclare-t-il, no peu- vent être considérés comme les agents pathogènes de la grippe; « le pneumocoque et le streptocoque « se rencontrent normalement dans la bouche de « sujets sains, lis acquièrent sans doute, au cours « gémirent des infections secondaires ».
La bactérie que Babès, do Bucarest, a ren- contré dans quelques cas de bronchite grippale, a été désignée par ce savant sous le nom de bactérie du mucus, Mais, dans le plus grand nombre
de cas, c'est encore du pneumocoque qu'il s'agissait.
Le Professeur Ch. Bouchard (Acad. de Môdi, 1890) a rencontré trois microbes pathogènes, deux de trop, dit-il lui-même. Il s'agit encore d'habi- tants naturels de nos cavités et qui, sous l'in- fluence de la grippe, ont pu, selon son opinion, franchir les barrières qui,.d'ordinaire, les empê- chent de pénétrer dans nos tissus où dans le sang. L'émincnt observateur a trouvé, dans les affections secondaires suscitées par la grippé, le staphylo- coque pyogène (herpès labial), le pneumocoque dans certaines pneumonies et dons quelques oti- tes, le streptocoque surtout dans le pus bronchi- que, dans les crachats pneumoniques, dans le liquide des pleurésies suppurées, dans la ménin- gite, dans certaines arthrites et dans les amygda- lites de lo grippe. Ce streptocoque, injecté dans le tissu cellulaire de l'oreille du lapin, produit un érysipèle manifeste avec suppuration, Ce fait, qui met en relief l'érysipèle parmi les complications de la grippe, fait comprendre l'existence simulta- née assez fréquente des épidémies de grippe et d'érysipèle.
Les pneumoniesdllesgrippulesseraleiil, d'après Ch. Bouchard, des pneumonies vulgaires et non des pneumonies spécifiques, Cela parait certain ; néanmoins, comme l'a fait remarquer Nolhnagel, la grippe ctlo pneumonie sonl deux maladies
microbiennes distinctes, mois qui voyagent fréquem- ment de compagnie, parco quo l'une prépare les voies do l'autre. D'ailleurs, Ch. Bouchard paraît accepter d'une certaine façon cette opinion, car il ajoute : Elle se produit, d'après lui, parce que, sous l'ac- tion de la grippe, la phagocytose est onlravéo cl que les défenses de l'organisme sont amoindries. Ces pneumonies vulgaires n'en seraient pas moins contagieuses, en raison de l'augmentation crois- sante do la virulence du pneumocoque.
Cette opinion éclectique et sage de Ch. Bou- chard a été récemment mise on valeur dans la discussion soulevée à la Société médicale des Hôpitaux (mors 1903).
En résumé, jusqu'à ce moment, nous ne voyons point surgir le microbe propre de lu grippe, Comme ledit excellemment Netler, on trouvait, d'après ces recherches, une explication satisfai- sante des complications de la grippe; on n'avait pas trouvé le microbe spécifique. Mais la grippe, après tout, est-elle nécessairement liéeà un agent spécifique?
En 1891, le Professeur Teissicr entreprit des recherches bactériologiques, en collaboration avec les Drs Roux et Pltlion. Ces expérimenta- teurs auraient rencontré dans le sang et les uri- nes des grippés un dlplo bacille encapsulé, se re- produisant très nettement par sporulation, dans
la ligne de slrio, un léger glacis un peu humide.
Si, pendant la période d'acmé fébrile, on ense- mence dans du bouillon une goutte de sang re- cueillie aseptiquement à l'extrémité d'un doigt, on peut constater, après trente-six à soixante heures,des éléments en chatnettes rappelant l'as- pect extérieur des streptocoques. Il s'agirait, d'uilleurs, plutôt de strepto-bacilles que de vérita- bles streptocoques. (Leçons du Professeur Tei« sier, recueillies par le Dr Frenkel.)
L'inoculation des cultures de ce micro-orga- nisme, chez plus de tienle animaux, a donné lieu à des symptômes toujours identiques : élévation brusque de la température dès les premières heures, vertiges, parésics des membres, quel- quefois diarrhée Intense, Après une évolution moyenne de neuf à quinze jours, la mort surve- nait avec des accidents de néphrite infectieuse, amaigrissement progressif, cl, lo plus souvent, convulsions. Ce serait bien là, d'après Teissier, une grippe expérimentale,
Le bacille de Pfeiffer
C'est en janvier 1892 que Pfeiffcr découvrit un bâtonnet fin et court qu'il considéra comme le microbe spécifique do la grippe, De nombreux obscrvntcurs, enlre au- tres Canon, Klein, Wclchsclbaum, Chlarl, Prlr forain, Borchardt, Huber, Piclickc, Voges, Kl-
tasato, Pfuhl, etc., confirmèrent cette découverte.
Henri Meunier, en France, quelques années plus tard, en 1897, isola ce bacille dans le suc pulmo- naire extrait du foyer pneumoniquo chez des en- fants, et en donna une description qui peut servir do modèle. H. Meunier est convaincu quo lo mi- crobe do Pfeiffer, au moins à une certaine époque de la maladie, commande l'infection pulmonaire. Ce microbe se présente sous la forme de bâton- nets très fins, très courts, et qui, par leur aspect, méritent le nom de cocco-bacilles. Ce bâtonnet, arrondi à ses extrémités, et dont lu largeur égale presque la longueur, est d'une petitesso extraor- dinaire ; il se colore difficilement par les couleurs basiques d'aniline, fort bien par le liquide do' îîiclh étendu, et se décolore par le Qram. On l'a trouvé dans lo muco-pus bronchique, la salive, le suc pulmonaire, d'abord à l'état libre et formant de véritables amas, plus tard dans l'intérieur des éléments cellulaires. Se cultivant lentement à 37° sur du sang de pigeon ou de lapin, le bacille de l'influenza ne pousse pas sur les milieux ordi- naires, tels que: bouillon, gélose, gélatine, sérum, pomme do terre ; par contre, il peut être cultivé pendant de nombreuses générations sur l'agar nutritive additionnée d'une goutte de sang d'homme, de lapin cl surtout de pigeon, H forme, dans ces dernières conditions, des colonies très
petites, très fines, presque invisibles à l'oeil nu, transparentes, arrondies, sans confluence et cons- tituées par de petits bâtonnets dont le centre est moins coloré que les extrémités. Des passages successifs sur du sang de pigeon aboutissent à la production de colonies plus volumineuses. '
D'après la description de H. Meunier, lo cocco- bacillo do Pfeiffer est rigoureusement aérobic, présentant dans les cultures vieilles un polymor- phisme très caractérisé, sous forme de filaments allongés et enchevêtrés ; il vieillit vite et no repi- que plus au bout do très peu do temps. Ce microbe est inoffensif pour les espèces animales outres quo les singes, à moins qu'on n'injecte dons les veines des doses massives de cultures vivantes ou stérili- séos ; les animaux meurent alors par loxômie. Les cultures pures donnent des résultats inconstants, variables, et sont, en général, bien tolérées quand on inocule des cultures ayant quelques jours.
M. Martin (Société do Biologie, 1900), après ino- culation du bacille de Pfeiffer dans Je liquide cé- phalo-rachidien, a vu les animaux succomber; on retrouve co micro-organisme au niveau des mé- ninges, dos ventricules, etc. Par contre, inoculé sous la peau, ce bacille ne détermine jamais la mort chez le lapin.
Slalinéuno, en 1901, mctlant à profit la pro- priété chimiotaxiqUe négative de l'acide lactique pour exalter la virulence du cocco-bacille, a pu
déterminer chez les animaux un état septicé- mique qui provoque la mort entre six et vingt- quatre heures. Les symptômes principaux consis- lent en une péritonilesuraiguc et une hypothermie qui parait plutôt d'ordre toxique, car on ne peut retrouver le microbe ni dans le sang, ni dans les organes. Les animaux qui résistent pendant quel- que temps à l'infection provoquée succombent au bout de quelques jours, minés par une cachexie profonde qui se Iraduit surtout par une perte considérable de poids.
Le bacille de la grippe, qu'on rencontre surtout dans la salive, les crachais el dans le suc pulmo- naire (Meunier), a été retrouvé dans des tissus divers, dans les séreuses, notamment par Letze- ricli, par Meunier dans un épanehement séro- fibrineux, par Pfeiffer dans certaines collections purulentes peu abondantes de la plèvre. Sa pré- sence a été constatée dans le système nerveux central chez des grippés ayant présenté des phé- nomènes nerveux graves, tels quo symptômes de méningite cérébro-spinale (Pfuhl et Walter), dans le pus d'une méningite avec abcès épidural (llacdke).
Chez trois enfants âgés respectivement de vingt mois, seize mois et six ans, atteints l'un de pleurésie, l'outre de méningite, lo troisième d'ostéo-pértostite éplphysolre du fémur, H. Meu- nier (Suclélé de Biologie, 1900) n constaté nette-
ment l'existence du cocco-bacille de Pfeiffer, et a pu, après ensemencement, obtenir des cultures abondantes de cette bactérie.
L'infiuenza-bacillus, admirablement étudié par H. Meunier, comme nous venons de le voir, est, en résumé, une bactérie extrêmement petite, la plus petite des espèces connues et n'ayant d'ana- logue, comme dimension, que le microbe de la septicémie de la souris. H ressemble étonnam- ment au pneumocoque et se présente souvent sous forme d'amas enchevêtrés.
Pour compléter l'étude de ce micro-organisme, nous ajouterons que, dans les cultures à milieux liquides, il revêt des formes allongées ; quelque- fois, ce sont de véritables filaments longs et ténus, sinueux. Sur milieux liquides, c'est le type bâtonnet qui prédomine. 11 n'a pas de mobilité propre.
Comme Pfeiffer, H. Meunier a reconnu que cette bactérie exigeait, pour se développer in vitro, l'adjonction de sang à un milieu nutritif ordinaire. Il est Indispensable, pour constater la présence du cocco-bacillo dans les cultures, d'avoir recours à lu loupe ou môme au microscope. Les colonies n'ont aucune tendance à la confluence, au fusionnement. A lu surface de la gelée san- glante regardée par transparence, on aperçoit un semis extrêmement fin de gouttelettes punetl- formes, rondes, jamais continentes, absolument