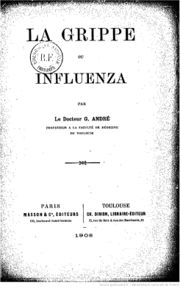La grippe ou influenza (1908) André/Bactériologie
Bactériologie et Anatomie pathologique
|
Cette page introduit un chapitre de l'ouvrage La grippe ou influenza, rédigé en 1908 par Gustave André.
Bactériologie et Anatomie pathologique
Les microbes de la grippe
Nous passerons tout d'abord en revue les diverses recherches bactériologiques tentées par un premier groupe d'expérimentateurs; cette énumération présente actuellement un intérêt véritable, car la notion d'un micro-organisme unique ou prépondérant perd aujourd'hui du terrain, comme on a pu le pressentir au début de ce travail, Cela résulte notamment des recherches délicates entreprises récemment dans le laboratoire du Professeur Cornil, par le Dr F. Bezançon et son interne Israëls de Jongh. Un fait capital a frappé ces deux savants : c'est, dans les circonstances où ils se trouvaient en ce moment, l'extrême rareté des cas où on rencontrait une seule espèce et lo fait presque constant d'associations microbiennes, Le rôle de ces divers microbes serait d'ailleurs secondaire et, pas plus que celui de Pfeiffer, ils ne mériteraient un brevet do spécificité (Soc. médic, des Hop., mars 1908).
Déjà, en 1883, Seifert, de Wurtzbourg, avait re- trouvé, dans le mucus nasal et bronchique de ma- lades atteints de grippe, des microcoques isolés, mais le plus souvent groupés deux à deux, parfois associés en chaînettes et mesurant de 1,5 à 2 a de longueur et 1 ^d'épaisseur. Ces organismes étaient colorés par le violet de méthyle,
En décembre 1889, Adolph Jolies, de Vienne, rencontra dans les crachats de grippés des mi- crocoques encapsulés ressemblant beaucoup au diplocoque pneumonique de Fricdlandcr. Co même micro-organisme encapsulé fut retrouvé dans les urines de ces malades, Des cultures sur plaques, servant à inoculer des tubes de gélatine, permirent d'obtenir des colonies en forme-de clou, comme celle que décrit Frledlandor; mois la partie saillante de la tète du clou élait moins brillante et plus granuleuse, Il existerait encore quelques différences entre les cultures du diplo- coque de Frledlandor et celles de Jolies, L'eau do l'aqueduc dé Vienne recelait cet organisme en assez grande quantité.
En 1890, Klcbs, de Zurich, décrivit les hémato- zoaires de l'influenza. H no s'agissait pas de bacilles, mais d'organismes plus relevés, lo Rhy- zomastigma, de la famille des monades. Autour des globules rouges, on pouvait voir, au micros- cope, de petits corps doués do mouvements rapides, très brillants, et qui, par leurs dimensions,
leur forme et leur mouvement, rappelaient ceux décrits précédemment par lui dans l'anémie per- nicieuse vraie. Ces organismes seraient des fla- gellés, c'est-à-dire des protozoaires munis d'un filament. Il faut bien dire que l'existence de cet hématozoaire fut tout aussitôt révoquée en doute.
Kirchner, de Berlin, aurait rencontré, dans les sécrétions bronchiques de trente malades, une diplobactérie, d'apparence encapsuléo, dont le rôle pathogène serait réel, comme l'inoculation chez le lapin semblait le démontrer.
Il faut citer encore les recherches de Finkler et de Ribbert qui attribuent les troubles de la grippe aux toxines d'un streptocoque possédant complè- tement les attributs du streptocoque de l'érysi- pèlo.
Wetchsolbaum a rencontré dans les crachats de dix-huit malades un diplocoque encapsulé ressem- blant beaucoup à celui de Talamon-Framkel, tant sous le microscope que dans les cultures. Pour- tant, cet organisme serait loin d'avoir la virulence du pneumocoque. On aurait retrouvé ce diploco- que dans l'urine provenant d'une néphrite grip- pale, dans le pus d'une sinusite et dans plusieurs otites,
inoculés au cobayo, ont provoqué une inflam- mation pleurale.
Citons pour mémoire le travail do Fischel qui rencontra deux espèces de diplocoques se dévelop- pant sur la gélatine.
Vaillard et Vincent (Soc. méd, des Hôp., 1890), pratiquant l'examen des viscères, du sang, etc., aussitôt que possible après la mort, des crachats et des épanchements pleuraux pendant la vie, croient avoir démontré, sans exception, la pré- sence d'un strejnocoque toujours identique à lui- même et bien spécifié au point de vue morpholo- gique, Les deux savants se demandent, sous oser l'affirmer, si cot organisme est'bien la cause uni- que de la grippe. Netter, à la mèmcépuque, put déceler la présence, dans certains cas, du pneumo- coque associé au stroplococcus pyogènes, dans d'uulres du bacille de Frledlandor ù l'état de culture pure. Ces microbes, déclare-t-il, no peu- vent être considérés comme les agents pathogènes de la grippe; « le pneumocoque et le streptocoque « se rencontrent normalement dans la bouche de « sujets sains, lis acquièrent sans doute, au cours « gémirent des infections secondaires ».
La bactérie que Babès, do Bucarest, a ren- contré dans quelques cas de bronchite grippale, a été désignée par ce savant sous le nom de bactérie du mucus, Mais, dans le plus grand nombre
de cas, c'est encore du pneumocoque qu'il s'agissait.
Le Professeur Ch. Bouchard (Acad. de Môdi, 1890) a rencontré trois microbes pathogènes, deux de trop, dit-il lui-même. Il s'agit encore d'habi- tants naturels de nos cavités et qui, sous l'in- fluence de la grippe, ont pu, selon son opinion, franchir les barrières qui,.d'ordinaire, les empê- chent de pénétrer dans nos tissus où dans le sang. L'émincnt observateur a trouvé, dans les affections secondaires suscitées par la grippé, le staphylo- coque pyogène (herpès labial), le pneumocoque dans certaines pneumonies et dons quelques oti- tes, le streptocoque surtout dans le pus bronchi- que, dans les crachats pneumoniques, dans le liquide des pleurésies suppurées, dans la ménin- gite, dans certaines arthrites et dans les amygda- lites de lo grippe. Ce streptocoque, injecté dans le tissu cellulaire de l'oreille du lapin, produit un érysipèle manifeste avec suppuration, Ce fait, qui met en relief l'érysipèle parmi les complications de la grippe, fait comprendre l'existence simulta- née assez fréquente des épidémies de grippe et d'érysipèle.
Les pneumoniesdllesgrippulesseraleiil, d'après Ch. Bouchard, des pneumonies vulgaires et non des pneumonies spécifiques, Cela parait certain ; néanmoins, comme l'a fait remarquer Nolhnagel, la grippe ctlo pneumonie sonl deux maladies mi-