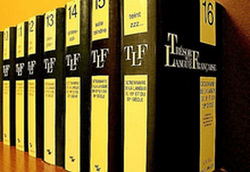Trésor de la langue française : Différence entre versions
(→Du Trésor de la Langue Française à l’ATILF) |
|||
| (15 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[File:Collection TLF.png|right|250px]] | [[File:Collection TLF.png|right|250px]] | ||
Le '''''Trésor de la langue française''''' (TLF) est un dictionnaire de la langue du 19{{e}} et 20{{e}} siècle, en 16 volumes<ref>http://www.atilf.fr/IMG/pdf/La_preface_du_TLFi_par_Jean.pdf</ref>. | Le '''''Trésor de la langue française''''' (TLF) est un dictionnaire de la langue du 19{{e}} et 20{{e}} siècle, en 16 volumes<ref>http://www.atilf.fr/IMG/pdf/La_preface_du_TLFi_par_Jean.pdf</ref>. | ||
| + | |||
| + | Plus précisément, en décembre 1960, le CNRS a créé le Centre de recherche pour un Trésor de la langue française sous la direction de [[A pour personnalité citée::Paul Imbs]] à Nancy. | ||
Il a été créé et publié par le CNRS entre 1971 et 1994. Il est maintenant accessible en ligne par le service TLFi opéré par l'ATILF dans le cadre du programme CNRTL. | Il a été créé et publié par le CNRS entre 1971 et 1994. Il est maintenant accessible en ligne par le service TLFi opéré par l'ATILF dans le cadre du programme CNRTL. | ||
| + | ==Repères historiques== | ||
| + | Cette section reprend un paragraphe d'une publication de Jacques Ducloy : | ||
| + | * {{Wicri lien avec icône|wiki=SIC|page=Ingénierie des systèmes d'information (2019) Ducloy|texte=Systèmes d’information encyclopédiques édités par les scientifiques}} | ||
| + | {{Corps article/Début}} | ||
| + | ===Du Trésor de la Langue Française à l’ATILF=== | ||
| + | Le démarrage du Trésor de la Langue Française relève du roman d’anticipation<ref>Voir notamment la thèse de Ruth Radermacher : | ||
| + | <br/<https://www.atilf.fr/wp-content/uploads/theses/atilf_These_Radermarcher_Ruth_2004.pdf | ||
| + | </ref>. Nous sommes en 1955. Les disques magnétiques ne sont pas encore inventés<ref>Les mémoires de masse alors testées sont les tambours magnétiques.</ref> . Des linguistes et des philologues (Bernard Quémada, Paul Imbs) utilisent des machines mécanographiques. En 1959, un projet de « ''mise en chantier d’un Trésor général de la langue française ou Dictionnaire historique général de la langue française'' » figure dans le rapport de conjoncture du CNRS. Fin 1960, le CRTLF est créé. En 1961, un des plus gros ordinateurs du monde, un Gamma 60, est commandé à la compagnie des machines Bull. Il arrivera à Nancy en 1963 avec 10 dérouleurs de bandes magnétiques, 2 lecteurs de ruban perforé, 3 imprimantes, mais sans disques magnétiques. | ||
| + | |||
| + | Au départ, il s’agit « simplement » de constituer « le Trésor ». En 1963, 22 opératrices-mécanographes commencent les opérations de saisie de textes à raison de 100.000 mots par jour. En 1970, une base initiale de 1000 textes dans lesquels chaque mot était étiqueté par sa catégorie grammaticale a été constituée. | ||
| + | |||
| + | En 1968, le projet de dictionnaire prend corps et des projets d’articles sont évalués. Puis la rédaction définitive démarre. Le premier tome, daté de 1971 est présenté au public en 1972. Le dernier tome sortira en 1994, à l’issue de longues pérégrinations. L’ensemble représente 16 volumes, 100.000 mots, 270.000 définitions, 430.000 exemples et 350 millions de caractères. | ||
| + | |||
| + | Les traitements informatiques ont été conçus dans les années 65, avec les bandes comme mémoire de masse<ref>Dans les années 75, la bandothèque contenait environ 2000 bandes magnétiques, chacune pouvait stoker 20 millions de caractères.</ref> et les imprimantes pour l’interface homme machine. Pour chaque mot de faible fréquence, une liste de concordances suffisait au rédacteur. Pour les mots plus courants, des algorithmes basés sur des associations, les groupes binaires, ont été développés. Les chaînes de traitement étaient décomposées en étapes qui s’étalaient environ sur un mois, avec, en fin de phase des tris qui mobilisaient 6 à 8 dérouleurs pendant plusieurs heures. Ces contraintes historiques (pas de disque, peu de mémoire centrale au départ) ont favorisé un style de traitements basés sur une alternance de tris et de programmes relativement simples. | ||
| + | |||
| + | Une nouvelle étape a démarré dans les années 80 avec l’arrivée de Jacques Dendien. En 1986, le TLF disposait d’un moteur de recherche permettant de manipuler des éléments de grammaire sur la base FRANTEXT qui contient maintenant 5390 références soit 253 millions de mots. Dans la foulée, il a également développé une mise en ligne du dictionnaire (le TLFi), qui est maintenant en accès public depuis la direction de Jean-Marie Pierrel à l’ATILF. | ||
| + | |||
| + | {{Corps article/Fin}} | ||
| + | |||
==Liste des articles sur ce wiki== | ==Liste des articles sur ce wiki== | ||
<tabs> | <tabs> | ||
| Ligne 9 : | Ligne 30 : | ||
|- | |- | ||
|[[Académie (Trésor de la langue française)|Académie]] | |[[Académie (Trésor de la langue française)|Académie]] | ||
| + | |[[Amateur (Trésor de la langue française)|Amateur]] | ||
| + | |[[Amateurisme (Trésor de la langue française)|Amateurisme]] | ||
|[[Assonance (Trésor de la langue française)|Assonance]] | |[[Assonance (Trésor de la langue française)|Assonance]] | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | </tab> | ||
| + | <tab name="B"> | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bibliothèque (Trésor de la langue française)|Bibliothèque]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Ligne 17 : | Ligne 47 : | ||
|- | |- | ||
|[[Chercheur (Trésor de la langue française)|Chercheur]] | |[[Chercheur (Trésor de la langue française)|Chercheur]] | ||
| + | |[[Chevreuil (Trésor de la langue française)|Chevreuil]] | ||
|[[Chœur (Trésor de la langue française)|Chœur]] | |[[Chœur (Trésor de la langue française)|Chœur]] | ||
|[[Cor (Trésor de la langue française)|Cor]] | |[[Cor (Trésor de la langue française)|Cor]] | ||
| Ligne 41 : | Ligne 72 : | ||
|- | |- | ||
|[[Oratorio (Trésor de la langue française)|Oratorio]] | |[[Oratorio (Trésor de la langue française)|Oratorio]] | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | </tab> | ||
| + | <tab name="S"> | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Scribe (Trésor de la langue française)|Scribe]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Ligne 62 : | Ligne 100 : | ||
La référence au ''Trésor de la langue française'' est très présente dans le réseau Wicri. En effet, de nombreux articles donnent pour la définition d'un terme celles du TLF. Le TLF est donc : | La référence au ''Trésor de la langue française'' est très présente dans le réseau Wicri. En effet, de nombreux articles donnent pour la définition d'un terme celles du TLF. Le TLF est donc : | ||
* introduit sur {{Wicri lien|wiki=Wicri}}, | * introduit sur {{Wicri lien|wiki=Wicri}}, | ||
| − | * présent sur les wikis : {{Wicri lien|wiki=Outils}}, | + | * présent sur les wikis : {{Wicri lien|wiki=Outils}}, {{Wicri lien|wiki=SIC}}, {{Wicri lien|wiki=HistIst}}. |
* cité (utilisé) sur : | * cité (utilisé) sur : | ||
| − | ** {{Wicri lien|wiki=Agronomie}}, {{Wicri lien|wiki=Bois}}, , {{Wicri lien|wiki=Terre}}, {{Wicri lien|wiki=Santé}}, | + | ** {{Wicri lien|wiki=France}}, {{Wicri lien|wiki=Île-de-France}}, {{Wicri lien|wiki=ChansonRoland}}, {{Wicri lien|wiki=Soc Grand Est}} |
| + | ** {{Wicri lien|wiki=Agronomie}}, {{Wicri lien|wiki=Animaux}}, {{Wicri lien|wiki=Bois}}, , {{Wicri lien|wiki=Terre}}, {{Wicri lien|wiki=Santé}}, | ||
** {{Wicri lien|wiki=Math}}, {{Wicri lien|wiki=HistSciences}}, {{Wicri lien|wiki=Musique}}, {{Wicri lien|wiki=Psychologie}}. | ** {{Wicri lien|wiki=Math}}, {{Wicri lien|wiki=HistSciences}}, {{Wicri lien|wiki=Musique}}, {{Wicri lien|wiki=Psychologie}}. | ||
Des outils sont développés sur : | Des outils sont développés sur : | ||
| − | * {{Wicri lien|wiki=Base 1. | + | * {{Wicri lien|wiki=Base 1.31}}, {{Wicri lien|wiki=Outils}}. |
Version actuelle datée du 22 octobre 2025 à 10:20
Le Trésor de la langue française (TLF) est un dictionnaire de la langue du 19e et 20e siècle, en 16 volumes[1].
Plus précisément, en décembre 1960, le CNRS a créé le Centre de recherche pour un Trésor de la langue française sous la direction de Paul Imbs à Nancy.
Il a été créé et publié par le CNRS entre 1971 et 1994. Il est maintenant accessible en ligne par le service TLFi opéré par l'ATILF dans le cadre du programme CNRTL.
Sommaire
Repères historiques
Cette section reprend un paragraphe d'une publication de Jacques Ducloy :
Du Trésor de la Langue Française à l’ATILF
Le démarrage du Trésor de la Langue Française relève du roman d’anticipation[2]. Nous sommes en 1955. Les disques magnétiques ne sont pas encore inventés[3] . Des linguistes et des philologues (Bernard Quémada, Paul Imbs) utilisent des machines mécanographiques. En 1959, un projet de « mise en chantier d’un Trésor général de la langue française ou Dictionnaire historique général de la langue française » figure dans le rapport de conjoncture du CNRS. Fin 1960, le CRTLF est créé. En 1961, un des plus gros ordinateurs du monde, un Gamma 60, est commandé à la compagnie des machines Bull. Il arrivera à Nancy en 1963 avec 10 dérouleurs de bandes magnétiques, 2 lecteurs de ruban perforé, 3 imprimantes, mais sans disques magnétiques.
Au départ, il s’agit « simplement » de constituer « le Trésor ». En 1963, 22 opératrices-mécanographes commencent les opérations de saisie de textes à raison de 100.000 mots par jour. En 1970, une base initiale de 1000 textes dans lesquels chaque mot était étiqueté par sa catégorie grammaticale a été constituée.
En 1968, le projet de dictionnaire prend corps et des projets d’articles sont évalués. Puis la rédaction définitive démarre. Le premier tome, daté de 1971 est présenté au public en 1972. Le dernier tome sortira en 1994, à l’issue de longues pérégrinations. L’ensemble représente 16 volumes, 100.000 mots, 270.000 définitions, 430.000 exemples et 350 millions de caractères.
Les traitements informatiques ont été conçus dans les années 65, avec les bandes comme mémoire de masse[4] et les imprimantes pour l’interface homme machine. Pour chaque mot de faible fréquence, une liste de concordances suffisait au rédacteur. Pour les mots plus courants, des algorithmes basés sur des associations, les groupes binaires, ont été développés. Les chaînes de traitement étaient décomposées en étapes qui s’étalaient environ sur un mois, avec, en fin de phase des tris qui mobilisaient 6 à 8 dérouleurs pendant plusieurs heures. Ces contraintes historiques (pas de disque, peu de mémoire centrale au départ) ont favorisé un style de traitements basés sur une alternance de tris et de programmes relativement simples.
Une nouvelle étape a démarré dans les années 80 avec l’arrivée de Jacques Dendien. En 1986, le TLF disposait d’un moteur de recherche permettant de manipuler des éléments de grammaire sur la base FRANTEXT qui contient maintenant 5390 références soit 253 millions de mots. Dans la foulée, il a également développé une mise en ligne du dictionnaire (le TLFi), qui est maintenant en accès public depuis la direction de Jean-Marie Pierrel à l’ATILF.
Liste des articles sur ce wiki
Voir aussi
- Notes
- ↑ http://www.atilf.fr/IMG/pdf/La_preface_du_TLFi_par_Jean.pdf
- ↑ Voir notamment la thèse de Ruth Radermacher : <br/<https://www.atilf.fr/wp-content/uploads/theses/atilf_These_Radermarcher_Ruth_2004.pdf
- ↑ Les mémoires de masse alors testées sont les tambours magnétiques.
- ↑ Dans les années 75, la bandothèque contenait environ 2000 bandes magnétiques, chacune pouvait stoker 20 millions de caractères.
- Sur ce wiki
- Dans le réseau Wicri :
Ceci est la page de référence de « Trésor de la langue française »
La référence au Trésor de la langue française est très présente dans le réseau Wicri. En effet, de nombreux articles donnent pour la définition d'un terme celles du TLF. Le TLF est donc :
- introduit sur Wicri/Wicri,
- présent sur les wikis : Wicri/Outils, Wicri/SIC, Wicri/Histoire de l'IST.
- cité (utilisé) sur :
Des outils sont développés sur :