La Chanson de Roland/Francisque Michel/1869/Préface : Différence entre versions
(→Le manuscrit d'Oxford) |
(→Le manuscrit d'Oxford) |
||
| Ligne 141 : | Ligne 141 : | ||
:E fist la clartre el muster de Loüm.<br /> | :E fist la clartre el muster de Loüm.<br /> | ||
:Ki tant ne set ne l'ad prod entendut.<br /> | :Ki tant ne set ne l'ad prod entendut.<br /> | ||
| − | (P. 64, st. CLV, v. 13.) | + | ({{F. Michel 1869 lien page|64|P. 64}}, st. CLV, v. 13.) |
Quel était ce Gilie? Malheureusement nos recherches ne nous ont rien appris sur lui. | Quel était ce Gilie? Malheureusement nos recherches ne nous ont rien appris sur lui. | ||
Version du 7 juin 2023 à 19:38
Sommaire
Avant propos éditorial
Pour une meilleure lisibilité numérique, ce texte a été légèrement adapté :
- Les notes de bas de page ont été regroupées en fin de document (avec une mise en page plus aérée).
- Des titres (en italique) ont été ajoutés.
Préface
- Assez de gent sont mult dolant
- De ce que l'en trahi Rollant,
- Et pleurent de fausse pitié [1].
Les faits
Ce passage, qui, sans aucun doute, fait allusion au Roman de Roncevaux , tel que nous le publions , nous montre assez à quel point il était répandu au moyen âge, et combien la lecture en était attachante pour nos aïeux.
Le fait principal sur lequel roule son action est la défaite de l'arrière-garde de Charlemagne dans les Pyrénées en 778, lorsqu'il revenait de l'Espagne qu'il avait conquise : « Tandis que la guerre contre les Saxons, dit Eginhard, se continuait assidûment et presque sans relâche, le roi, qui avait réparti des troupes sur les points favorables de la frontière, marche contre l'Espagne à la tête de toutes les forces qu'il peut rassembler, franchit les gorges des Pyrénées, reçoit la soumission de toutes les villes et de tous les châteaux devant lesquels il se présente, et ramène son armée sans avoir éprouvé aucune perte , si ce n'est toutefois qu'au sommet des Pyrénées il eut à souffrir un peu de la perfidie des Gascons. Tandis que l'armée des Francs, engagée dans un étroit défilé, était obligée par la nature du terrain de marcher sur une ligne longue et resserrée, les Gascons qui s'étaient embusqués sur la crête de la montagne (car l'épaisseur des forêts dont ces lieux sont couverts favorise les embuscades) descendent et se précipitent tout à coup sur la queue des bagages, et sur les troupes d'arrière-garde chargées de couvrir tout ce qui précédait, et les culbutent au fond de la vallée. Ce fut là que s'engagea un combat opiniâtre, dans lequel tous les Francs périrent jusqu'au dernier. Les Gascons, après avoir pillé les bagages, profitèrent delà nuit, qui était survenue, pour se disperser rapidement. Ils durent, en cette rencontre, tout leur succès à la légèreté de leurs armes, et à la disposition des lieux où se passa l'action ; les Francs, au contraire, pesamment armés, et placés dans une situation défavorable, luttèrent avec trop de désavantage. Eggihard, maître d'hôtel du roi, Anselme, comte du palais , et Roland , préfet des Marches de Bretagne, périrent dans ce combat. Il n'y eut pas moyen, dans le moment, de tirer vengeance de cet échec ; car, après ce coup de main, l'ennemi se dispersa si bien, qu'on ne put recueillir aucun renseignement sur les lieux où il aurait fallu le chercher [2]. »
Voici ce que l'histoire a laissé sur la fameuse bataille de Roncevaux. Voulons-nous plus? La fable nous fournira d'amples détails : lisons la chronique attribuée à Turpin , celle de Rodrigue de Tolède [3] et autres, plusieurs romances espagnoles, et avant tout la Chanson de Roland, et le Roman de Ronceveaux, que nous publions [4].
C'est de celle-là que nous allons maintenant parler.
La Chanson de Geste
En 1817, J.-F. Conybeare, annonçant l'intention où il était de faire paraître un ouvrage intitulé Illustrations of the early History of English and French Poetry, et donnant le plan de son travail, disait : « Parmi les notices consacrées à l'ancienne poésie française, on trouvera l'analyse d'un poëme sur un sujet bien connu, la déroute de Roncevaux , que diverses particularités dans la composition m'autorisent à regarder comme le plus ancien spécimen en ce genre existant aujourd'hui au nombre des trésors manuscrits de nos bibliothèques [5]. » L'ouvrage n'a jamais vu le jour.
Cette même année. M. de Musset donnait une analyse du Roman de Roncevaux, et en annonçait une édition, qui n'a jamais paru [6].
En 1832, M. Paulin Paris disait dans sa Lettre à M. Monmerqué sur les romans des douze pairs de France : « M. Bourdillon, qui, depuis longtemps, a senti toute l'importance littéraire et historique de la Chanson de Roncevaux, s'occupe d'en offrir enfin une édition [7]. »
La même année, mais plus tard , parut une Dissertation sur le Roman de Roncevaux par H. Monin , élève de l'École Normale [8]. Nous tâchâmes de faire sentir tout le mérite de ce travail dans un article du Cabinet de Lecture, qui ensuite, corrigé et augmenté, fut tiré à part à cent exemplaires sous le titre d' Examen critique de la Dissertation de M. Henri Monin sur le Roman de Roncevaux [9]. Cet article ne fut pas le seul ; M. Raynouard en fit un dans le Journal des Savants, n° de juillet 1832; et M. Saint-Marc Girardin, trois dans le Journal des Débats, numéros des 27 septembre, 14 octobre et 9 novembre de la même année.
A la suite de tous ces comptes-rendus, M. Monin publia en quatre pages in-8° ses corrections et additions. C'est à cet ouvrage ainsi complété que nous renvoyons le lecteur pour la solution des principales questions que soulève le Roman de Roncevaux : l'élève de l'École Normale y a généralement répondu avec autant de talent que de bonheur. Nous nous bornerons donc à présenter quelques observations sur la version du manuscrit d'Oxford que nous publions de nouveau, et sur notre travail d'éditeur.
Le manuscrit d'Oxford
L'existence du manuscrit Digby, coté 23 , a été pour la première fois révélée par le savant Tyrwhitt, dans une de ses notes
aux Canterbury Tales de Chaucer. Plus tard il fut, à ce que nous croyons, examiné par feu l'abbé de la Rue, qui ne publia
qu'en 1834 ses observations sur le poème attribué à Turold [10]. Ces observations sont de telle nature que nous croirions manquer à un devoir si nous ne les examinions pas en détail.
M. de la Rue débute par assurer que la famille de Turold était normande, et qu'il figure lui-même sur la tapisserie de Bayeux. A cette assertion, nous opposons deux chartes : l'une de Kenulph, roi de Mercie, donnée en 806 ; l'autre de Witlaf, roi du même pays, en 833, et dans lesquelles il est question d'un Thorold, vicomte de Lincoln [11], et du don qu'il fait aux moines de l'abbaye de Croyland, de son manoir de Bokenhale. Nous répondrons ensuite à M. de la Rue, qu'il est tout au moins téméraire de poser en fait que le Turold du manuscrit Digby soit l'auteur du poème que nous publions, et le même que le personnage représenté sur la tapisserie de Bayeux [12].
Sous le règne de Guillaume le Conquérant , il y avait aussi à Peterborough un abbé normand du même nom (1), qui mourut en 1098 (2); et nous rencontrons encore un Turoldus de Montanis dans la chronique d'Orderic Vital, à l'année 1107 (3). Comme on le voit, le nom de notre trouvère n'était pas rare, et il nous semble plus raisonnable de penser qu'il n'appartenait pas exclusivement aux grands seigneurs que nous venons de nommer, plutôt que d'attribuer à l'un d'eux une œuvre qui, sans aucun doute, est celle d'un jongleur ou d'un rimeur roturier.
Poursuivons notre examen.
M. de la Rue prétend que notre trouvère prit le sujet de sa chanson dans la fabuleuse histoire de Charlemagne par Turpin. Avant l'apparition des Essais historiques, M. H. Monin avait réfuté cette opinion. Voyez sa brochure, p. 75-76, et p. 74, où un passage tiré de l'épître du prieur de Vigeois au clergé de Limoges, en lui envoyant la chronique de Turpin (vers l'an 1100) , nous prouve bien qu'on n'avait pas besoin de Turpin pour chanter Roland et la .bataille de Roncevaux, tout au moins au midi de la Loire. D'ailleurs, ce n'est pas le témoignage de l'archevêque que Turold invoque ; mais celui de Gilie :
- Ço dist la geste e cil ki el camp fut ,
- Li ber Gilie por qui Deus fait vertuz,
- E fist la clartre el muster de Loüm.
- Ki tant ne set ne l'ad prod entendut.
(P. 64, st. CLV, v. 13.)
Quel était ce Gilie? Malheureusement nos recherches ne nous ont rien appris sur lui.
M. de la Rue ajoute au sujet de Turold : « C'est le premier poète qui ait écrit en françois sur cette bataille, et nous le comptons parmi les trouvères qui écrivirent dans les trente premières années du douzième siècle. » La première de ces opinions est bien tranchante, et aurait besoin de preuves ; quant à la seconde, elle nous paraît fondée, et. nous l'adoptons volontiers ; mais nous ne pouvons que regretter de la trouver suivie d'une assertion entièrement fausse : « Si quelquefois il (Turold) écrit un alinéa en rimes consécutives, souvent aussi, au milieu d'une narration intéressante, il écarte subitement la rime, et continue son récit en vers non rimés. » Il suffit de jeter les yeux sur ce poème pour se convaincre que, comme le Roman du voyage de Charlemagne à Jérusalem et à Constantinople (1), il n'est pas assujetti à la rime, mais continuellement à l'assonance. « J'appelle assonance, dit M. Raynouard (2), dans l'ancienne poésie françoise, la correspondance imparfaite et approximative du son final du dernier mot du vers avec le même son du vers qui précède ou qui suit, comme on a appelé rime la correspondance parfaite du son identique final de deux vers formant le distique. » Je le répète, qu'on jette les yeux sur la chanson de Turold, qu'on ait soin de prononcer la fin des vers en appuyant sur la voyelle pleine , dominante et antérieure qui caractérisait
l'assonance, et l'on reconnaîtra partout la vérité de ce que je dis , excepté dans un petit nombre de cas où nous pouvons accuser le copiste ou notre ignorance de la prononciation de ces temps anciens.
M. de la Rue continue en donnant quelques extraits du poème de Turold; mais, chose singulière! il ne va jamais jusqu'au
mot AOI qui termine presque toujours chaque tirade, et conséquemment il ne dit pas un mot de cette curieuse finale que
nous n'avons rencontrée nulle autre part, et sur laquelle nous hasarderons bientôt une conjecture.
Plus loin, M. de la Rue assure que Turold place parmi les paladins de Charlemagne, sous le nom de Gautier, le fameux
Gauvain , neveu du roi Arthur : d'où il conclut « qu'il faut reporter les fables de la Table Ronde à une époque beaucoup
plus reculée que celle qu'on prétend faussement leur assigner. » Nous croyons qu'effectivement les fables de la Table Ronde sont au moins aussi anciennes que les légendes de Charlemagne ; mais nous ne faisons pas découler cette conséquence du fait
qu'avance l'abbé de la Rue, attendu qu'il ne se trouve pas dans la chanson composée ou récitée par Turold, mais dans la version du manuscrit 7227-5 (I), version du treizième siècle ; encore peut-on expliquer différemment le passage en appliquant à Malarsus les mots Li niés Artus qui se trouvent au vers suivant (2).
Dans l'avant-dernier paragraphe de l'article que nous examinons, je trouve une remarque singulière : M. de la Rue avanceque Turold donne au vers un pied de plus quand la rime est féminine, et qu'il le fait aussi quelquefois quand elle est masculine. M. de la Rue a-t-il donc oublié qu'en tout temps l'E muet final n'a jamais compté pour un pied? En second lieu, si M. l'abbé a fait allusion à des vers semblables à ceux-ci :
- Fors Sarraguce, ki'est en une muntaigne,
- Li reis Marsilie la tient, ki Deu nen aimet,
il a oublié ce que disait M. Raynouard en 1833 : « Lorsque dans les vers de douze et de dix syllabes, l'hémistiche ou le repos offroit, à la sixième, à la quatrième, un mot terminé en E muet, cet E muet ne comptoit pas, et il en étoit de cette désinence de la césure comme de la désinence en E muet de la rime ou de l'assonance (1).» Ajoutons que le T final placé devant aimet, recleimet, ateignet, ne se prononçant pas, on avait un vers juste en lisant ainsi les vers que nous avons cités plus haut :
Fors Sarragus, k'iest en une muntaigne,
Li reis Marsill la tient, ki Deu nen aime.
Le dernier paragraphe de l'article de M. de la Rue est consacré à la dissertation de M. Monin , dont il fait un éloge mérité.
C'est peut-être ici le moment de répondre à une interpellation que nous a adressée un maître de la science , dont nous
recevions toujours les avis avec autant de respect que de reconnaissance. « Pourquoi, me disait M. Raynouard, avez-vous
donné au poème de Turold le titre de Chanson de Roland, alors qu'aucun manuscrit ne le porte ? » Nous n'avons, il est
vrai , trouvé ni ce titre ni aucun autre dans les manuscrits du Roman de Roncevaux, et si nous l'avons pris, c'est que nous avons pensé qu'il convenait beaucoup plus que tout autre au poème de Turold. En effet, c'est bien une Chanson de geste, dont le héros le plus saillant est Roland, qui, par le conseil qu'il donne à Charlemagne, amène la trahison de Ganelon, sa propre mort et celle des douze pairs à Roncevaux. Le seul reproche que l'on puisse nous faire, c'est de ne point avoir préféré ce nom de lieu à celui du principal héros, et adopté le titre de Chanson de Roncevaux, conformément à ce qui s'est pratiqué pour d'autres poèmes, tels que ceux d'Aspremont et d'Aliscans.
On peut croire aussi que , par ces mots Chanson de Roland, nous avons voulu donner à penser que nous regardions le poème de Turold comme étant celui dont Taillefer chanta des morceaux à la bataille d'Hastings. Nous ne cacherons
Notes de Francisque Michel
- ↑
[page I - note 1]
La Complainte d'outremer, Paris, 1834, in-8°, p. 15. — Voici deux autres passages où l'on parle de la Chanson de Roncevaux. Ils nous donnent de nouvelles preuves de sa popularité :
- Oï avez d'Olivier le baron
- Et de Rollant et del noble Charlon,
- Des .xii. pers que traï Guenelon.
- En Roncevax au roi Marsilion
- Les vendi Guenes, cui dame-Dé mal dont !
- Pus en ot-il si mortel guierdon,
- Con vos orroiz ès vers de la chançon,
- Qu'il en pendi à guise de larron :
- SI doit-on fere de traïtor félon.
(Les Enfances Vivienz, Ms. de la Bibliothèque impériale n° 6985, fol. 17 3 r°, col. 3, ligne 13.)
- Menbre-vos ore de la perte de Karlle,
- De Roncevax où fu la grant bataille.
- Mort fu Rollant et Turpin et li autre,
- Et Olivier, le chevalier mirable;
- Plus de .xx. m. i ot mort à glaive.
- Pris fu Garin d'Anséune la large,
- Si l'en mena .i. fel païen Marage.
(Ibid., fol. 173 v°, col. 2, v. 36 ).
- ↑ [page II - note 1]
Vita Karoli imperatoris, cap. IX (Œuvres complètes d'Éginhiard, réunies pour la première fois et traduites en français par A. Teulet. A Paris, M. DCCC. XL — XL1I1, in-8°, tom. I, p. 30-33). Voyez aussi Poetæ Saxonici Annales, lib. I (Rec. des Hist. des Gaules et de la France, vol. V, p. 142, E) ; Eginhardi Annales (ibid., p. 203, D);les Chroniques de Saint-Denys, liv. I, chap. VI (ibid., p. 234, E);l' Histoire de Charlemagne par Gaillard, Paris, MDCCCXIX, in-8°, vol. I, p. 331-335; et le Marca Hispanica sive Limes Hispanicus… auct. Petro de Marca. Parisiis, MDCLXXXVIII, in-fol., lib. III, cap. VI, col. 245-255. En voici le synopsis : «- I. Mors Pippini régis. Ibinalarabi Sarracenus se filio ejus Karolo M. dedit.
- II. Is erat præfectus Cæsaraugustæ
- III. Ea capta est a Karolo, et Pompelo.
- IV. Osca Francorum dominio tradita.
- V. Insidiæ Karolo structæ in faucjbus Pyrenæi.
- VI. Verba Eginhardi de ea clade.
- VII. Fabulæ Hispanorum de pugna illa.
- VIII. Fabulosarum bistoriarum origo ab Hispanis. Rodericus Toletanus talium fabularum pater et patronus.
- IX. Gerunda capta a copiis ejusdem Karoli.
- X. Gerundenses putant Karolum ipsum eam obsidionem fecisse.
- XI. Arnaldus, episcopus Gerundensis, instituit festum et officium S. Karoli M.»
- ↑ [page III - note 1]
Rodericus Toletanus, Rer. in Hispania gestarum Chron., Iib. IV, cap. X. - ↑ [page III - note 2]
Les fables de Roncevaux ont été répétées par Chalcondyle, ᾿Aπόδει- ξις ἰδτορἶων δέχα Parisiis, DC. L., in-fol. p. 45, D 46, D (il y est dit que Roland, appelé ῾Oρμἄνδος , y mourut de soif, et ajouté : χαἶ οὖτοι μἒν ταὖτη χάλλιδα θέμενοι τὂν πόλεμον, ἒς τόὂε ἄεἶ ὖμνοὖνται, ὦς ἄνὂρες γενόμενοι ἄγαθοι. Καἶ ῾Ορμἄνὂον μἒν γε σρατηγὂν ὖπὂ δἰφονς ἒχπολιορχηθέντα ἄποθανεῖν) ; et par Mariana, Hist. de. Rébus Hispan., lib. VII, cap. XI. Elles ont été discutées et combattues par Baronius, Annales Eccles., année 778, §I,II, vol. XIII, Lucæ, MDCCLIII, p. 125, 126 ;et ann. 812, §XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, p. 495-498; par Pagi, Crilica, 778, § III, IV, V, VI, p. 125, 126; et par Me Pierre de Marca , dans son Histoire de Béarn, p. 152-154. - ↑ [page IV - note 1]
The Gentleman's Magazine, August 1817, p. 103, col. 2. - ↑ [page IV - note 2]
Légende du bienheureux Roland, prince françois, dans les Mémoires et Dissertations sur les Antiquités nationales et étrangères, publiés par la Société royale des Antiquaires de France, tom. I, p. 145-171. Voyez aussi tom. X, p. 412-414. — De la page 151 à la page 160 se trouve l'analyse du Roman de Roncevaux, avec cette note, dont le renvoi est à la fin de la première ligne : «Le Roman de Roncevals, manuscrit dont M. Guyot des Herbiers prépare une édition, qui ne peut manquer d'être favorablement accueillie. » - ↑ [page VI - note 3]
Li Romans de Berte aus grans piés, p. xlij. - ↑ [page IV - note 4]
Paris, Imprimerie royale, un vol. in-8° de (4)-116 pages. - ↑ [page IV - note 5]
Paris, Silvestre, 1832, brochure in-8°. - ↑ [page V - note 1]
Essais historiques sur les Bardes, les Jongleurs et les Trouvères, t. II, p.' 57-65. - ↑ [page V - note 2]
Historia Ingulphi, recueil de Fell, t. I, p. 6 et 9. — Il est question d'un autre Anglo-Saxon nommé Thorold, sous le règne d'Æthelred, vers l'année 994, dans la chronique de J. Brompton. (Hist. Angl. Script. X, col. 879, 1. 55.) - ↑ [page V - note 3]
'« …Il s'étoit distingué avec ses fils à la journée d'Hastings. Richard, l'un d'eux, fut shérif du Lincolnshire, où il fonda le prieuré de Spalding. » Ceci est une erreur, comme l'on peut s'en convaincre en lisant Ingulphe : « Tunc inter familiares nostri monasterii, et benevolos amicos, erat præcipuus consiliarius quidam vicecomes Lincolniæ, dictus Thoroldus, quem multi adhuc superstites et regulares et seculares viderunt et noverunt, de genere et cognatione illius vicedomini Thoroldi, qui quondam nostro eœnobio amicissimus dedit nobis manerium suum de Bokenhale cum omnibus pertinentiis ejus. Sic iste Thoroldus… totum manerium suum de Spaldyng cum redditibus pertinentibus, et servitiis suis universis in perpetuam eleemosynan concessit, et inde chirographum suum fecit. « Recueil de Fell, vol. 1, p. 65. La charte se trouve p. 86-88, et dans le Monasticon Anglicanum, édit. de M. DC. LV — MDCLXXI1I, 1. 1, p. 306, 307. Voyez aussi p. 95 du premier ouvrage.
Facsimilés
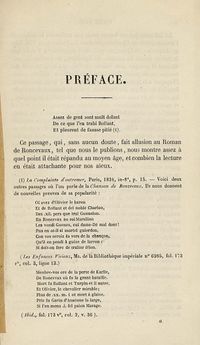
|
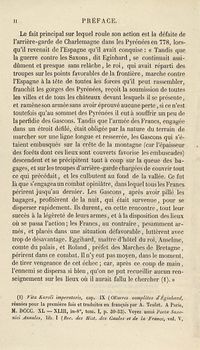
|
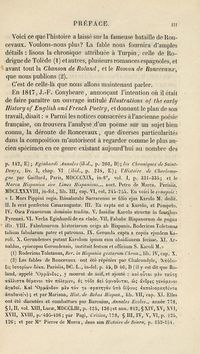
|
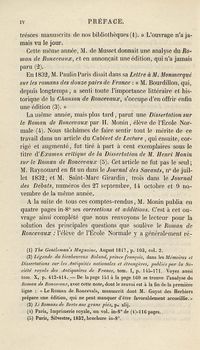
|

|

|
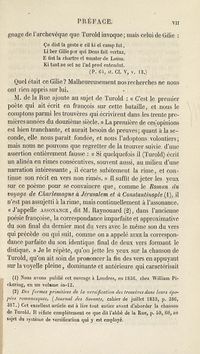
|
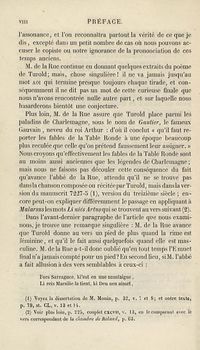
|
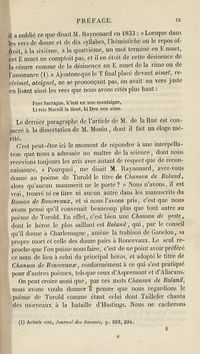
|

|
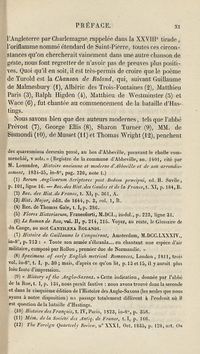
|
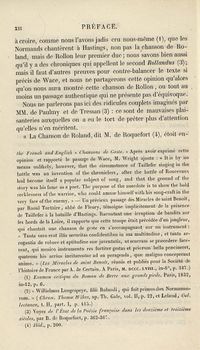
|
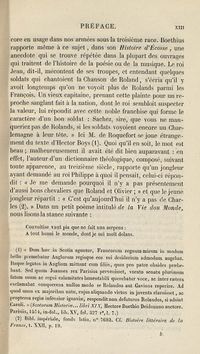
|

|
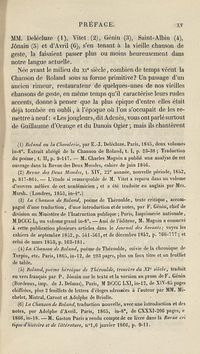
|
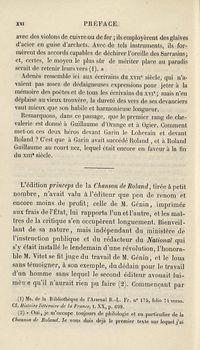
|
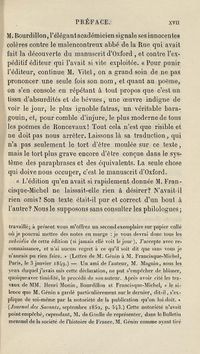
|
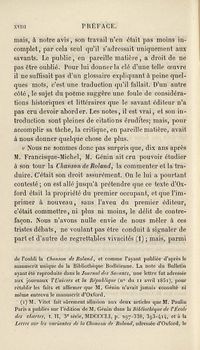
|
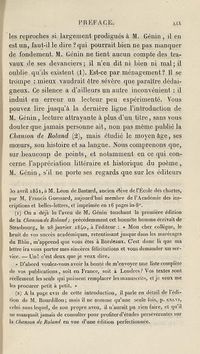
|
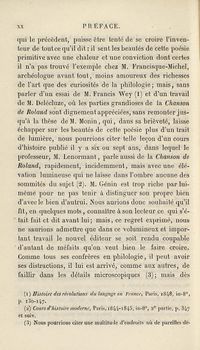
|
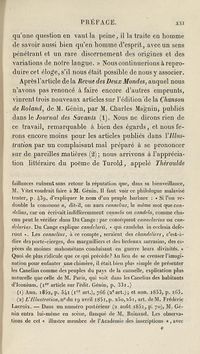
|
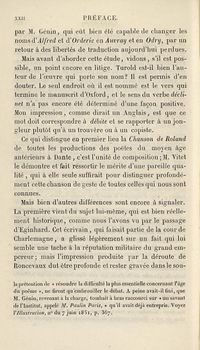
|
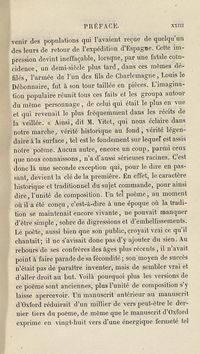
|
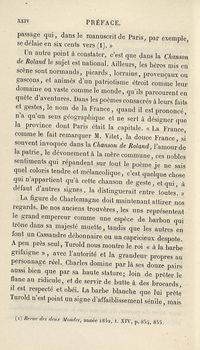
|
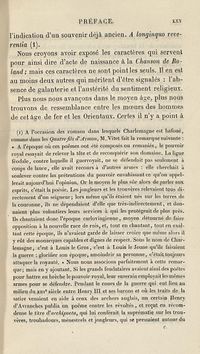
|
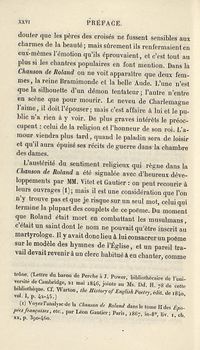
|
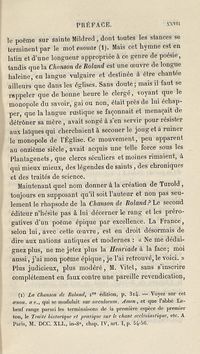
|
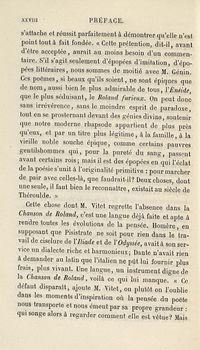
|
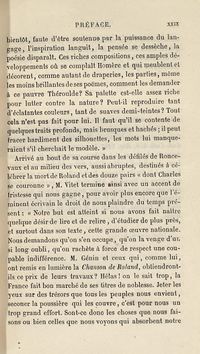
|
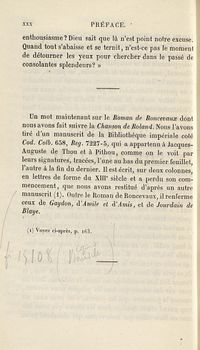
|






