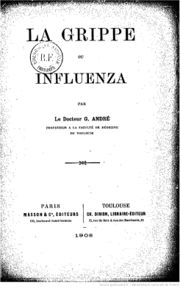La grippe ou influenza (1908) André/Traitement
Traitement
|
Cette page introduit un chapitre de l'ouvrage La grippe ou influenza, rédigé en 1908 par Gustave André.
Traitement
Prophylaxie
Peut-on sellalterde pouvoir em- pêcher, un jour, par des mesures internationales, comme pour le choléra, la peste, le typhus, etc., la propagation de la grippe épidémique ? Sisley, au Congrès international de Londres, a proposé d'exiger par une loi la déclaration des cas d'in- lluenza. La mesure serait absolument illusoire, car le médecin n'intervient guère au début de la maladie, c'est-à-dire au moment où le diagnostic précoce est surtout utile. Tenter de mettre obsta- cle à l'envahissement d'une région, d'une ville, par l'influenza, c'est chercher à résoudre un pro- blème insoluble ; c'est un rêve, une utopie scien- tifique ; dans sa marche capricieuse ot vagabondé, la grippe déjouera tous les règlements sanitaires, toutes les mesures administratives et toutes les quarantaines. Tout au plus, peut-on songer rai- sonnablement à préserver certains groupes hu- mains, comme les salles d'hôpital, les prisons, les collèges, les couvents, etc.
L'isolement, si efficace pour toutes les maladies, contagieuses en général, est ici irréalisable, à
moins d'interrompre, pendant un temps déter- miné, les relations sociales et les contacts qu'elles, nécessitent. L'isolement rigoureux n'est applica- ble qu'à un petit nombre d'agglomérations d'in- dividus; on n'a pu guère en obtenir des effets réels que dans quelques rares établissements, quelques phares anglais, par exemple, ou quelques collectivités, comme certaines communautés re- ligieuses auxquelles les règles de l'ordre interdi- sent toute communication avec l'extérieur. D'ail- leurs, une épidémie en quelque sorte planétaire et ubiquitaire déjoue toutes les mesurés pro- phylactiques internationales ; seule, la pro- phylaxie individuelle peut avoir quelques chances d'aboutir à des résultats positifs. On a préconisé dans ce but des méthodes plus ou moins ingé- nieuses. Il convient tout d'abord de mettre, dès les premières heures, à l'abri de la contagion, les individus les plus exposés aux complications graves, tels les vieillards, les phtisiques, les diabétiques, les cardiaques, en un mot, tous ceux qu'une tare manifeste désigne comme une proie toute naturelle aux coups du terrible mal.
On a cherché, par des médications diverses,,à obtenir Y immunité. Goldschmidt croit qu'une ré- cente vaccination jennérienne peut mettre à l'abri de la grippe ôpidémique. Par contre, le Dr Kûss, en 1890, a découvert, par le plus grand des hasards, un effet fort singulier de l'influenza.
sur l'immunité conférée par la vaccine el même par la variole. C'est ainsi quo chez un certain nombre de personnes vaccinées sans succès quel- que temps auparavant, la grippe aurait eu cet étrange résultat de rendre positive une nouvelle inoculation vaccinale. Personnellement, leDrKûss, après avoir eu une varioloïdo en 1870, s'était depuis lors vacciné un certain nombre de fois sans succès ; il eut la grippe le 4 janvier 1890 et cette fois, sur quatre piqûres, il eut un superbe bouton vaccinal aussi classique que possible. A noter que la dernière revaccination, infructueuse d'ailleurs, avait eu lieu deux mois environ aupa- ravant, avec un virus de même provenance et de qualité supérieure. Sur une personne de sa fa- mille, à la même époque, un fait identique se produisit. Dans l'intérêt de tout le monde, il vau- drait mieux, selon le Dr Kûss, que ces faits fus- sent erronés.
D'après le Professeur Mossé, de Toulouse [Rev. de M éd., 1895), la quinine exerce une action pré- ventive et frénatrice sur les manifeslations de l'infection grippale. Comme médicament abortif, la quinine doit être prescrite à doses relative- ment élevées. En cas d'envahissement de l'orga- nisme par les agents des infections secondaires, il faut d'emblée avoir recours aux injections hypodermiques de quinine. L'auteur déclare avoir immunisé des lapins, en leur injectant du
sulfate de quinine dans les veines. Il résulterait des expériences de Mossé que la présence de la quinine dans le sang rend ce milieu peu favora- ble à la vie et au développement de la virulence du microbe do Pfeiffer.
Nous avons nous-même, dans une communica- tion faite au Congrès de Toulouse, en 1902, pré- conisé, comme médication préventive, les prépa- rations de quinquina, et, notamment, le vin de quinium que nous prescrivions fréquemment pendant l'épidémie de 1901.
Bruschettini déclare avoir vacciné des animaux en injectant des cultures de Yinfluenza-bacillus dans le sang ; le sérum de ces animaux constitue- rait un véritable vaccin contre l'influenza. A. Can- tani aurait obtenu des résultats positifs chez les cobayes, soit avec des cultures du bacille de Pfeiffer stérilisées à 56°, soit avec les exsudais péritonéaux et les émulsions de substance céré- brale recueillies chez des animaux ayant suc- combé à la grippe.
Il est rationnel de procéder à l'antisepsie rigou- reuse de la bouche et des fosses nasales, réceptacles de nombreux microbes à virulence aggravée et peut-être mêmedu microbe de Pfeiffer. On a préco- nisé, dans ce but, des solutions d'acide phonique, d'acide thymique, d'acide borique, etc. On vise surtout les infections secondaires dues au pneu- mocoque, au streptocoque, au staphylocoque, etc.
On procédera, comme pour la diphtérie, la fièvre typhoïde, la scarlatine, à la désinfection des vêtements, des linges, de la literie, des ten- tures, soit au moyen do l'étuve Geneste et Hers- cher, soit par le formol (appareil Treillat), soit par les vapeurs d'acide sulfureux, soit encore par les pulvérisations de sublimé, ces deux der- niers procédés étant d'une application plus facile à la campagne.
Traitement général
Que quelques cas légers de grippo guérissent, comme le voulait Peter, « les pieds sur les chenets », la chose est possible ; le repos au lit ou même à la chambre, les boissons chaudes peuvent suffire lorsque la fièvre est légère et qu'il n'existe qu'un peu de courbature et de trachéite; mais l'exjpectation, comme méthode prépondérante, n'a point rallié la majorité des praticiens. En réalité, dans une maladie où les infections secondaires jouent un si grand rôle, où les formes cliniques sont sou- vent si tranchées, où des complications graves peuvent éclater à l'improviste, le médecin doit, par une analyse clinique subtile, dégager les in- dications tenant à l'âge, à l'existence de tares or- ganiques, favoriser les fonctions du rein, tonifier de bonne heure le myocarde, relever, dès les pre- miers \jours, les forces du sujet, si enclin à l'as- thénie et à l'épuisement,i aux rechutes; bref,
dans une maladie aussi protéiforme, les indica- tions sont multiples et le scepticisme ne peut être admis.
En raison de la facilité déplorable avec laquelle les malades peuvent contracter, pour la moindre imprudence, des complications pulmonaires graves, il est formellement indiqué de garder le lit jusqu'à la disparition de la fièvre et de la tra- chéite. Pendant toute cette période, le régime ali- mentaire doit surtout consister en lait additionné d'un peu d'alcool, de café ou de quelques gouttes de teinture de kola, en bouillon dégraissé, en limonade vineuse; plus tard, les premiers ali- ments seront des végétaux. Le régime lacto-végé- tarien, comme le dit très bien Huchard, favorise la diurèse et diminue à la fois la toxicité intesti- nale et urinaire; on favorise ainsi la neutralisa- tion et l'élimination des toxines microbiennes en visant l'insuffisance rénale et hépatique, cette dernière étant trop souvent méconnue dans les maladies infectieuses.
Les premiers médicaments administrés ont pour but de combattre la fièvre, de calmer les algies qui manquent rarement et dé s'opposer à l'encombrement de l'arbre bronchique.
Le sulfate de quinine, contestable peut-être au point de vue de sa valeur prophylactique et de sa spécificité dans la maladie déclarée, doit être employé de très bonne heure. Pour Huchard, la
quinine est' un médicament antifluxionnaire, tonique, vaso-constricteur et hypertenseur ; l'hy- potension artérielle domine en effet dans la grippe. L'éminent clinicien associe l'ergot de seigle au sulfate de quinine (0,10 centigrammes d'extrait aqueux d'ergot et 0,10 centigrammes de sel quinique pour une pilule). Six à dix pilules par jour.
La quinine n'agit pas seulement commeantither- mique, mais encore comme antiseptique et comme tonique ; elle abrégerait la convalescence et s'op- poserait efficacement à l'asthénie grippale ; mais pour combattre les manifestations douloureuses, il convient de prescrire en même temps l'anti- pyrine. Ce dernier médicament, précieux dans ces circonstances, a été libéralement employé dans la grande épidémie de 1889-1890, mais n'a pas tardé, prescrit à fortes doses, à provoquer des accidents fâcheux consistant en sueurs pro- fuses, nausées, lipothymies, vomissements, ano- rexie, diminution de la sécrétion urinaire, etc. ; on l'a accusée aussi de faire naître des érup- tions variées. On a conseillé encore, comme agents antipyrétiques, la salipyrine dont l'action hypnotique se fait sentir sur la céphalalgie 4Von Mosengeil), la phénacéline, le salophène, le pyramidon ; l'aconit surtout a été préconisé par Grasset, associé à l'antipyrine, selon la formule suivante : ' ' -
Antjpyrine 2 grammes.
Teinture d'aconit 12 à 15gouttes.
Eau de tilleul 90 grammes.
Sirop de fleurs d'oranger. 30 —
Une cuillerée toutes les deux heures.
L'antipyrine et la quinine peuvent se prescrire conjointement :
Sulfate de quinine 0 gr. 25
Antipyrine 0 gr. 75
Pour un cachet : 2 à 3 par jour.
La salipyrine peut être employée à la dose de
'0,40 à 0,50 centigrammes chez l'adulte, la phéna-
cétine à celle de 0,50 centigrammes à 1 gramme,
le pyramidon de 0,50 centigrammes h 1 gramme.
Tous ces succédanés de la quinine ont des pro- priétés antithermiques peu désirables'; ce sont des dépresseurs du système nerveux et des inhi- biteurs de la sécrétion rénale. Huchard fait re- marquer que les formes apyréliques de la grippe sont les plus susceptibles de devenir graves et do se compliquer ; si bien qu'on peut soutenir que la fièvre, en favorisant les combustions et en soustrayant à l'organisme les toxines qui l'en- combrent, est souvent un réel élément de dé- fense. Pour Huchard, l'association de la quinine et de l'antipyrine est antiphysiologique ; c'est un mariage contre nature.
La balnéation tiède a été préconisée par le Professeur Manasséine, comme préventif immé- diat ou môme comme abortif. Cette médication d'ailleurs rationnelle est redoutée par certains malades.
Aux divers moyens que nous venons d'énumé- rer, il est indispensable de joindre l'ingestion abondante de boissons chaudes, tilleul, thé, légè- rement additionnées de rhum. Lorsque, malgré des doses suffisantes de quinine administrées pendant plusieurs jours, la fièvre se prolonge d'une façon désespérante, on pourra continuer quelque temps encore ce médicament à petites doses, mais peut-être conviendrait-il de le rem- placer par l'extrait de quinquina ou le vin de qui- nium.
Dans certaines formes sévères, sans complica- tions d'ailleurs, mais avec élévation thermique considérable et constante, il est indiqué de pres- crire plus que jamais la balnéation tiède en mênié temps que de grands lavements froids répétés matin et soir.
Le Dr Dumas, de Lédignan, emploie systémati- quement le calomel et n'a qu'à se louer de son efficacité; ce médicament, d'après le distingué praticien, agirait surtout On augmentant l'action antiloxique du foie. Le Dr Felsenthal préconise aussi le calomel qui, administré dès le début de la maladie, la jugulerait en quelque sorte et em-
pécherait, en tout cas, les complications habi- tuelles. La fièvre, la céphalée, la toux, les dou- leurs lombaires se dissiperaient en quelques heures.
Le Dr O'Neill, de New-York, associe le calomel a la poudre de Dower.
Pour prévenir les infections secondaires, il est formellement indiqué de pratiquer l'antisepsie et l'asepsie rigoureuse des cavités naturelles et de la surface de la peau. Les lavages de la bouche seront effectués avec diverses solutions : liqueur de Van Swietten (2 cuillerées à soupe dans un verre d'eau), solution de formol (0,50 cenligr, pour 1000), solutions mentholées(lgr. pour 1000), solution phéniquée (5 gr. pour 1000), d'acide thymique au 4000°, de phénosalyl (1 cuillerée à café par litre d'eau). PoUr l'antisepsie nasale, on instillera dans les narines quelques gouttes d'huile mentholée (à 2 ou 5 pour 100). On peut encore utiliser dans ce but les tubes Robert à la vaseline résorcinée,
Introduire trois fois par jour, gros comme un pois, de cette pommade dans chaque narine.
En ce qui concerne la peau, balnéation tiède, surtout abstention de vésicatoires. Pour Graves, de Dublin, d'ailleurs, l'impuissance des vésica- toires est une des particularités les plus remar- quables de l'histoire de la grippe. Il les remplaçait par des fomentations avec l'eau très chaude sur
la région trachéale et sur la poitrine ; ce moyen rendrait, d'après lui, d'incontestables services.
Dans les oreilles, on instillera trois fois par jour quelques gouttes de l'une des préparations suivantes :
Liqueur de Van Swietten. 10 grammes. Glycérine 30 --
ou :
Menthol 0 gr. 05.
Glycérine 25 grammes.
Pour ce qui concerne les lavages de là gorge, on pourra, trois fois par jour, faire des attouche- ments avec l'eau oxygénée au 10e.
On recommande aussi des pulvérisations du nez et de la gorge avec :
Phénosalyl : 0 gr, 50.
Chlorure de sodium 3 grammes.
Eau distillée bouillie.... 300 —
Les troubles respiratoires à peu près constants dans la grippe doivent être, traités avec la plus grande sollicitude
Le coryza, pren: 1ère manifestation de l'infection, ne doit pas être négligé. On fera pratiquer des pulvérisations de vaseline liquide, contenant 1 oul2 pour 100 de menthol, dans les deux nari- nes alternativement. Le nialade pourra priser de
emps en temps une petite quantité de la poudre suivante :
Sous-nitrate de bismuth... 6 grammes.
Benjoin pulvérisé........! 6 —.
Acide borique 0 gr. 20.
Menthol Ogr. 10.
Les irrigations nasales avec le siphon peuvent avoir des inconvénients graves, notamment la production d'une otite.
La laryngite réclame rarement une intervention sérieuse; les compresses chaudes, préconisées par Graves, au-devant du cou, apaisent assez ra- pidement les douleurs et l'enrouement.
Pour la trachéo-bronehite, les opiacés, très re- commandés par Graves, seront administrés sous forme de sirop diacode, de sirop de codéine, de lactucarium, de dionine et pourront être asso- ciés à l'eau de laurier-cerise, à la teinture d'aconit et à la belladone, selon la formule suivante :
Infusion d'espèces butiques. 125 grammes.
Sirop de codéine 15 —
Sirop de belladone......... 10 —
Eau de laurler-cerlse 5 —
Alcoolature de racine* d'aconit... 5 gouttes. Benzoate de soude.......... 1 gramme.
Une cuillerée à bouche toutes les deux heures. La poudre de Dowcr, excellente préparation,
peut être administrée à la dose de 0,20 à 0,30 cen- tigrammes par jour.
Le chlorhydrate d'ammoniaque a été très vanté, dès 1847, par Marrottecontrelapleurésiegrippale ; il est revenu en honneur dans ces derniers temps, mais est surtout employé pour favoriser l'expec- toration ; il se prescrit à la dose de 1 à 2 grammes par jour dans une potion appropriée contenant du sirop thébaïque à petites doses.
D'après Marrotte, le chlorhydrate d'ammo* niaque, utile dans les fièvres intermittentes pa- ludéennes, jst surtout efficace dans les affections catarrhales sporadiques. Il cite la guérison très rapide d'une dame de soixante ans atteinte de dyspnée, toux sibilante et fièvre vive. Il déclare avoir eu également des succès remarquables dans la broncho-pneumonie, la pneumonie infectieuse etdanslagrippeà formede congestion pulmonaire.
Marrotte préconise aussi le jaborandi dont il a pu constater l'efficacité remarquable chez un ma- lade atteint de grippe à forme sudorale. Il prescri- vit 1 gr. 50 de poudre de jaborandi dans un demi- verre d'eau chaude. Quelques semaines après, nouvelle attaque et succès avec le môme moyen.
D'après le D'Gilbert Serslron, de la Bourboule, le cacodylate de gnïacol, en injections sous-cuta- nées, constituerait un remède spécifique contre la grippe. Le Dr Durlureaux, professeur nu Vol-de- Gràce, affirme qu'une ou deux doses de 0,05 ccn*
tigrammes suffisent à juguler la maladie ; la con- valescence se trouverait surtout notablement abrégée.
Le Dr Allson, de Baccarat [Arch. gén. de Méd., 1890), a obtenu des résultats remarquables do l'usage du tannin qu'il a employé depuis 1887. Ce médicament, à la dose de 2 grammes par jour et en trois fois, entraîne des modifications très heureuses dans les diverses fluxions catar- rhales que provoque la grippe. Le coryza, l'an- gine, la laryngo-trachéite se modifient à ce point que la période de coction se produit presque d'emblée ; l'écoulement nasal se transforme très rapidement en un mucus épais et jaunâtre ; les sécrétions de la gorge, du larynx, de la trachée et des bronches deviennent moins abondantes et plus épaisses; la toux est moins quinleuse et plus facile. Le tannin aurait, en outre, une effi- cacité réelle dans l'amélioration des troubles ner- veux, surtout de la céphalalgie fronto-temporale. Les algies se reproduisent dès que l'on supprime le médicament. Le Dr Alison proteste contro les méfaits du tannin, tels que inappétence, douleurs abdominales, ballonnement, etc. Le tannin, pour lui, s'oppose surtout aux fermentations putrides et diminue, par son nstrlngcnce, les hyperhémies et les fluxions catarrhalos créées par la grippe. Contre la toux quinleuse, coqueluchoïdo qui est parfois d'une opiniâtreté désespérante, on a
recommandé le bromoforme associé à l'aconit. Le bromure de potassium peut, dans ce cas, rendre aussi quelques services :
Bromoforme 0 gr. 30
Alcoolature de racines d'aconit.. 0 gr. 30
Eau-de-vie vieille 30 gr. »
Sirop de codéine. 25 gr. »
Sirop de Tolu., 200 gr. »
Bromure de potassium 3 gr. »
Trois cuillerées à soupe par jour.
Huchard, dans ce cas, recommande la formule suivante :
Sulfate do quinine 0 gr. 10
Extrait de quinquina 0 gr. 10
Extrait de racines d'aconit 0 gr. 005
Pour une pilule : 3 deux fois par jour.
Dès que l'expectoration mucopurulente se pro- duit, la terpine est utilisée suivant des formes variées :
Terpine 0 gr. 10
Acide benzoïque 0 gr. 10
Poudre d'opium brut 0 gr. 01
Pour une pilule : 4 par jour.
L'éllxtr do terplno est employé à la dose de 2 à 4 cuillerées à dessert par jour dans une infu- sion d'espèces pectorales.
L'encombrement bronchique peut être com*
battu par l'ipéca, non pas à dose vomitive, mais sous forme de quelques grammes de sirop dans une potion renfermant, en outre, 1 ou 2 grammes de chlorhydrate d'ammoniaque. La poudre de Dower, qui contient de l'ipéca, de l'opium et du nitrate de potasse, peut être utilisée dans le môme but. La bronchoplégie (paralysie pulmo- naire de Graves), bien étudiée par Huchard et ■qui aboutit à l'asphyxie, sans que l'auscultation révèle le moindre signe physique, est justi- ciable de l'emploi de la strychnine qu'on peut administrer soit par la bouche, soit par injections hypodermiques. Par la voie stomacale, on peut en prescrire 1 à 2 milligrammes par jour dans une potion appropriée. Par la voie sous-cutanée* on doit administrer dans les vingt-quatre heures le contenu de deux demi-seringues de Pravaz d'une solution renfermant 0,01 centigramme de sulfate de strychnine dans 10 grammes d'eau dis- tillée. Nous avons eu l'occasion de faire pratiquer avec succès, dans un cas de ce genre, l'électrisa- tlon du pneumogastrique.
La congestion pulmonaire, dont les allures sont -si souvent capricieuses et qui peut donner lieu à de petites hémoptysles, notamment chez'des ■sujets à myocarde suspect, doit être combattue avec persévérance. Peter n'hésitait pas à appliquer un véstcatoiro \ aujourd'hui, cette médication est •considérée comme dangereuse. On peut employer
v dès le début l'enveloppement ouaté du thorax, les cataplasmes sinapisés, les ventouses sèches, lès feuilles iodées, voire môme l'enveloppement d'un côté du thorax par des compresses imbibées d'eau froidoàl8°,laisséesen place une demi-heure, après avoir été recouvertes de taffetas chiffon.
L'ergotine peut ôtre associée, dans ces cas, à la strychnine :
Ergotine 1 gr. 50
Sulfate de strychnine 0 gr. 001
Julepgommeux 125 gr. »
Une cuillerée à soupe toutes les deux heures.
Le tannin, à la dose de 0,60 centigrammes deux fois par jour, pourrait être utilisé ; il en est de même de l'ipéca que Pécholier considérait comme un excellent décongestionnant du poumon.
Dans les cas de faiblesse du myocarde et de menace d'oedème pulmonaire, on peut adminis- trer la caféine en potions ou en injections hypo- dermiques, mais c'est surtout à la digitale qu'il faut avoir recours. Nous la recommanderions volontiers sous forme d'infusion de feuilles de digitale à doses décroissantes pendant trois jours.
Le Professeur Grasset n'hésite pas à prescrire l'ipéca à hautes doses, dans le traitement de la congestion pulmonaire t
Ipéca 2 grammes.
Ecorces d'oranges amères 1 4 —• Eau 100 -
Faire bouillir jusqu'à réduction à 90 grammes, laisser infuser, filtrer, ajouter :
Sirop do polygala 30 grammes.
Une cuillerée à bouche toutes les deux heures.
Les pneumonies grippales, nous le savons, ont des caractères un peu spéciaux, tels que l'insi- diosité du début, le peu do netteté de la défer- vescence, la multiplicité des formes, l'irrégula- rité de la marche, l'évolution par poussées, l'expectoration plutôt muco-purulente, la pros- tration, l'asthénie, etc. Pneumonies loba ires et broncho-pneumonies, avec dés différences radi- cales dans les lésions anatomo-pathologlques, ont de grandes analogies cliniques. L'hépatisa- tion grise, la gangrène sont des aboutissants fréquents. Les vésicatoires, les antimoniaux sont ici détestables. Le D* Poulet, de Plancher- des-MInes, recommande, presque à l'égal d'un spécifique, le chlorhydrate de pilocarpine à la dose quotidienne de 0,0b centigrammes pen- dant deux jours Sur 108 malades, il n'aurait eu que 4 décès. Mais la conduite à* observer, sans perdre du temps, consiste à soutenir le coeur par la digitaline en solution au millième, à la dose de 30, 40 ou même 50 gouttes à la fois dès le premier ou le second Jour. Huchard recom- mande, en outre, les injections sous-cutanées de
caféine, le bromhydrate de quinine à la dose de 1 gramme, les injections d'éther, d'huile cam- phrée, voire même de strychnine, l'antisepsie in- testinale par le bénzo-naphtol et le régime lacté. Comme moyens adjuvants, on prescrit d'ordi- naire la teinture de kola et de quinquina, la solu- tion officinale d'acétate d'ammoniaque, le Cham- pagne, le porto, le xérès, etc.
Les enveloppements froids du thorax et la bal- néation tiède doivent être aussi employés sans timidité dans certains cas. Les inhalations de nitrite d'amyle, préconisées par Hayem; pour- raient rendre des services. Toits ces moyens doi- vent être mis en oeuvre dès les premières heures, constituant ce que Grasset appelle les méthodes de vitesse.
Les pleurésies grippales peuvent être sèches et bilatérales; ce sont les pleuro-ccllulites décrites par Morel-Lavallée et s'accompagnant de dou- leurs pleurodyniques assez vives. Les applications réitérées de pointes de feu, les badigeonnages gaïacolésà petites doses, les badigeonnages iodés seront employés avec succès. Certaines pleurésies séro-fibrlneuses guérissent parfois sans l'inter- vention de la thoracentèse ; mais la transforma- tion purulente se produit avec une facilité déplorable, d'où l'Indication d'avoir' recours hâtivement à Y opération de l'empyème, dès que l'état général devient mauvais et qu'une ponction
exploratrice a révélé la purulence* de l'épanché^ nient. Le coeur doit être surveillé ayeo une grande, attention; il fléchit, comme nous le savons déjà, dans là pneumonie, mais la myocardite peut exister isolément. Lorsque les battements du coeiîr sont irréguliers, mal frappés, quiB le pouls est Instable et, que l'hypotension apparaît, sans attendre.la tachycardie ou le rythme foetal, il faut stimuler la fibre cardiaque parles injections sous-cutanées dé caféine et d'éther et par l'emploi du sérum artificiel à hautes doses. Comme moyens auxiliaires, on peut utiliser l'extrait de quinquina, la teinture de kola, le Champa- gne, etc.
Les déterminations gastro-intestinales occupent une place importante dans l'évolution de la grippe; parfois même, elles jouent un rôlo pré- pondérant, quand, surtout, le malade est déjà un dyspeptique. D'ailleurs, tout l'appareil digestif peut être en cause, soit dans sa totalité, soit dons l'une quelconque de ses parties. La cavité buc- cale et le pharynx sont assez fréquemment inté- ressés et le praticien ne doit pas négliger l'exa- men de ces cavités.
Nous avons déjà parlé de certaines éruptions rubéoliformes envahissant parfois la région pala- tine, ainsi que de quelques complications buc- cales et dentaires ; nous renvoyons le lecteur aux descriptions précédemment faites; nous avons
étudié aussi la langue grippale, la tuméfaction des papilles de la langue avec aspect framboise, les ulcérations géométriques du type aphteux, la gingivite, etc., etc. Ces lésions buccales peu- vent être assez facilement enrayées par des lava- ges antiseptiques avec une solution borlquée ou une solution de phénosalyl à 2 pour 1000. On petit faire des attouchements avec la vaseline sa- lolée, ou des eautérisn lions avec le mélange pho- nique de Gaucher. Dans les gingivites, badigeon- nages avec un mélange à parties égales de teinture d'iode et d'aconit.
Les angines infectieuses aiguës sont plus fré- quentes, plus graves et doivent êtro traitées éner- gtquement. (Consulter Escat, Maladies du pha- rynx,)
Dans les angines infectieuses aiguës avec lésions superficielles, on prescrira des gorgarismes ré- pétés toutes les deux heures avec une des prépa- rations suivantes :
1° Phénosalyl à 2 p. 1000, 2° Hésorcine... 1 à 2 p. 1000.
Chez l'enfant, on fera pratiquer des douches pharyngées avec l'une des solutions suivantes :
1° Acide salyctilque...... 1 gramme.
Alcool..... 00 -^
Eau bouillie........... 000 —
2<> Mlcrocldine......*..».. 1 à 2 p. 100. •