Version actualisée
==POURQUOI UN MUSÉE DU FER?==
Les musées sont nés de ces grandes collections où souverains et princes amassaient les oeuvres d'art. La « nationalisation » de ces collections a permis, et parfois depuis fort longtemps, de montrer ces oeuvres d'art au public et ainsi de lui donner un goût plus sûr, de l’éduquer. Au départ, musée et oeuvre d'art paraissaient inévitablement liés.
Quand on conçut, sous Louis-Philippe, un musée de l'histoire de France au palais de Versailles, la conception était toujours identique. L'histoire de France n'était représentée encore que par des oeuvres d'art, anciennes ou contemporaines : le musée était toujours le moyen d'expression des artistes pour instruire le public.
La création du musée des archives, sous Napoléon III, fit pour la première fois évoluer les musées vers la présentation d'autres objets, les témoins mêmes de l'histoire.
De l'histoire on est passé, à la fin du siècle, vers une géographie toute humaine, l'ethnographie. Ceux qui créèrent le musée de l'homme avaient pour objectif primordial de montrer l'art d'autres civilisations que la nôtre. La phrase de Valéry, au fronton de l'actuel musée, traduit bien cette impression: « Choses rares ou choses belles ici savamment assemblées, instruisent l'oeil à regarder, comme jamais encore vues, toutes choses qui sont au monde. » La rareté ou la beauté seules étaient jugées dignes de figurer dans un musée.
Il existait cependant d'autres collectons. Déjà, sous Louis XIV, on avait envisagé d'installer dans une galerie du Louvre une collection des modèles des machines les plus perfectionnées, afin d'instruire les artisans et leur donner l'idée et les moyens de transformer leurs techniques. L'idée fut véritablement réalisée, par ce grand technicien que fut Vaucanson, à l'hôtel de Mortagne.
La Révolution mit cette collection à la portée du public en créant le Conservatoire national des arts et métiers. De même que les musées d'histoire naturelle, dont le plus connu était le Muséum, ce nouveau type de musées était destiné à servir de démonstration à des cours qu'on jugeait alors un peu trop théoriques. Muséum, Conservatoire des arts et métiers, musée Dupuytren à la Faculté de Médecine, tout cela n'était qu'annexe d'un enseignement. Mécanique de la nature ou mécanique créée par l'homme, tout y devait être matière à démonstration.
Dans certains pays, ces musées techniques devinrent aussi musées scientifiques par l'apport de ces collections d'instruments de physique qui s'étaient multipliées vers la fin du XVIIIe siècle.
L'histoire de l'art est ancienne ; l'histoire des sciences est née plus tardivement, l'histoire des techniques est toute récente. Ce sont les savants qui ont transformé les musées en leur donnant pleinement le rôle d'éducateur qu'ils devaient avoir. Les oeuvres d'art, autrefois serrées les unes contre les autres, dans un ordre approximatif commandé souvent par les formats ou les donations, ont fait place à des choix et à une ordonnance qui répondent à une logique pédagogique. Si le musée est toujours resté le refuge de ceux qui sont sensibilisés à l'expression artistique, qui ne cherchent de plaisir qu'à l'oeuvre prise isolément, les rapprochements, les contrastes permettaient à d'autres d'affiner leurs connaissances et surtout de les ordonner de façon à en tirer le meilleur parti possible.
Cette conception nouvelle a atteint tous les autres musées. L'objet beau, rare ou curieux, n'a plus paru satisfaisant pour rendre compte d'une civilisation, d'un moment de l'histoire. Dans nos musées ethnographiques, dans nos musées des arts et traditions populaires, dans nos musées d'histoire, on s'est alors efforcé de compléter la présentation de façon à donner une idée d'ensemble capable de rendre compte de tous les aspects d'une réalité complexe.
Cette évolution cadrait parfaitement avec l'évolution de la science historique qui, sans abandonner les hauts faits ou les grandes personnalités de notre histoire, se devait, pour fournir une explication globale, d'aller plus au fond des choses.
Les musées techniques ont suivi, un peu par nécessité. A mesure que se perfectionnaient les moyens de production, il a fallu pour continuer l'oeuvre d'éducation pour laquelle ils avaient été fondés, montrer d'autres modèles. Du conservatoire des arts et métiers on est ainsi insensiblement passé au musée d'histoire des techniques. Et l'on conçoit parfaitement qu'en 1903, les Allemands aient eu l'idée de construire, ex nihilo, un véritable musée d'histoire des techniques : ils firent d'un coup ce que les autres étaient devenus par une lente évolution.
Concevoir un musée de l'humanité serait absurde, un musée qui serait à la fois celui de la nature, de l'homme et de l'histoire sous tous ses aspects qui montrerait à côté des « choses rares et des choses belles », les témoins, sous toutes les formes, de nos préoccupations quotidiennes.
Choisir une activité, un aspect d'une civilisation, était certainement plus praticable et non moins intéressant. Ici la marine ou la pêche, là le tabac, ailleurs encore l'olivier, ou le vin pouvaient donner matière à rassembler, sans une optique particulière, les chefs-d’oeuvre et les humbles objets qui en étaient le support sensible. Le visiteur du musée du vin à Beaune (il y en a aussi à Spire en Allemagne, à Krems en Autriche) sait tout ce que l'on peut tirer, avec beaucoup de science et de goût, d'une semblable idée.
Notes sur la version actualisée
<headertabs/>
|
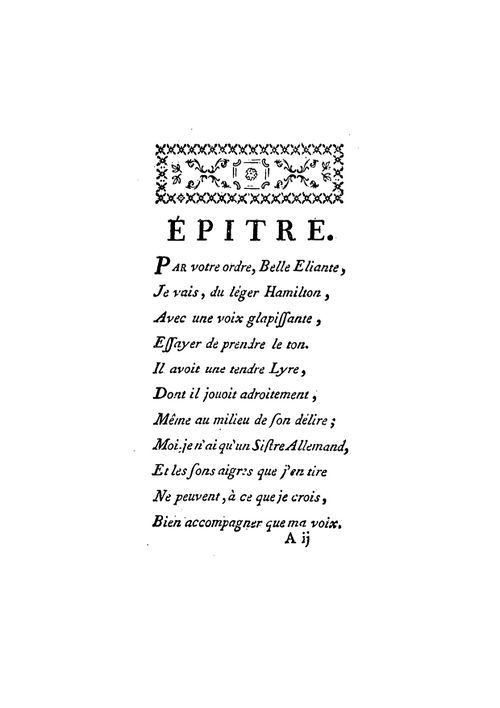
|