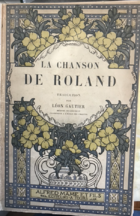La Chanson de Roland/Léon Gautier/Édition populaire/1895/Partie 1/Saragosse

|
La Chanson de Roland Vingt-deuxième édition Édition populaire - 1895 Préface - Introduction - Traduction et commentaires - Éclaircissements - Appendices |
Sommaire
Les couplets (laisses)
| Charles le roi, notre grand empereur, | |
| Sept ans entiers est resté en Espagne ; | |
| Jusqu’à la mer, il a conquis la haute terre. | |
| Pas de château qui tienne devant lui, | |
| 5 | Pas de cité ni de mur qui reste encore debout. |
| Hors Saragosse, qui est sur une montagne. | |
| Le roi Marsile la tient, qui n’aime pas Dieu, | |
| Qui sert Mahomet et prie Apollon ; | |
| Mais le malheur va l’atteindre : il ne s’en peut garder. [AOI] |
Notes originales
1. Charles
Au moment où s'ouvre l'action du Roland, le Charlemagne de la légende est maître de toute l'Espagne du nord : et c'est la seule que connaissent nos épiques. Un poème du commencement du XIVe siècle, mais qui a des racines dans la tradition, la Prise de Pampelune, nous raconte la prise de Pampelune par les français de cette ville, du Groïng (Logrono) et de la Stoille (Estella) puis celle de Tolède, de Cordoue, de Charion, de Saint- Fagon, de Masele, de Léon et d'Astorga. Un autre poème (du xn e siècle, mais moins traditionnel et qui n'a aucun lien avec le Roland), Gui de Bourgogne, nous fait assister à la conquête imaginaire île Carsaude, de Montorgueil , de Montesclair, de la tour d'Augorie, de Maudrane et de Luiserne. Bref, il ne reste alors devant Charlemagne qu'un seul adversaire en Espagne, c'esl Marsile, et une seule ville à emporter, c'est Saragosse. = L'histoire est plus modeste que la légende. En 778, Charles conduisit, en effet, une expédition en Espagne. 11 passa les Pyrénées, s'empara de Pampelune, mais échoua, semble-t-il, devant Sara-.>s>e. et conquit seulement le pays jusqu'à l'Èbre. C'est au retour de celle expédi- tion qu'eut lieu le grand désastre de Roncevaux. (Éginhard, Vita Caroli, ix ; Annales faussement attribuées à Egin- hard, année 778: l'Astronome limousin, Vita Hludovici, dans les Scriptores de Pertz, m, 608, etc.)
1. Notre grand empereur
7. Marsile
8. Mahomet
L'auteur du Roland ne connaissait pas l'islamisme et s'imaginait, avec nos autres poètes, que les Sarrasins adoraient des idoles, tout comme les Grecs et les Romains. Les trois principales idoles des infidèles au- raient élé ; d'après nos Chansons de geste, Mahom (Mahomet), Apollin (Apollon), Tervagan (?); et c'est ainsi que nos pères mettaient sur le compte du mahométisme toutes les erreurs des paganismes anciens.
9. AOI
Cette notation esl demeurée inexpliquée. 11 est inadmissible qu'aoi soit pour avoi, lequel viendrait d'ad viam et signifierait: « Allons en route. ».
Il suffit, pour renverser cette opinion de M. Génin, de remarquer qu'ad viam aurait donné dans notre dialecte, non pas avoi, mais à veie.
C'est à tort que M. Michel a d'abord 'assimilé ce mot à notre euouae liturgique {saeculorum amen), et plus tard « au saxon abeg ou à 1'anglais away. exclamation du jongleur pour avertir le ménétrier que le couplet finit ».
M Alex, de Saint-Albin traduit AOI par « Dieu nous aide » et y voit (!) le verbe «adjuder » ; mais on trouve, dans la Chanson, que les formes ait et aiut venant du subjonctif adjuvet.
Une troisième opinion de M. Michel vaut mieux que les deux premières : « Aoi, suivant lui, serait un neume. Les neumes sont, comme on le sait la notation musicale qui a précédé la notation, sur portée ou notation guidonienne. Mais cette théorie n'a encore été appuyée d'aucune preuve.
Le mot aoi ne peut, suivant nous, être expliqué que comme une interjection analogue à notre ohé! Ahoy est encore eu usage dans la marine anglaise., où l'on dit : Boat ahoy, comme nous disons Ho, du canot.