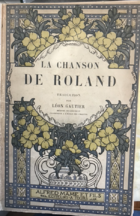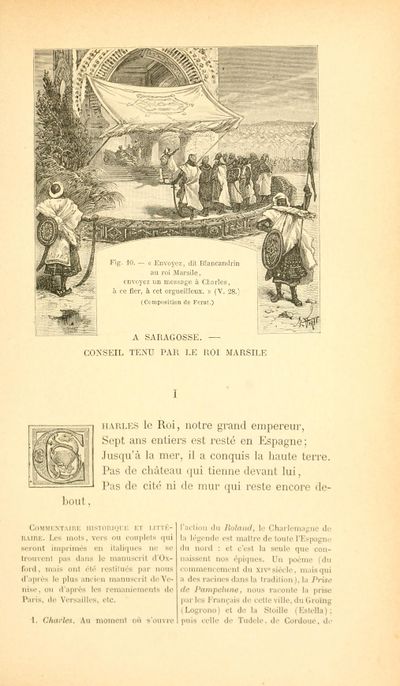La Chanson de Roland/Léon Gautier/Édition populaire/1895/Partie 1/Saragosse : Différence entre versions
(→9. AOI) |
(→VI) |
||
| Ligne 240 : | Ligne 240 : | ||
| | | | ||
|Le conseil de Marsile est terminé. | |Le conseil de Marsile est terminé. | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |« Seigneurs, » dit-il à ses hommes , « vous allez partir | ||
| + | |- | ||
| + | |80 | ||
| + | | « Avec des branches d'olivier dans vos mains. | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version du 26 novembre 2021 à 18:38

|
La Chanson de Roland Vingt-deuxième édition Édition populaire - 1895 Préface - Introduction - Traduction et commentaires - Éclaircissements - Appendices |
Cette page introduit le premier chapitre de la première partie de La chanson de Roland, édition populaire, publiée en 1895.
Conseil tenu par le roi Marsile
Sommaire
- 1 Les couplets (laisses)
- 2 Notes originales
- 2.1 1. Charles
- 2.2 1. Notre grand empereur
- 2.3 7. Marsile
- 2.4 8. Mahomet
- 2.5 9. AOI
- 2.6 14. À ses ducs, à ses comtes
- 2.7 16. France la douce
- 2.8 31. Mille auteurs qui aient mué.
- 2.9 36. En France à Aix.
- 2.10 37. A la fête de saint Michel.
- 2.11 52. A sa chapelle d'Aix.
- 2.12 58. La vie
- 2.13 62. Couplets similaires
- 2.14 63. Balaguer
- 2.15 71. Cordoue
- 3 Voir aussi
Les couplets (laisses)
I
| Charles le roi, notre grand empereur, | |
| Sept ans entiers est resté en Espagne ; | |
| Jusqu’à la mer, il a conquis la haute terre. | |
| Pas de château qui tienne devant lui, | |
| 5 | Pas de cité ni de mur qui reste encore debout. |
| Hors Saragosse, qui est sur une montagne. | |
| Le roi Marsile la tient, qui n’aime pas Dieu, | |
| Qui sert Mahomet et prie Apollon ; | |
| Mais le malheur va l’atteindre : il ne s’en peut garder. [AOI] |
II
| 10 | Le roi Marsile était à Saragosse. | |
| Il est allé dans un verger, à l'ombre; | ||
| Sur un perron de marbre bleu se couche ; | ||
| Autour de lui sont plus de vingt mille hommes. | ||
| Il adresse alors la parole à ses ducs, à ses comtes : | ||
| 15 | « Oyez, seigneurs, » dit-il, « le mal qui nous accable : | |
| « Charles, l'empereur de France la douce, | ||
| « Pour nous confondre est venu dans ce pays. | ||
| « Plus n'ai d'armée pour lui livrer bataille ; | ||
| « Plus n'ai de gent pour disperser la sienne. | ||
| 20 | «Comme mes hommes sages, donnez- moi un conseil | |
| « Et préservez-moi de la mort, de la honte. » | ||
| Pas un païen, pas un qui réponde un seul mot , | ||
| Hors Blancandrin, du château de Val-Fonde. [AOI] |
III
| Blancandrin, parmi les païens, était l'un des plus sages, | |
| 25 | Chevalier de grande vaillance, |
| Homme de bon conseil pour aider son seigneur : | |
| « Ne vous effrayez point, dit-il, au Roi. | |
| « Envoyez un message à Charles, à ce fier, à cet orgueilleux ; | |
| « Promettez-lui service fidèle et très grande amitié. | |
| 30 | « Faites-lui présent de lions, d'ours et de chiens, |
| « De sept cents chameaux, de mille autours qui aient mué ; | |
| « Donnez-lui quatre cents mulets chargés d'or et d'argent , | |
| « Tout ce que cinquante chars peuvent porter. | |
| « Bref, donnez-lui tant de besants d'or pur, [NDLR 1] | |
| « Que le roi de France enfin puisse payer ses soldats. | |
| 35 | « Mais il a trop longtemps fait la guerre en ce pays |
| « Et n'a plus qu'à retourner en France, à Aix. | |
| « Vous l'y suivrez, — direz -vous, -- à la fête de saint Michel. | |
| « Et là, vous vous convertirez à la foi chrétienne, | |
| « Vous serez son homme en tout bien, tout honneur. | |
| 40 | « S'il exige des otages, eh bien! envoyez-en |
| « Dix ou vingt, pour avoir sa confiance. | |
| « Oui, envoyons-lui les fils de nos femmes. | |
| « Moi, tout le premier, je lui livrerai mon fils, dût-il y mourir. | |
| « Mieux vaut qu'ils y perdent la tête | |
| 45 | « Que de perdre, nous, notre seigneurie et notre terre , |
| « Et d'être réduits à mendier. » | |
| El les païens de répondre : « Nous vous l'accordons volontiers.[NDLR 1] » [Aoi]. |
IV
| « Par ma main droite que voici, » dit Blancandrin, | |
| « Et par cette barbe que le vent fait flotter sur ma poitrine, | |
| « Vous verrez soudain les Français lever leur camp. | |
| 40 | Et s'en aller dans leurs pays, en France. |
| « Une fois qu'ils seront de retour en leur meilleur logis, | |
| « Charles, à sa chapelle d'Aix, | |
| « Donnera, pour la Saint-Michel, une très grande fête | |
| « Le jour où vous devrez venir arrivera, le terme passera , | |
| 55 | Et Charles ne recevra plus de nos nouvelles. |
| « L'empereur est terrible , son cœur est implacable ; | |
| « Il fera trancher la tête de nos otages. | |
| « Mais il vaut mieux qu'ils y perdent la vie | |
| « Que de perdre, nous, claire Espagne la belle, | |
| 60 | « Et de souffrir tant de maux et de douleurs. |
| « — Il en pourrait bien être ainsi, » s'écrient les païens. Aoi. |
V
| Le conseil de Marsile est terminé. | |
| Le Roi mande alors Clarin de Balaguer, | |
| Avec Estramarin et son pair Eudropin , | |
| 65 | Priamus avec Garlan le barbu, |
VI
| Le conseil de Marsile est terminé. | |
| « Seigneurs, » dit-il à ses hommes , « vous allez partir | |
| 80 | « Avec des branches d'olivier dans vos mains. |
VII
| Marsile fit alors amener dix mules blanches | |
| 90 | Que lui envoya jadis le roi de Sicile. |
Notes originales
1. Charles
Au moment où s'ouvre l'action du Roland, le Charlemagne de la légende est maître de toute l'Espagne du nord : et c'est la seule que connaissent nos épiques. Un poème du commencement du XIVe siècle, mais qui a des racines dans la tradition, la Prise de Pampelune, nous raconte la prise de Pampelune par les français de cette ville, du Groïng (Logrono) et de la Stoille (Estella) puis celle de Tudèle, de Cordoue, de Charion, de Saint-Fagon, de Masele, de Léon et d'Astorga. Un autre poème (du XIIe siècle, mais moins traditionnel et qui n'a aucun lien avec le Roland), Gui de Bourgogne, nous fait assister à la conquête imaginaire de Carsaude, de Montorgueil , de Montesclair, de la tour d'Augorie, de Maudrane et de Luiserne. Bref, il ne reste alors devant Charlemagne qu'un seul adversaire en Espagne, c'est Marsile, et une seule ville à emporter, c'est Saragosse. = L'histoire est plus modeste que la légende. En 778, Charles conduisit, en effet, une expédition en Espagne. 11 passa les Pyrénées, s'empara de Pampelune, mais échoua, semble-t-il, devant Saragosse. et conquit seulement le pays jusqu'à l'Èbre. C'est au retour de celle expédition qu'eut lieu le grand désastre de Roncevaux. (Éginhard, Vita Caroli, ix ; Annales faussement attribuées à Egin- hard, année 778: l'Astronome limousin, Vita Hludovici, dans les Scriptores de Pertz, m, 608, etc.)
1. Notre grand empereur
Charles est le fils de Pépin le Nain et de la bonne reine Berte au grand pié. Ses enfances furent douloureuses, et il lui forcé, par d'indignes usurpateurs, d'aller cacher sa jeune gloire chez les musulmans d'Espagne. C'est là qu'il devint l'époux de la belle Galienne, fille du roi sarrasin Galafre. A peine marié avec elle, il alla reconquérir son royaume de France contre les traîtres qui l'avaienl usurpé, puis se précipita vers Home à Ja défense du Pape, et, grâce au cou- rage d'Ogier le Danois, rendit au Sou- verain Pontife la ville éternelle, que les païens avaient inutilement assiégée. (Berte au grand pié, xm e siècle; Mai- net, xn« s.; Charlemagne de Girard d'Amiens, xiv e s.; Ogier de Dane- marche, xn e s.; Enfances d'Ogier, xm e s.) = Durant toute sa vie, il ne cessa de guerroyer contre les Sarrasins, les Saxons et tous les païens; assista aux débuis de Roland sur le champ de ba- taille d'Aspremont, et y vainquit le ter- rible A golant (Aspremont, xii e -xm e s.); fut l'heureux témoin de la défaite des géants Fierabras et Olinel ; fit le grand voyage de Jérusalem et de Constanti- nople et étonna tout l'Orient par les splendeurs d'une gloire à son apogée; prit le temps, entre deux expéditions contre les ennemis de Jésus- Christ, de triompher de ses vassaux rebelles, de Girart de Yiane et d'Huon de Bordeaux, mais surtout d'Ogier le Danois et des quatre fils Ainion, et enleva vigoureu- sement la petite Bretagne aux envahis- sements des Sarrasins. (Fierabras, xiii- s.; Otinel, xm e s.; Voyage à Jéru- salem, commencement du xn e s.; Gi- rard de Viane, xn e s.; Huon de Bor- deaux, xii s.; Ogier le Danois, xn e s.; Renaut de Montauban,xu\° s.;Acguin, fin du xir- s.) C'est ce même Charle- magne qui, sans cesse en communion avec le ciel, avec les anges, reçut du glorieux apôtre Jacques l'ordre d'aller reprendre l'Espagne aux profanateurs des saintes reliques; se dirigea, avec sa grande armée, vers les Pyrénées et fut le spectateur de la lutte héroïque entre Roland el le géanl Ferragus ; qui mil énergiquement le siège devant Pampe- lune et s'empara de ce boulevard des païens; qui resta sepl ans sur la terre d'Espagne; nue Gui de Bourgogne y vint rejoindre avec tous les jeunes che- valiers de fiance; qui reçut une am- bassade du roi Marsile, se soumettant enfin aux armes de l'empereur à la barbe fleurie; qui fui lâchement trahi par Ganelon, ce Judas de la Fiance; qui connut l'horrible épreuve de survivre à la grande défaite de Ronceveaux et au deuil cruel de la mort de Roland ; qui vengea son neveu dans la célèbre bataille de Saragosse et fil écarteler Ganelon, comme on le verra dans la suite de notre poème. (Entrée en Espagne, xin°, XIV e s.; Prise de Pam- pelune, xiv° s.; Gui de Bourgogne, xn e s.; Chanson de Roland, fin du xr ! s.) Voy., pour plus de détails, dans nos éditions classiques, l'Éclaircissement sur la légende de Charlemagne.
7. Marsile
Ce personnage n'a rien d'historique; mais son rôle est considérable dans la légende. Un Marsile figure dans le récit des < enfances » de Charlemagne ; c'est le frère de celte Galienne qui fui la première femme du grand empereur (Charlemagne de Gi- rart d'Amiens, compilation du com- mencement du xj\ e siècle, etc.). Dans le Karl de Stacker (poème allemand d'environ 1230), ce mèrne Marsile nous est présenté, tout au contraire, comme l'allié du jeune Charles. Mais ce n'est point là le vrai Marsile, et les poètes du moyen âge ont usé, ici comme ailleuis, de ce procédé qui consiste à domier le mèrne nom à des personnages de même physionomie. Voici maintenant ce qui concerne réellement le héros païen du Roland... D'après l'Entrée en Espagne (poème du xiv e siècle, mais renfermant des fragments du xiii* et qui copie ici le faux Turpin), c'est contre Marsile qu'est dirigée la grande expédition de Charles au delà des Pyrénées. Le fameux géant Ferragus, contre lequel luttent les douze Pairs et dont le seul Roland triomphe, n'est autre que le neveu de Marsile. Sous les murs de Pumpelune, le roi de France trouve devant lui le mèrne ennemi, et l'auteur de la Prise de Pampelune ( commencement du {XIVe siècle ) nous fait assister à la fin de ce siège célèbre : c'est alors que Marsile ordonne la mort des deux ambassadeurs de Charles, Basin et Basile, et qu'il perd dix de ses meilleures villes. C'est Marsile encore qui, dans Gui de Bourgogne (XIIe siècle), résiste aux armées chrétiennes. Quant à la chronique de Turpin (qui sauf les cinq premiers chapitres, adû être rédigée vers 1109-1119), elle fait de Marsire un frère de Beligand, et nous les montre chargés tous deux par l'émir de Babylone de tenir tête aux français. Le récit latin rapporte, avev de grand détails, l'ambassade, le désastre de Roncevaux et la mort de Marsile, que Roland frappe d'un coup mortel quelques instants avant de mourir lui-même (cap.,xxi-xxiii).
8. Mahomet
L'auteur du Roland ne connaissait pas l'islamisme et s'imaginait, avec nos autres poètes, que les Sarrasins adoraient des idoles, tout comme les Grecs et les Romains. Les trois principales idoles des infidèles auraient élé ; d'après nos Chansons de geste, Mahom (Mahomet), Apollin (Apollon), Tervagan (?); et c'est ainsi que nos pères mettaient sur le compte du mahométisme toutes les erreurs des paganismes anciens.
9. AOI
Cette notation esl demeurée inexpliquée. Il est inadmissible qu‘aoi soit pour avoi, lequel viendrait d‘ad viam et signifierait: « Allons en route. ».
Il suffit, pour renverser cette opinion de M. Génin, de remarquer qu'ad viam aurait donné dans notre dialecte, non pas avoi, mais à veie.
C'est à tort que M. Michel a d'abord assimilé ce mot à notre euouae liturgique {saeculorum amen), et plus tard « au saxon abeg ou à 1'anglais away. exclamation du jongleur pour avertir le ménétrier que le couplet finit ».
M Alex, de Saint-Albin traduit AOI par « Dieu nous aide » et y voit (!) le verbe «adjuder » ; mais on trouve, dans la Chanson, que les formes ait et aiut venant du subjonctif adjuvet.
Une troisième opinion de M. Michel vaut mieux que les deux premières : « Aoi, suivant lui, serait un neume. Les neumes sont, comme on le sait la notation musicale qui a précédé la notation, sur portée ou notation guidonienne. Mais cette théorie n'a encore été appuyée d'aucune preuve.
Le mot aoi ne peut, suivant nous, être expliqué que comme une interjection analogue à notre ohé! Ahoy est encore eu usage dans la marine anglaise., où l'on dit : Boat ahoy, comme nous disons Ho, du canot.
14. À ses ducs, à ses comtes
Nos poètes qui n'avaient aucune connaissance réelle des institutions des peuples musulmans, et qui d'ailleurs n'avaient pas le moindre sentiment de la couleur locale, prêtent aux infidèles la même organisation politique qu'aux chrétiens.
Ils leur attribuent les mêmes lois, les mêmes usages, les mêmes costumes, etc.
16. France la douce
31. Mille auteurs qui aient mué.
Des faucons ont plus de prix après avoir fait leur mue, qui est une véritable maladie, parfois mortelle. Cf. Frédéric II, Liber de Venatione, xlvi , el Ducange . .m mol Muta.
36. En France à Aix.
37. A la fête de saint Michel.
52. A sa chapelle d'Aix.
58. La vie
62. Couplets similaires
63. Balaguer
71. Cordoue
Voir aussi
- Notes de la rédaction
- ↑ 1,0 et 1,1 Ce vers ne fait pas partie du manuscrit d'Oxford. Il figure en fait dans la laisse III du manuscrit de Châteauroux. Noter que ce vers n'est pas compté dans la numérotation des vers.
- Sur ce wiki
- Sur Internet Archive