Mémoires d'outre-tombe d'un peuplier (1850) Méthivier/Chapitre II : Différence entre versions
imported>Jacques Ducloy |
imported>Jacques Ducloy (→Comment mes aïeux ont aimé leur état, et sont restés à la campagne) |
||
| Ligne 15 : | Ligne 15 : | ||
{{Corps article/Début}} | {{Corps article/Début}} | ||
{{Gallica page|fonction=saut}} | {{Gallica page|fonction=saut}} | ||
| − | |||
| − | |||
L'agriculture, qui laisse chacun à sa terre, fait vivre les hommes en paix ; le commerce et les arts, qui les entassent dans les villes, les mettent les uns avec les autres en conflit nécessaire d'intérêt. | L'agriculture, qui laisse chacun à sa terre, fait vivre les hommes en paix ; le commerce et les arts, qui les entassent dans les villes, les mettent les uns avec les autres en conflit nécessaire d'intérêt. | ||
Version du 30 octobre 2020 à 19:18
Comment mes aïeux ont aimé leur état, et sont restés à la campagne
| Mémoires d'outre-tombe d'un peuplier mort au service de la République (2e édition) / par l'abbé J.-S. Méthivier.
|
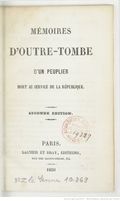
|
Comment mes aïeux ont aimé leur état, et sont restés à la campagne
L'agriculture, qui laisse chacun à sa terre, fait vivre les hommes en paix ; le commerce et les arts, qui les entassent dans les villes, les mettent les uns avec les autres en conflit nécessaire d'intérêt.
Depuis six mille ans la famille des peupliers n'est point sortie de l'humble et douce position que lui a faite le Créateur. Ses membres répandus sur tous les points du globe ont constamment préféré les lieux bas aux situations élevées : ils aiment à habiter le fond humide des vallées et les rives verdoyantes des fontaines. Là, étrangers au bruit des cités, au tapage des assemblées politiques, aux intrigues des cours, ils vivent de la paisible vie des champs, et se trouvent heureux du bonheur de tout ce qui les entoure.
Mes aïeux étaient comme on est au village, bons, simples, généreux, contents d'offrir à l'oiseau voyageur l'hospitalité d'un instant sur leurs branches flexibles, ou par un bail gratuit, renouvelé
chaque année, un asile de quelques mois à un berceau rempli d'espérance et déjà gazouillant de bonheur. Le matin, quand le point du jour commençait à blanchir leurs têtes, ils apercevaient au loin les hommes des champs sortir de leurs chaumières ; ceux-ci, lestes et joyeux, portant leurs outils sur leurs épaules et achevant entre deux haies le déjeuner gagné la veille. Ceux-là, assis sur le timon d'un chariot rustique et bruyant, fredonnant entre deux coups de fouet un air patriotique appris au régiment. Quelquefois à l'automne, s'en allant cueillir aux alentours l'herbe devenue plus rare, une jeune mère déposait à leurs pieds ses deux enfants, leur demandant pour eux de l'ombre contre le soleil, un abri contre la pluie, et, pour les réjouir, les quelques fleurs qui croissaient à leurs pieds.
Donc paix et sécurité, vie sobre et modeste, jours partagés entre la bienfaisance et le repos, telle fut l'existence de mes aïeux : qu'elle soit toujours la vôtre, chers habitants de la campagne, autrefois mes voisins et toujours mes amis! Mais, hélas ! je ne sais quelle menteuse fascination vous a dégoûtés d'un si noble et si digne partage. Tous les hommes droits et généreux s'affligent de voir cette inexplicable émigration qui dépeuple nos champs pour encombrer les ateliers, les usines, les magasins, les cabinets, les études, les échoppes du journalisme et les antres de Ja chicane. L'homme qui
n'a qu'une blouse, s'imagine que l'habit du citadin cache le bonheur entre ses plis ; on n'est bien que là où l'on n'est pas, et le soir au foyer de la famille vous rêvez un bonheur que vous croyez bien loin, tandis qu'il est là, calme, familier, expansif entre le cœur de votre mère et celui de votre sœur. Ce journalier cultive la terre, il veut que son fils soit artisan. Ce jeune menuisier devait un jour succéder à son père, non, il sera épicier, négociant, institu- teur, huissier, notaire, médecin. La honte de n'être qu'un campagnard, la prétention de devenir un bourgeois, l'espérance d'une félicité dont il respire les parfums lointains, transplantent cette jeune destinée de son sol natal dans une terre enchantée. Un beau jour donc je le vois passer par l'allée qui conduit de sa ferme à la ville, emportant sur son front le baiser de sa mère, dans son cœur les espérances de son père et dans sa bourse les épargnes de sa famille. Pauvre enfant, où vastu? Tu vas à l'école de l'orgueil, de la dépravation et de la misère; tu vas frapper à une porte dont vingt solliciteurs se disputent déjà l'entrée ; tu vas jeter aux caprices du sort, aux incertitudes de l'avenir une vie qui devait couler comme le ruisseau de ton village entre deux bords fleuris. En effet, après les longues et laborieuses initiations qui devaient transformer son existence, le voilà qu'il ne sait plus que faire. A toutes les hôtelleries de la vie on lui répond impitoyablement qu'il n'y a plus
de place. Un jour enfin, après avoir supporté tous les travaux, essuyé tous les refus, épuisé toutes ses ressources, après avoir dépensé sa jeunesse, ruin é sa famille et peut-être perdu sa vertu, sans pain et sans place, il se dit, comme l'enfant prodigue de l'Évangile : « Combien de mercenaires et d'ou« vriers dans la maison de mon père ont du pain « en abondance, et moi je meurs ici de faim. »
Alors, après six ou dix printemps, je le vois un soir reprendre le chemin de la maison d'où l'avait éloigné une trompeuse espérance, je le vois vieilli, couvert des livrées d'une misère mal déguisée, le front penché et honteux, le visage empreint d'une tristesse que ne peut effacer même la joie de revoir le toit paternel. Il revient, mais que rapporte-t-il?
dans son âme des regrets inutiles, des goûts raffinés, des besoins insatiables ; dans sa famille les chagrins, l'embarras, l'incapacité, la ruine et quelquefois le déshonneur. Dans la société enfin, un homme égaré qui a perdu sa route et son orbite, et pour qui la vie n'est plus qu'un fardeau et un châ- timent. Heureux quand, pour retrouver cette route perdue, il ne se lance pas dans les périls des insurrections et des révolutions; heureux quand, pour se débarrasser de cette vie brisée, un criminel désespoir ne demande pas à la tombe un repos que le monde n'a pu lui donner.
Sans doute parmi ces nombreux naufragés quelques ambitions surnagent et arrivent aux rivages
