Introduction médecine expérimentale (1865) Bernard/Partie 2/Chapitre 2 : Différence entre versions
imported>Jacques Ducloy (→Chapitre II : Considérations expérimentales spéciales aux êtres vivants) |
imported>Jacques Ducloy (→Chapitre II : Considérations expérimentales spéciales aux êtres vivants) |
||
| Ligne 44 : | Ligne 44 : | ||
un rôle à remplir dans un ensemble. Nous devons, autant que nous le pouvons, à l’aide des analyses expérimentales, transporter les actes physiologiques en dehors de l’organisme ; cet isolement nous permet de voir et de mieux saisir les conditions intimes des phénomènes, afin de les poursuivre ensuite dans l’organisme pour interpréter leur rôle vital. C’est ainsi que nous instituons les digestions et les fécondations artificielles pour mieux connaître les digestions et les fécondations naturelles. Nous pouvons encore, à raison des autonomies organiques, séparer les tissus vivants et les placer, au moyen de la circulation artificielle ou autrement, dans des conditions où nous pouvons mieux étudier leurs propriétés. On isole parfois un organe en détruisant par des anesthésiques les réactions du consensus général ; on arrive au même résultat en divisant les nerfs qui se rendent à une partie, tout en conservant les vaisseaux sanguins. À l’aide de l’expérimentation analytique, j’ai pu transformer en quelque sorte des animaux à sang chaud en animaux à sang froid pour mieux étudier les propriétés de leurs éléments histologiques ; j’ai réussi à empoisonner des glandes séparément ou à les faire fonctionner à l’aide de leurs nerfs divisés d’une manière tout à fait indépendante de l’organisme. Dans ce dernier cas, on peut avoir à volonté la glande successivement à l’état de repos absolu ou dans un état de fonction exagérée ; les deux extrêmes du phénomène étant connus, on saisit ensuite facilement tous les intermédiaires, et | un rôle à remplir dans un ensemble. Nous devons, autant que nous le pouvons, à l’aide des analyses expérimentales, transporter les actes physiologiques en dehors de l’organisme ; cet isolement nous permet de voir et de mieux saisir les conditions intimes des phénomènes, afin de les poursuivre ensuite dans l’organisme pour interpréter leur rôle vital. C’est ainsi que nous instituons les digestions et les fécondations artificielles pour mieux connaître les digestions et les fécondations naturelles. Nous pouvons encore, à raison des autonomies organiques, séparer les tissus vivants et les placer, au moyen de la circulation artificielle ou autrement, dans des conditions où nous pouvons mieux étudier leurs propriétés. On isole parfois un organe en détruisant par des anesthésiques les réactions du consensus général ; on arrive au même résultat en divisant les nerfs qui se rendent à une partie, tout en conservant les vaisseaux sanguins. À l’aide de l’expérimentation analytique, j’ai pu transformer en quelque sorte des animaux à sang chaud en animaux à sang froid pour mieux étudier les propriétés de leurs éléments histologiques ; j’ai réussi à empoisonner des glandes séparément ou à les faire fonctionner à l’aide de leurs nerfs divisés d’une manière tout à fait indépendante de l’organisme. Dans ce dernier cas, on peut avoir à volonté la glande successivement à l’état de repos absolu ou dans un état de fonction exagérée ; les deux extrêmes du phénomène étant connus, on saisit ensuite facilement tous les intermédiaires, et | ||
| + | {{Gallica page|fonction=saut}} | ||
| + | {{Gallica page|fonction=saut}} | ||
| + | {{Gallica page|fonction=saut}} | ||
| + | |||
| + | {{Gallica page|fonction=saut}} | ||
| + | {{Gallica page|fonction=saut}} | ||
| + | {{Gallica page|fonction=saut}} | ||
| + | |||
| + | {{Gallica page|fonction=saut}} | ||
| + | {{Gallica page|fonction=saut}} | ||
| + | {{Gallica page|fonction=saut}} | ||
| + | |||
| + | {{Gallica page|fonction=saut}} | ||
| + | {{Gallica page|fonction=saut}} | ||
{{Gallica page|fonction=saut}} | {{Gallica page|fonction=saut}} | ||
Version du 15 septembre 2020 à 16:24
Considérations expérimentales spéciales aux êtres vivants
Introduction à l’étude de la médecine expérimentale
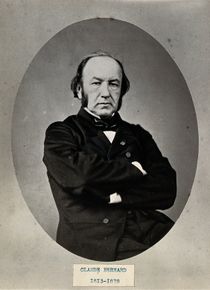
|
Considérations expérimentales spéciales aux êtres vivants
|
Chapitre II : Considérations expérimentales spéciales aux êtres vivants
I. - Dans l’organisme des êtres vivants, il y a à considérer un ensemble harmonique des phénomènes
Jusqu’à présent nous avons développé des considérations expérimentales qui s’appliquaient aux corps vivants comme aux corps bruts ; la différence pour les corps vivants résidait seulement dans une complexité beaucoup plus grande des phénomènes, ce qui rendait l’analyse expérimentale et le déterminisme des conditions incomparablement plus difficiles. Mais il existe dans les manifestations des corps vivants une solidarité de phénomènes toute spéciale sur laquelle nous devons appeler l’attention de l’expérimentateur ; car, si ce point de vue physiologique était négligé dans l’étude des fonctions de la vie, on serait conduit, même en expérimentant bien, aux idées les plus fausses et aux conséquences les plus erronées.
Nous avons vu dans le chapitre précédent que le but de la méthode expérimentale est d’atteindre au déterminisme des phénomènes, de quelque nature qu’ils soient, vitaux ou minéraux. Nous savons de plus que ce que nous appelons déterminisme d’un phénomène ne signifie rien autre chose que la cause déterminante ou la cause prochaine
qui détermine l’apparition des phénomènes. On obtient nécessairement ainsi les conditions d’existence des phénomènes sur lesquelles l’expérimentateur doit agir pour faire varier les phénomènes. Nous regardons donc comme équivalentes les diverses expressions qui précèdent, et le mot déterminisme les résume toutes.
Il est très vrai, comme nous l’avons dit, que la vie n’introduit absolument aucune différence dans la méthode scientifique expérimentale qui doit être appliquée à l’étude des phénomènes physiologiques et que, sous ce rapport, les sciences physiologiques et les sciences physico-chimiques reposent exactement sur les mêmes principes d’investigation. Mais cependant il faut reconnaître que le déterminisme dans les phénomènes de la vie est non seulement un déterminisme très complexe, mais que c’est en même temps un déterminisme qui est harmoniquement hiérarchisé. De telle sorte que les phénomènes physiologiques complexes sont constitués par une série de phénomènes plus simples qui se déterminent les uns les autres en s’associant ou se combinant pour un but final commun. Or l’objet essentiel pour le physiologiste est de déterminer les conditions élémentaires des phénomènes physiologiques et de saisir leur subordination naturelle, afin d’en comprendre et d’en suivre ensuite les diverses combinaisons dans le mécanisme si varié des organismes des animaux. L’emblème antique qui représente la vie par un cercle formé par un serpent qui se
mord la queue donne une image assez juste des choses. En effet, dans les organismes complexes, l’organisme de la vie forme bien un cercle fermé, mais un cercle qui a une tête et une queue, en ce sens que tous les phénomènes vitaux n’ont pas la même importance quoiqu’ils se fassent suite dans l’accomplissement du circulus vital. Ainsi les organes musculaires et nerveux entretiennent l’activité des organes qui préparent le sang ; mais le sang à son tour nourrit les organes qui le produisent. Il y a là une solidarité organique ou sociale qui entretient une sorte de mouvement perpétuel jusqu’à ce que le dérangement ou la cessation d’action d’un élément vital nécessaire ait rompu l’équilibre ou amené un trouble ou un arrêt dans le jeu de la machine animale. Le problème du médecin expérimentateur consiste donc à trouver le déterminisme simple d’un dérangement organique, c’est-à-dire à saisir le phénomène initial qui amène tous les autres à sa suite par un déterminisme complexe, mais aussi nécessaire dans sa condition que l’a été le déterminisme initial. Ce déterminisme initial sera comme le fil d’Ariane qui dirigera l’expérimentateur dans le labyrinthe obscur des phénomènes physiologiques et pathologiques, et qui lui permettra d’en comprendre les mécanismes variés, mais toujours reliés par des déterminismes absolus. Nous verrons, par des exemples rapportés plus loin, comment une dislocation de l’organisme ou un dérangement des plus complexes en apparence peut être ramené à un déterminisme simple initial
qui provoque ensuite des déterminismes plus complexes. Tel est le cas de l’empoisonnement par l’oxyde de carbone (voy. IIIe partie). J’ai consacré tout mon enseignement de cette année au Collège de France à l’étude du curare, non pour faire l’histoire de cette substance par elle-même, mais parce que cette étude nous montre comment un déterminisme unique des plus simples, tel que la lésion d’une extrémité nerveuse motrice, retentit successivement sur tous les autres éléments vitaux pour amener des déterminismes secondaires qui vont en se compliquant de plus en plus jusqu’à la mort. J’ai voulu établir ainsi expérimentalement l’existence de ces déterminismes intra-organiques sur lesquels je reviendrai plus tard, parce que je considère leur étude comme la véritable base de la pathologie et de la thérapeutique scientifique.
Le physiologiste et le médecin ne doivent donc jamais oublier que l’être vivant forme un organisme et une individualité. Le physicien et le chimiste, ne pouvant se placer en dehors de l’univers, étudient les corps et les phénomènes isolément pour eux-mêmes, sans être obligés de les rapporter nécessairement à l’ensemble de la nature. Mais le physiologiste, se trouvant au contraire placé en dehors de l’organisme animal dont il voit l’ensemble, doit tenir compte de l’harmonie de cet ensemble en même temps qu’il cherche à pénétrer dans son intérieur pour comprendre le mécanisme de chacune de ses parties. De là il résulte que le physicien et le chimiste peuvent repousser toute idée
de causes finales dans les faits qu’ils observent ; tandis que le physiologiste est porté à admettre une finalité harmonique et préétablie dans le corps organisé dont toutes les actions partielles sont solidaires et génératrices les unes des autres. Il faut donc bien savoir que, si l’on décompose l’organisme vivant en isolant ses diverses parties, ce n’est que pour la facilité de l’analyse expérimentale, et non point pour les concevoir séparément. En effet, quand on veut donner à une propriété physiologique sa valeur et sa véritable signification, il faut toujours la rapporter à l’ensemble et ne tirer de conclusion définitive que relativement à ses effets dans cet ensemble. C’est sans doute pour avoir senti cette solidarité nécessaire de toutes les parties d’un organisme, que Cuvier a dit que l’expérimentation n’était pas applicable aux êtres vivants, parce qu’elle séparait des parties organisées qui devaient rester réunies. C’est dans le même sens que d’autres physiologistes ou médecins dits vitalistes ont proscrit ou proscrivent encore l’expérimentation en médecine. Ces vues, qui ont un côté juste, sont néanmoins restées fausses dans leurs conclusions générales et elles ont nui considérablement à l’avancement de la science. Il est juste de dire, sans doute, que les parties constituantes de l’organisme sont inséparables physiologiquement les unes des autres, et que toutes concourent à un résultat vital commun ; mais on ne saurait conclure de là qu’il ne faut pas analyser la machine vivante comme on analyse une machine brute dont toutes les parties ont également
un rôle à remplir dans un ensemble. Nous devons, autant que nous le pouvons, à l’aide des analyses expérimentales, transporter les actes physiologiques en dehors de l’organisme ; cet isolement nous permet de voir et de mieux saisir les conditions intimes des phénomènes, afin de les poursuivre ensuite dans l’organisme pour interpréter leur rôle vital. C’est ainsi que nous instituons les digestions et les fécondations artificielles pour mieux connaître les digestions et les fécondations naturelles. Nous pouvons encore, à raison des autonomies organiques, séparer les tissus vivants et les placer, au moyen de la circulation artificielle ou autrement, dans des conditions où nous pouvons mieux étudier leurs propriétés. On isole parfois un organe en détruisant par des anesthésiques les réactions du consensus général ; on arrive au même résultat en divisant les nerfs qui se rendent à une partie, tout en conservant les vaisseaux sanguins. À l’aide de l’expérimentation analytique, j’ai pu transformer en quelque sorte des animaux à sang chaud en animaux à sang froid pour mieux étudier les propriétés de leurs éléments histologiques ; j’ai réussi à empoisonner des glandes séparément ou à les faire fonctionner à l’aide de leurs nerfs divisés d’une manière tout à fait indépendante de l’organisme. Dans ce dernier cas, on peut avoir à volonté la glande successivement à l’état de repos absolu ou dans un état de fonction exagérée ; les deux extrêmes du phénomène étant connus, on saisit ensuite facilement tous les intermédiaires, et
Voir aussi
...
