Introduction médecine expérimentale (1865) Bernard/Partie 3/Chapitre 1 : Différence entre versions
imported>Jacques Ducloy (→Deuxième exemple (suite du précédent)) |
imported>Jacques Ducloy (→Deuxième exemple (suite du précédent)) |
||
| Ligne 46 : | Ligne 46 : | ||
{{Gallica page|fonction=saut}} | {{Gallica page|fonction=saut}} | ||
| + | dans le voisinage du lieu où les chylifères commençaient à contenir du chyle rendu blanc et laiteux par l’émulsion des matières grasses alimentaires. | ||
| + | |||
| + | L’ ''observation'' fortuite de ce fait réveilla en moi une idée et fit naître dans mon esprit la pensée que le suc pancréatique pouvait bien être la cause de l’émulsion des matières grasses et par suite celle de leur absorption par les vaisseaux chylifères. Je fis encore instinctivement le syllogisme suivant : Le chyle blanc est dû à l’émulsion de la graisse ; or chez le lapin, le chyle blanc se forme au niveau du déversement du suc pancréatique dans l’intestin ; donc c’est le suc pancréatique qui émulsionne la graisse et forme le chyle blanc. C’est ce qu’il fallait juger par l’expérience. | ||
| + | |||
| + | En vue de cette idée préconçue, j’imaginai et j’instituai aussitôt une expérience propre à vérifier la réalité ou la fausseté de ma supposition. Cette expérience consistait à essayer directement la propriété du suc pancréatique sur les matières grasses neutres ou alimentaires. Mais le suc pancréatique ne s’écoule pas naturellement au dehors, comme la salive ou l’urine, par exemple ; son organe sécréteur est, au contraire, profondément situé dans la cavité abdominale. Je fus donc obligé de mettre en usage des procédés d’expérimentation pour me procurer chez l’animal vivant ce liquide pancréatique dans des conditions physiologiques convenables et en quantité suffisante. C’est alors que je pus réaliser mon expérience, c’est-à-dire contrôler mon idée préconçue, et l’expérience me prouva que l’idée était juste. En effet, du suc pancréatique obtenu dans des | ||
| + | |||
{{Gallica page|fonction=saut}} | {{Gallica page|fonction=saut}} | ||
| + | conditions convenables sur des chiens, des lapins et divers autres animaux, mêlé avec de l’huile ou de la graisse fondue, s’émulsionnait instantanément d’une manière persistante, et plus tard acidifiait ces corps gras en les décomposant, à l’aide d’un ferment particulier, en acide gras et glycérine, etc., etc. | ||
| + | |||
| + | Je ne poursuivrai pas plus loin ces expériences que j’ai longuement développées dans un travail spécial <sup>({{Gallica page|fonction=Appel de note|ref=1}})</sup>. J’ai voulu seulement montrer ici comment une première observation faite par hasard sur l’acidité de l’urine des lapins m’a donné l’idée de faire des expériences sur leur alimentation carnassière, et comment ensuite, en poursuivant ces expériences, j’ai fait naître, sans la chercher, une autre observation relative à la disposition spéciale de l’insertion du canal pancréatique chez le lapin. Cette seconde observation, survenue dans l’expérience et engendrée par elle, m’a donné à son tour l’idée de faire des expériences sur l’action du suc pancréatique. | ||
| + | |||
| + | On voit par les exemples précédents comment l’''observation'' d’un fait ou phénomène, survenu par hasard, fait naître par anticipation une ''idée'' préconçue ou une hypothèse sur la cause probable du phénomène observé ; comment l’idée préconçue engendre un raisonnement qui déduit l’expérience propre à la vérifier ; comment, dans un cas, il a fallu pour opérer cette vérification recourir à l’expérimentation, c’est-à-dire à l’emploi de procédés opératoires plus ou moins compliqués, etc. Dans | ||
| + | {{Gallica page|fonction=Début notes}} | ||
| + | {{Gallica page|fonction=note|ref=1 | ||
| + | |texte= Claude Bernard, ''Mémoire sur le pancréas et sur le rôle du suc pancréatique dans les phénomènes digestifs''. Paris, 1856.</ }} | ||
| + | {{Gallica page|fonction=Fin notes}} | ||
{{Gallica page|fonction=saut}} | {{Gallica page|fonction=saut}} | ||
| − | + | le dernier exemple l’expérience a eu un double rôle ; elle a d’abord jugé et confirmé les prévisions du raisonnement qui l’avait engendrée, mais de plus elle a provoqué une nouvelle observation. On peut donc appeler cette observation ''une observation provoquée ou engendrée par l’expérience''. Cela prouve qu’il faut, comme nous l’avons dit, observer tous les résultats d’une expérience, ceux qui sont relatifs à l’idée préconçue et ceux même qui n’ont aucun rapport avec elle. Si l’on ne voyait que les faits relatifs à son idée préconçue, on se priverait souvent de faire des découvertes. Car il arrive fréquemment qu’une mauvaise expérience peut provoquer une très bonne observation, comme le prouve l’exemple qui va suivre. | |
====Troisième exemple==== | ====Troisième exemple==== | ||
Version du 28 septembre 2020 à 23:47
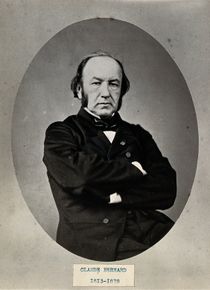
|
Exemples d’investigation expérimentale physiologique
|
Sommaire
Exemples d’investigation expérimentale physiologique
Les idées que nous avons développées dans les deux premières parties de cette introduction seront d’autant mieux comprises que nous pourrons en faire l’application aux recherches de physiologie et de médecine expérimentales et les montrer ainsi comme des préceptes faciles à retenir pour l’expérimentateur. C’est pourquoi j’ai réuni dans ce qui va suivre un certain nombre d’exemples qui m’ont paru les plus convenables pour atteindre mon but. Dans tous ces exemples, je me suis, autant que possible, cité moi-même, par cette seule raison qu’en fait de raisonnement et de procédés intellectuels, je serai bien plus sûr de ce que j’avancerai en racontant ce qui m’est arrivé qu’en interprétant ce qui a pu se passer dans l’esprit des autres. D’ailleurs je n’ai pas la prétention de donner ces exemples comme des modèles à suivre ; je ne les emploie que pour mieux exprimer mes idées et mieux faire saisir ma pensée.
Des circonstances très diverses peuvent servir de point de départ aux recherches d’investigations scientifiques ; je ramènerai cependant toutes ces variétés à deux cas principaux :
- 1º Une recherche expérimentale a pour point de départ une observation.
- 2º Une recherche expérimentale a pour point de départ une hypothèse ou une théorie.
1. - Une recherche expérimentale a pour point de départ une observation
Les idées expérimentales naissent très souvent par hasard et à l’occasion d’une observation fortuite. Rien n’est plus ordinaire, et c’est même le procédé le plus simple pour commencer un travail scientifique. On se promène, comme l’on dit, dans le domaine de la science, et l’on poursuit ce qui se présente par hasard devant les yeux. Bacon compare l’investigation scientifique à une chasse ; les observations qui se présentent sont le gibier. En continuant la même comparaison, on peut ajouter que si le gibier se présente quand on le cherche, il arrive aussi qu’il se présente quand on ne le cherche pas, ou bien quand on en cherche un d’une autre espèce. Je vais citer un exemple dans lequel ces deux cas se sont présentés successivement. J’aurai soin en même temps d’analyser chaque circonstance de cette investigation physiologique, afin de montrer l’application des principes que nous avons développés dans la première partie de cette Introduction et principalement dans les chapitres 1er et IIe.
Premier exemple
On apporta un jour dans mon laboratoire des lapins venant du marché. On les plaça sur une table où ils urinèrent et j’observai par hasard que leur urine était claire et acide. Ce fait me frappa, parce que les lapins ont ordinairement l’urine trouble et alcaline en leur qualité d’herbivores, tandis que les carnivores, ainsi qu’on le sait, ont, au contraire, les urines claires et acides. Cette observation d’acidité de l’urine chez les lapins me fit venir la pensée que ces animaux devaient être dans la condition alimentaire des carnivores. Je supposai qu’ils n’avaient probablement pas mangé depuis longtemps et qu’ils se trouvaient ainsi transformés par l’abstinence en véritables animaux carnivores vivant de leur propre sang. Rien n’était plus facile que de vérifier par l’expérience cette idée préconçue ou cette hypothèse. Je donnai à manger de l’herbe aux lapins, et quelques heures après, leurs urines étaient devenues troubles et alcalines. On soumit ensuite les mêmes lapins à l’abstinence, et après vingt-quatre ou trente-six heures au plus leurs urines étaient redevenues claires et fortement acides ; puis elles devenaient de nouveau alcalines en leur donnant de l’herbe, etc. Je répétai cette expérience si simple un grand nombre de fois sur les lapins et toujours avec le même résultat. Je la répétai ensuite chez le cheval, animal herbivore qui a également l’urine trouble et alcaline. Je trouvai que l’abstinence produit comme chez le lapin une prompte acidité de l’urine avec un accroissement relativement très considérable de l’urée, au point qu’elle cristallise parfois spontanément dans
l'urine refroidie. J’arrivai ainsi, à la suite de mes expériences, à cette proposition générale qui alors n’était pas connue, à savoir qu’ à jeun tous les animaux se nourrissent de viande, de sorte que les herbivores ont alors des urines semblables à celles des carnivores.
Il s’agit ici d’un fait particulier bien simple qui permet de suivre facilement l’évolution du raisonnement expérimental. Quand on voit un phénomène qu’on n’a pas l’habitude de voir, il faut toujours se demander à quoi il peut tenir, ou autrement dit, quelle en est la cause prochaine ; alors il se présente à l’esprit une réponse ou une idée qu’il s’agit de soumettre à l’expérience. En voyant l’urine acide chez les lapins, je me suis demandé instinctivement quelle pouvait en être la cause. L’ idée expérimentale a consisté dans le rapprochement que mon esprit a fait spontanément entre l’acidité de l’urine chez le lapin, et l’état d’abstinence que je considérai comme une vraie alimentation de carnassier. Le raisonnement inductif que j’ai fait implicitement est le syllogisme suivant : Les urines des carnivores sont acides ; or, les lapins que j’ai sous les yeux ont les urines acides ; donc ils sont carnivores, c’est-à-dire à jeun. C’est ce qu’il fallait établir par l’ expérience.
Mais pour prouver que mes lapins à jeun étaient bien des carnivores, il y avait une contre-épreuve à faire. Il fallait réaliser expérimentalement un lapin carnivore en le nourrissant avec de la viande, afin de voir si ses urines seraient alors claires, acides et relativement chargées d’urée comme pendant l’abstinence. C’est pourquoi je fis nourrir des lapins avec du bœuf bouilli froid (
nourriture qu’ils mangent très bien quand on ne leur donne pas autre chose). Ma prévision fut encore vérifiée, et pendant toute la durée de cette alimentation animale les lapins gardèrent des urines claires et acides.
Pour achever mon expérience, je voulus en outre voir par l’autopsie de mes animaux si la digestion de la viande s’opérait chez un lapin comme chez un carnivore. Je trouvai, en effet, tous les phénomènes d’une très bonne digestion dans les réactions intestinales, et je constatai que tous les vaisseaux chylifères étaient gorgés d’un chyle très abondant, blanc, laiteux, comme chez les carnivores. Mais voici qu’à propos de ces autopsies, qui m’offrirent la confirmation de mes idées sur la digestion de la viande chez les lapins, il se présenta un fait auquel je n’avais nullement pensé et qui devint pour moi, comme on va le voir, le point de départ d’un nouveau travail.
Deuxième exemple (suite du précédent)
Il m’arriva, en sacrifiant les lapins auxquels j’avais fait manger de la viande, de remarquer que des chylifères blancs et laiteux commençaient à être visibles sur l’intestin grêle à la partie inférieure du duodénum, environ à 30 centimètres au-dessous du pylore. Ce fait attira mon attention, parce que chez les chiens les chylifères commencent à être visibles beaucoup plus haut dans le duodénum et immédiatement après le pylore. En examinant la chose de plus près, je constatai que cette particularité chez le lapin coïncidait avec l’insertion du canal pancréatique situé dans un point très bas, et précisément
dans le voisinage du lieu où les chylifères commençaient à contenir du chyle rendu blanc et laiteux par l’émulsion des matières grasses alimentaires.
L’ observation fortuite de ce fait réveilla en moi une idée et fit naître dans mon esprit la pensée que le suc pancréatique pouvait bien être la cause de l’émulsion des matières grasses et par suite celle de leur absorption par les vaisseaux chylifères. Je fis encore instinctivement le syllogisme suivant : Le chyle blanc est dû à l’émulsion de la graisse ; or chez le lapin, le chyle blanc se forme au niveau du déversement du suc pancréatique dans l’intestin ; donc c’est le suc pancréatique qui émulsionne la graisse et forme le chyle blanc. C’est ce qu’il fallait juger par l’expérience.
En vue de cette idée préconçue, j’imaginai et j’instituai aussitôt une expérience propre à vérifier la réalité ou la fausseté de ma supposition. Cette expérience consistait à essayer directement la propriété du suc pancréatique sur les matières grasses neutres ou alimentaires. Mais le suc pancréatique ne s’écoule pas naturellement au dehors, comme la salive ou l’urine, par exemple ; son organe sécréteur est, au contraire, profondément situé dans la cavité abdominale. Je fus donc obligé de mettre en usage des procédés d’expérimentation pour me procurer chez l’animal vivant ce liquide pancréatique dans des conditions physiologiques convenables et en quantité suffisante. C’est alors que je pus réaliser mon expérience, c’est-à-dire contrôler mon idée préconçue, et l’expérience me prouva que l’idée était juste. En effet, du suc pancréatique obtenu dans des
conditions convenables sur des chiens, des lapins et divers autres animaux, mêlé avec de l’huile ou de la graisse fondue, s’émulsionnait instantanément d’une manière persistante, et plus tard acidifiait ces corps gras en les décomposant, à l’aide d’un ferment particulier, en acide gras et glycérine, etc., etc.
Je ne poursuivrai pas plus loin ces expériences que j’ai longuement développées dans un travail spécial (1). J’ai voulu seulement montrer ici comment une première observation faite par hasard sur l’acidité de l’urine des lapins m’a donné l’idée de faire des expériences sur leur alimentation carnassière, et comment ensuite, en poursuivant ces expériences, j’ai fait naître, sans la chercher, une autre observation relative à la disposition spéciale de l’insertion du canal pancréatique chez le lapin. Cette seconde observation, survenue dans l’expérience et engendrée par elle, m’a donné à son tour l’idée de faire des expériences sur l’action du suc pancréatique.
On voit par les exemples précédents comment l’observation d’un fait ou phénomène, survenu par hasard, fait naître par anticipation une idée préconçue ou une hypothèse sur la cause probable du phénomène observé ; comment l’idée préconçue engendre un raisonnement qui déduit l’expérience propre à la vérifier ; comment, dans un cas, il a fallu pour opérer cette vérification recourir à l’expérimentation, c’est-à-dire à l’emploi de procédés opératoires plus ou moins compliqués, etc. Dans
- (1) ↑ Claude Bernard, Mémoire sur le pancréas et sur le rôle du suc pancréatique dans les phénomènes digestifs. Paris, 1856.</
le dernier exemple l’expérience a eu un double rôle ; elle a d’abord jugé et confirmé les prévisions du raisonnement qui l’avait engendrée, mais de plus elle a provoqué une nouvelle observation. On peut donc appeler cette observation une observation provoquée ou engendrée par l’expérience. Cela prouve qu’il faut, comme nous l’avons dit, observer tous les résultats d’une expérience, ceux qui sont relatifs à l’idée préconçue et ceux même qui n’ont aucun rapport avec elle. Si l’on ne voyait que les faits relatifs à son idée préconçue, on se priverait souvent de faire des découvertes. Car il arrive fréquemment qu’une mauvaise expérience peut provoquer une très bonne observation, comme le prouve l’exemple qui va suivre.
Troisième exemple
...
...
...
Quatrième exemple
...
...
Cinquième exemple
...
...
II. - Une recherche expérimentale a pour point de départ une hypothèse ou une théorie.
Nous avons déjà dit (p. 56) et nous verrons plus loin que dans la constatation d’une observation, il ne faut jamais aller au-delà du fait. Mais il n’en est pas de même dans l’institution d’une expérience ; je veux montrer qu’à ce moment les hypothèses sont indispensables et que leur utilité est précisément alors de nous entraîner hors du fait et de porter la science en avant. Les hypothèses ont pour objet non seulement de nous faire faire des expériences nouvelles, mais elles nous font découvrir souvent des faits nouveaux que nous n’aurions pas aperçus sans elles. Dans les exemples qui précèdent nous avons vu que l’on peut partir d’un fait particulier pour s’élever successivement à des idées plus générales, c’est-à-dire à une théorie. Mais il arrive aussi, comme nous venons de le voir, qu’on peut partir d’une hypothèse qui se déduit d’une théorie. Dans ce cas, bien qu’il s’agisse d’un raisonnement déduit logiquement d’une théorie, c’est néanmoins encore une hypothèse qu’il faut vérifier
par l’expérience. Ici en effet les théories ne nous représentent qu’un assemblage de faits antérieurs sur lesquels s’appuie l’hypothèse, mais qui ne sauraient lui servir de démonstration expérimentale. Nous avons dit que dans ce cas il fallait ne pas subir le joug des théories, et que garder l’indépendance de son esprit était la meilleure condition pour trouver la vérité et pour faire faire des progrès à la science. C’est ce que prouveront les exemples suivants.
Premier exemple.
Premier exemple. - En 1843, dans un de mes premiers travaux, j’entrepris d’étudier ce que deviennent les différentes substances alimentaires dans la nutrition. Je commençai, ainsi que je l’ai déjà dit, par le sucre, qui est une substance définie et plus facile que toutes les autres à reconnaître et à poursuivre dans l’économie. J’injectai dans ce but des dissolutions de sucre de canne dans le sang des animaux et je constatai que ce sucre, même injecté dans le sang à faible dose, passait dans les urines. Je reconnus ensuite que le suc gastrique, en modifiant ou en transformant ce sucre de canne, le rendait assimilable, c’est-à-dire destructible dans le sang(1).
Alors je voulus savoir dans quel organe ce sucre alimentaire disparaissait, et j’admis par hypothèse que le sucre que l’alimentation introduit dans le sang pourrait être détruit dans le poumon ou dans les capillaires généraux. En effet, la théorie régnante à cette époque et qui devait être naturellement mon point de départ, admettait
- (1) ↑ Claude Bernard, thèse pour le doctorat en médecine. Paris
que le sucre qui existe chez les animaux provient exclusivement des aliments et que ce sucre se détruit dans l’organisme animal par des phénomènes de combustion, c’est-à-dire de respiration.
C’est ce qui avait fait donner au sucre le nom d’aliment respiratoire. Mais je fus immédiatement conduit à voir que la théorie sur l’origine du sucre chez les animaux, qui me servait de point de départ, était fausse. En effet, par suite d’expériences que j’indiquerai plus loin, je fus amené non à trouver l’organe destructeur du sucre, mais au contraire je découvris un organe formateur de cette substance, et je trouvai que le sang de tous les animaux contient du sucre, même quand ils n’en mangent pas. Je constatai donc là un fait nouveau, imprévu par la théorie et que l’on n’avait pas remarqué, sans doute, parce que l’on était sous l’empire d’idées théoriques opposées auxquelles on avait accordé trop de confiance. Alors, j’abandonnai tout aussitôt toutes mes hypothèses sur la destruction du sucre, pour suivre ce résultat inattendu qui a été depuis l’origine féconde d’une voie nouvelle d’investigation et une mine de découvertes qui est loin d’être épuisée.
...
Deuxième exemple, suite du précédent.
...
